 Historien du Maghreb contemporain, spécialiste du Maroc, Pierre Vermeren est maître de conférences à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Alors que le régime Ben Ali vacillait, il est le premier à avoir parlé de « révolution » pour la Tunisie, au micro de France Info, quelques jours avant la chute du Président. A l’occasion de la réédition, avec une préface inédite, de son ouvrage de 2004, Maghreb : la démocratie impossible ? (sous le titre Maghreb : les origines de la révolution démocratique, Pluriel, mai 2011), Histoire pour tous le reçoit pour évoquer son parcours d’historien et aborder des sujets comme l’enseignement de l’histoire du Maghreb contemporain, mais également de l’islam, et évidemment pour connaître son avis sur l’avenir des révolutions arabes.
Historien du Maghreb contemporain, spécialiste du Maroc, Pierre Vermeren est maître de conférences à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Alors que le régime Ben Ali vacillait, il est le premier à avoir parlé de « révolution » pour la Tunisie, au micro de France Info, quelques jours avant la chute du Président. A l’occasion de la réédition, avec une préface inédite, de son ouvrage de 2004, Maghreb : la démocratie impossible ? (sous le titre Maghreb : les origines de la révolution démocratique, Pluriel, mai 2011), Histoire pour tous le reçoit pour évoquer son parcours d’historien et aborder des sujets comme l’enseignement de l’histoire du Maghreb contemporain, mais également de l’islam, et évidemment pour connaître son avis sur l’avenir des révolutions arabes.
" Une affaire de rencontres et d'opportunités"
HPT : Comment êtes-vous devenu historien ?
Pierre Vermeren : Elève dans un petit lycée de campagne, j’avais beaucoup de centres d’intérêt, dont l’histoire. Sur les conseils de mon professeur de philosophie, je suis entré en prépa et, en khâgne, j’ai eu la chance d’avoir pour professeur d’histoire Jean-Pierre Pister. C’est grâce à lui que mon choix s’est définitivement porté sur l’histoire, plutôt que sur les lettres ou la philo. Ensuite, mon parcours a été très classique avec la réussite au concours de l’ENS Fontenay/Saint-Cloud. M’est venue au même moment l’envie de partir étudier à l’étranger, grâce entre autres à la rencontre avec des amis marocains durant mes années de prépa. Il a été difficile de trouver un directeur de recherches pour ma maîtrise qui me permettrait d’aller au Maroc, et j’ai finalement fait la rencontre de René Gallissot, qui a accepté que je parte là-bas pour étudier l’affaire du Sahara marocain (ou occidental, selon le point de vue). Je lui suis resté fidèle jusqu’à ma thèse, soutenue en 2000. Entretemps, j’avais passé l’agrégation, obtenue en 1989. C’est donc un intérêt personnel ancien, mais parmi d’autres, une affaire de rencontres et d’opportunités, qui m’ont amené à devenir historien du Maghreb et du Maroc contemporains.
Il vous a donc fallu apprendre l’arabe.
Là, j’ai tâtonné longuement, prenant des cours dès l’hypokhâgne, puis à Normale Sup’, mais de façon très décousue. Ensuite, au Maroc, c’était difficile car la langue correspond très peu à l’arabe classique qu’on apprend dans les cours universitaires en France. Sur les conseils de Rémi Leveau, j’ai passé un an au Caire après l’agrégation pour suivre les cours du Département d’études arabes du Caire (DEAC), étape supplémentaire dans l’apprentissage de la langue, même si l’arabe égyptien ne m’a plus beaucoup servi par la suite. Pendant mes années de thèse, j’ai pris des cours à Ulm, avec Daniel Reig puis Houda Ayoub, et je me suis mis vraiment à l’arabe dialectal quand je suis parti plus durablement au Maroc en 1996.
Parlez-nous de ces années au Maroc justement.
J’y suis demeuré six ans, après y avoir passé plusieurs mois en maîtrise, puis en DEA, donc en tant qu’étudiant. De 1996 à 2002, j’ai été professeur en prépa HEC au lycée Descartes de Rabat. J’ai enseigné sur un rythme intense, et sur des sujets d’histoire économique passionnants, avec des étudiants de très grande qualité, pour un travail d’enseignement très approfondi en histoire contemporaine.
C’est ensuite que vous avez été élu à Paris I ?
Pas tout de suite. Auparavant j’ai passé le concours de l’ENA, pour finalement démissionner. Puis j’ai été TZR sur des collèges et lycées de l’agglomération de Bordeaux. Je suis enfin arrivé en tant que maître de conférences à Paris I, élu en 2006. C’est donc ma cinquième année ici.
" Une francophonie d'élites infériorisées à l'époque coloniale"
Quel a été votre sujet de thèse, et comment l’avez-vous abordé ?
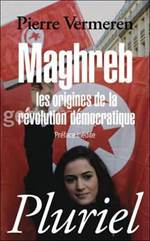 Le titre était : « La formation des élites par l’enseignement supérieur au Maroc et en Tunisie (1920-2000) ». Mes rencontres avec des étudiants marocains au lycée Poincaré de Nancy, où ils étaient en Maths Sup/Maths Spé, puis d’autres rencontres à Normale Sup, m’ont amené à m’intéresser à ces élites. En Egypte ensuite, j’ai enseigné pendant un an à Héliopolis et j’ai pu y rencontrer des étudiants arabes remarquablement francophones, confirmant mon intérêt pour ces élites bilingues. Durant mon DEA, je me suis concentré sur la question de l’arabisation, au moment où c’était une vraie question au Maroc (l’arabisation du baccalauréat a eu lieu en 1989), très débattue. J’ai alors voulu comparer l’arabisation en Egypte sous Nasser, durant les années 50, avec celle du Maroc dans les années 80, ainsi que ses conséquences sociologiques, et le lien entre élites bilingues et élites sociales. Mais face aux critiques reçues au Caire pour ma comparaison entre Maghreb et Machrek, j’ai opté pour un sujet maghrébin, ce qui m’a amené à travailler sur le Maroc et sur la Tunisie pour ma thèse. Celle-ci entamée, je me suis tourné vers la manière dont la colonisation avait inculqué à ces élites une francophonie, mais une francophonie d’élites infériorisées à l’époque coloniale. La langue était devenue un enjeu politique, idéologique, social, économique à l’intérieur des sociétés du Maghreb, puis un outil de pouvoir, longtemps encore après les indépendances. C’est donc sur cette question d’histoire sociale, intellectuelle et culturelle que j’ai travaillé. Un travail de collecte documentaire, mais aussi de sociologie historique, pour savoir quels étaient les publics touchés par l’arabisation, ceux favorisés par le bilinguisme, l’histoire des institutions d’enseignement également, et comprendre ainsi l’émergence d’élites bilingues, voire exclusivement francophones, qui ont dirigé le Maghreb jusqu’à nos jours, y compris dans la Tunisie après la révolution. Avec, en contrefeu social, une société dominée et arabisée, et qui a nourri l’islamisme. M’inspirant des travaux de Bourdieu, j’ai voulu voir comment des sociétés comme celles du Maghreb jouaient de ces clivages avec une surdétermination des rapports sociaux faite par l’école, toujours au nom du retour à l’identité (présupposée arabe).
Le titre était : « La formation des élites par l’enseignement supérieur au Maroc et en Tunisie (1920-2000) ». Mes rencontres avec des étudiants marocains au lycée Poincaré de Nancy, où ils étaient en Maths Sup/Maths Spé, puis d’autres rencontres à Normale Sup, m’ont amené à m’intéresser à ces élites. En Egypte ensuite, j’ai enseigné pendant un an à Héliopolis et j’ai pu y rencontrer des étudiants arabes remarquablement francophones, confirmant mon intérêt pour ces élites bilingues. Durant mon DEA, je me suis concentré sur la question de l’arabisation, au moment où c’était une vraie question au Maroc (l’arabisation du baccalauréat a eu lieu en 1989), très débattue. J’ai alors voulu comparer l’arabisation en Egypte sous Nasser, durant les années 50, avec celle du Maroc dans les années 80, ainsi que ses conséquences sociologiques, et le lien entre élites bilingues et élites sociales. Mais face aux critiques reçues au Caire pour ma comparaison entre Maghreb et Machrek, j’ai opté pour un sujet maghrébin, ce qui m’a amené à travailler sur le Maroc et sur la Tunisie pour ma thèse. Celle-ci entamée, je me suis tourné vers la manière dont la colonisation avait inculqué à ces élites une francophonie, mais une francophonie d’élites infériorisées à l’époque coloniale. La langue était devenue un enjeu politique, idéologique, social, économique à l’intérieur des sociétés du Maghreb, puis un outil de pouvoir, longtemps encore après les indépendances. C’est donc sur cette question d’histoire sociale, intellectuelle et culturelle que j’ai travaillé. Un travail de collecte documentaire, mais aussi de sociologie historique, pour savoir quels étaient les publics touchés par l’arabisation, ceux favorisés par le bilinguisme, l’histoire des institutions d’enseignement également, et comprendre ainsi l’émergence d’élites bilingues, voire exclusivement francophones, qui ont dirigé le Maghreb jusqu’à nos jours, y compris dans la Tunisie après la révolution. Avec, en contrefeu social, une société dominée et arabisée, et qui a nourri l’islamisme. M’inspirant des travaux de Bourdieu, j’ai voulu voir comment des sociétés comme celles du Maghreb jouaient de ces clivages avec une surdétermination des rapports sociaux faite par l’école, toujours au nom du retour à l’identité (présupposée arabe).
Y a-t-il eu, comme en Algérie, un rôle central d’enseignants venus d’Egypte pour arabiser le Maroc et la Tunisie ?
Oui, mais c’est plus compliqué que ça, car le Maghreb est vraiment entré dans la francophonie après les indépendances. Dans les années 60-70, par le biais de la coopération notamment, mais aussi par celui des politiques publiques des Etats, la francophonie n’a plus touché uniquement les élites, mais est descendue dans la société pour toucher une large partie des classes moyennes. C’est vrai en Algérie et au Maroc, et encore plus en Tunisie avec la volonté d’une école bilingue par Bourguiba. C’est vingt ans après les indépendances, au moment de la crise sociale et économique, qu’ont été décidées des politiques d’arabisation. Cela a fonctionné en Tunisie, mais pour le Maroc et l’Algérie il a fallu faire venir des professeurs d’arabe de l’étranger, d’Egypte, du Liban, de Syrie, parce que la majorité de la population n’était pas alphabétisée, et, au Maroc notamment, était pour moitié berbérophone. On a appelé ça la « décolonisation culturelle », mais cela a été fait souvent d’une manière très artificielle, politique et idéologique, un moyen pour les Etats de lutter contre la contestation, comme l’avait fait Nasser en Egypte. Cela s’est avéré contreproductif pour les peuples, au profit des Etats autoritaires, entraînant un développement de l’islam politique, parfois poussé par les Etats eux-mêmes, avec le soutien saoudien.
Quel bilan tirez-vous aujourd’hui des conclusions de votre thèse ?
J’ai travaillé sur quatre générations d’intellectuels : les pionniers, ceux du début du siècle jusqu’aux années 1920, qui ont été à la fois les premiers étudiants en France, et les pères fondateurs des nationalismes ; ensuite, la génération des années 30, 40, 50, celle des indépendances et de la prise de pouvoir ; puis celle de l’ouverture démocratique de l’école, dans les années 1960-70 ; et, enfin, la génération de la crise, frappée par l’enseignement massifié et arabisé, et par une situation économique de plus en plus critique. Ce dernier moment est celui du renforcement des clivages sociaux, avec un système qui profite à des minorités, comme les élites francophones ou bilingues sur lesquelles j’ai travaillé, au détriment d’une masse qui n’est ni vraiment francophone, ni vraiment arabophone, signant donc un véritable échec. La Tunisie étant cependant un cas à part, grâce à des choix éducatifs faits dans les années 90, et qui ont été fondamentaux pour expliquer la révolution.
La difficulté d’accéder aux archives officielles oblige à construire des objets de recherche, à interroger les acteurs et les témoins, et à travailler sur d’autres types d’archives, telles les archives scolaires comme je l’ai fait. Quelqu’un qui reprendrait la question aujourd’hui ne serait donc pas beaucoup plus avancé, puisque nous n’avons toujours pas accès aux archives des Etats post-coloniaux au Maghreb. Je suis donc assez fier de ce travail, puisqu’en quelque sorte il a été validé par ce qui s’est passé en Tunisie, et le rôle de ces générations formées par une politique publique volontariste, à l’inverse d’autres pays, où une autre politique amène à la stagnation de ces générations. D’ailleurs, quand j’y travaillais, le sujet était tabou dans la Tunisie de Ben Ali, et ma thèse a été censurée, alors qu’au Maroc elle a été publiée et a eu un certain succès, en contribuant avec d’autres à lancer un débat toujours d’actualité : comment réformer le système d’enseignement ? Quel statut donner à la langue arabe et au bilinguisme ?
"Un défenseur de l'histoire immédiate"
Et sur quoi portent vos recherches actuelles ?
L’enseignement d’abord me prend du temps et, depuis l’année dernière, grâce à l’obtention de mon HDR, je peux diriger des recherches. Pour ma part, je suis dans un domaine où il y a très peu de spécialistes, et en plus dans un contexte où l’histoire immédiate au sens large n’est pas politiquement acceptable par les Etats sur lesquels je travaille. J’ai pu m’en rendre compte quand j’ai publié en 2002 mon ouvrage Histoire du Maroc depuis l’indépendance, avant d’autres livres sur le Maroc. Ces Etats ont essayé de cantonner les historiens aux périodes anciennes, car l’histoire du Maghreb contemporain est dangereuse, même si ça commence à changer. On assiste ainsi à une vraie décongélation depuis la fin des années 90, au Maroc en tout cas. Ma position d’intellectuel français m’a aidé évidemment, et j’ai pu me poser la question de la démocratisation du Maghreb dans l’ouvrage réédité aujourd’hui (Maghreb : la démocratie impossible ?, 2004). On sentait bien des aspirations et des envies de changement dans la jeunesse, malgré le poids des Etats autoritaires, la menace de prise de pouvoir des islamistes, la crise… Ce qui se vérifie aujourd’hui. Et en tant qu’historien, c’est passionnant et excitant de vivre et d’étudier ce qui se passe en ce moment avec les révolutions arabes. Ce n’est certes peut-être pas un travail d’historien comme l’entendent, par exemple, mes collègues médiévistes, à cause des difficultés avec les archives publiques, mais je suis justement un défenseur de l’histoire immédiate, sans tabou sur ces questions, car l’histoire se fabrique sous nos yeux.
Le risque avec l’histoire immédiate n’est-il pas de tomber dans le commentaire politique ou de l’actualité ?
Pas forcément, car c’est plus facile quand on travaille sur d’autres sociétés que la sienne. Personnellement, je ne suis pas partie prenante des débats dans ces sociétés, je n’ai pas de passé familial lié à l’Afrique du Nord, mais j’y ai été étudiant et fonctionnaire, ce qui permet un regard croisé et distancé. C’est sans doute plus difficile de travailler sur la société française contemporaine.
Dans quel sens voulez-vous vous intéresser à la France contemporaine ?
Je pense que l’histoire de la France depuis la Seconde guerre mondiale est à écrire, que les historiens de notre génération vont même la réécrire, en particulier dans les rapports très denses entre la France et le Maghreb.
"Garder un discours historique et pas militant"
Que pensez-vous des éventuels problèmes à enseigner l’histoire de l’islam, en Université et dans le secondaire ?
Je ne suis pas islamologue, mais j’ai travaillé pendant trois ans à Paris I avec Nadine Picaudou sur la politisation de l’islam aux XIXe et XXe siècles, dans un contexte plutôt serein. Certes, une partie des étudiants sont des militants et viennent pour entendre certaines choses, et s’ils ne les trouvent pas, ils s’en vont ; mais quand on apporte des clés de compréhension qui ne sont pas des lieux communs, et qu’on historicise ces questions, les étudiants sont plutôt satisfaits. C’est plus difficile à faire dans le contexte du secondaire, car les élèves sont très faibles sur les questions religieuses. Il faut néanmoins enseigner sans pudeur, et sans peur, les fondements du christianisme, de l’islam, et du judaïsme, toujours en les historicisant pour garder un discours historique et pas militant. J’étais dans un lycée à Bordeaux avec une forte proportion d’élèves beurs, et j’avais des collègues qui refusaient de leur enseigner l’histoire du christianisme, croyant que cela allait créer des problèmes, alors que moi-même je n’ai jamais rencontré autant d’intérêt que dans ces classes… L’autorité pédagogique doit s’imposer, a fortiori s’il y a des problèmes. Dans le cas de l’islam, s’en tenir à une vision fantasmagorique de l’Andalousie heureuse me paraît inadapté, car on n’enseigne pas des utopies mais des situations historiques. Autre exemple, la situation coloniale, qui fait partie de notre histoire, mériterait d’être vraiment enseignée, alors qu’on se contente de faire l’histoire de la guerre d’Algérie en une heure ou deux, sans savoir ce qu’est la colonisation. Enseigner la décolonisation sans la colonisation est totalement absurde. Cela pose la question du choix des programmes, souvent inadaptés : ils ont le double-inconvénient d’être cycliques et démesurés dans leurs ambitions, tout en ayant des lacunes béantes. Aujourd’hui, par exemple, le XIXe siècle a disparu des programmes, alors que notre monde s’est construit au XIXe, et on accorde une place démesurée à la Seconde guerre mondiale. Il y a évidemment toujours une dimension et une obsession idéologiques dans la construction des programmes scolaires. Peut-être faudrait-il une construction historique du temps long, de la Sixième à la Terminale, en faisant des choix, pour une meilleure cohérence et une meilleure continuité ?
Que pensez-vous de l’orientation européenne des programmes, et de l’ouverture à d’autres civilisations, comme le Mali, la Chine ou l’Inde ?
L’essentiel serait de donner le goût de l’histoire et de la curiosité aux jeunes, une conscience de l’évolution rapide du temps. Puis se concentrer sur l’espace où ils s’enracinent, la France et l’Europe donc, ce qui n’interdit pas des ouvertures, mais de façon cohérente encore. Par exemple, on est très content de proposer des cours sur l’Afrique subsaharienne, mais cela s’est traduit par la disparition de ceux sur le Maghreb, ce qui est un non-sens. La période de l’Algérie coloniale est très riche : la gestion de l’islam par l’État français depuis deux siècles, le rapport à l’autre, la question de l’assimilation, la construction de la nationalité, puis évidemment ensuite le conflit. Enseigner le parcours de la France en Algérie serait beaucoup plus structurant que d’autres thèmes. On n’enseigne pas non plus assez l’histoire de la langue, alors que c’est ce qui nous unit et nous construit. Les élèves peuvent tout entendre. Tout peut être enseigné, si on ne pense pas par idéologie à court terme.
"Ecrire des essais historiques lisibles par le grand public"
Comment abordez-vous la vulgarisation, vu que vous publiez beaucoup ?
Quand on écrit, c’est pour être lu. Même s’il y a des ouvrages plus érudits que d’autres évidemment. Je sais par exemple que ma soutenance d’HDR, Misère de l’historiographie du Maghreb contemporain, va intéresser essentiellement des spécialistes et pas un plus large public, au contraire de l’ouvrage sur la démocratisation du Maghreb. Je suis très attaché au fait d’écrire des essais historiques qui soient lisibles par le grand public. On a la chance en France d’être dans un pays où les gens s’intéressent à l’histoire. Cela fait partie de mon travail de faire des conférences, d’intervenir dans les médias, de participer à des débats.
Que pensez-vous du rôle d’internet aujourd’hui pour l’enseignement, la recherche et la vulgarisation en histoire ?
Je suis assez fasciné par l’apport de Wikipedia…
Il n’y a pas des problèmes avec l’utilisation qu’en font vos étudiants ?
Si, évidemment. On ne peut pas empêcher des manipulations et des discours idéologiques, mais justement on peut les contredire, intervenir, etc.
"Une complémentarité entre la lecture et internet"
N’y aurait-il pas besoin d’une formation spécifique pour les étudiants, par rapport au net ?
Oui, mais je parlais d’un point de vue personnel. J’y trouve un grand intérêt, car je suis capable de faire le tri et, pour trouver une information spécifique, internet est un outil extraordinaire, avec les revues en ligne, le Sudoc,…Pour les étudiants, ça peut paraître un moyen de s’épargner de lire, et amener à une culture saucisson, alors que la lecture est indispensable. Je continue à demander aux étudiants des fiches de lecture, sachant très bien qu’ils peuvent en trouver sur internet, car il faut garder cette exigence de lecture. Il faut leur montrer la complémentarité entre la lecture et internet, et leur apprendre à utiliser ce formidable outil. D’autant que les étudiants sont habitués à des exigences de plus en plus faibles dans le secondaire, ce qui provoque des catastrophes en première année de licence…
Révolutions arabes : "des transformations profondes et irréversibles"
Pour conclure en revenant à l’actualité, comment voyez-vous l’avenir des révolutions arabes dans les mois qui viennent ?
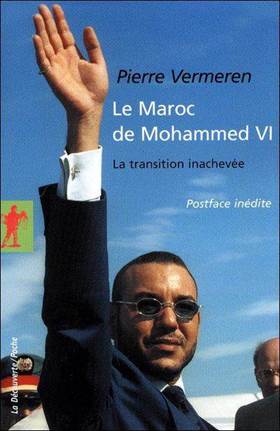 Les choses vont être difficiles, il y a logiquement un mouvement de contre-révolution, des facteurs de blocage. Il y a des solidarités entre régimes, comme l’Algérie et la Libye, le régime libyen essayant de porter la guerre en Tunisie. On voit que des promesses ont été faites en Algérie et au Maroc, mais qu’elles n’ont pas encore été concrétisées. La chute de Kadhafi et la réussite du processus démocratique en Tunisie vont être des éléments déterminants pour la région, tout comme le résultat des élections en Egypte (si, par exemple, les Frères musulmans s’imposent, ce qui est parfaitement envisageable). Ce n’est pas un hasard si l’Arabie Saoudite s’implique au Yémen après le Bahreïn, que des Etats africains soutiennent la Libye, ou que personne n’ose réagir contre les massacres en Syrie. C’est donc le début d’une période de très grandes turbulences, mais en même temps de transformations profondes et irréversibles. En France, on sait très bien que l’installation de la République a été longue et chaotique, jusqu’à ce que la majorité de la population se mette d’accord sur un nouveau contrat social. Le contexte de la crise n’aide pas pour le moment, et les ennemis des évolutions en cours sont nombreux. Les mois qui viennent seront donc déterminants pour les révolutions arabes, qui sont pour le moment des ébauches de libération.
Les choses vont être difficiles, il y a logiquement un mouvement de contre-révolution, des facteurs de blocage. Il y a des solidarités entre régimes, comme l’Algérie et la Libye, le régime libyen essayant de porter la guerre en Tunisie. On voit que des promesses ont été faites en Algérie et au Maroc, mais qu’elles n’ont pas encore été concrétisées. La chute de Kadhafi et la réussite du processus démocratique en Tunisie vont être des éléments déterminants pour la région, tout comme le résultat des élections en Egypte (si, par exemple, les Frères musulmans s’imposent, ce qui est parfaitement envisageable). Ce n’est pas un hasard si l’Arabie Saoudite s’implique au Yémen après le Bahreïn, que des Etats africains soutiennent la Libye, ou que personne n’ose réagir contre les massacres en Syrie. C’est donc le début d’une période de très grandes turbulences, mais en même temps de transformations profondes et irréversibles. En France, on sait très bien que l’installation de la République a été longue et chaotique, jusqu’à ce que la majorité de la population se mette d’accord sur un nouveau contrat social. Le contexte de la crise n’aide pas pour le moment, et les ennemis des évolutions en cours sont nombreux. Les mois qui viennent seront donc déterminants pour les révolutions arabes, qui sont pour le moment des ébauches de libération.
Et pour le Maroc plus spécifiquement ?
Les Marocains ont été stupéfaits par ce qui s’est passé dans les autres pays, parce qu’ils avaient l’impression d’être en tête dans l’évolution des sociétés arabes. Cela a provoqué des débats, auxquels le roi a réagi en février, sous la pression. Il sera bien avisé de transformer ses promesses en réformes, et je crains que la réforme proposée en juin ne soit insuffisante. Les Marocains n’ont pas une culture révolutionnaire, au contraire des Algériens ou d’autres peuples, et en même temps ils aspirent à des changements profonds, une lutte plus franche contre la corruption, en particulier grâce à la justice. Avec la difficulté de transmettre les réformes à toute la société, comme cela a pu être le cas avec la Moudawana. Il y a des élites marocaines de qualité, un potentiel, une volonté, mais une peur du chaos et de la guerre civile. Les autorités doivent s’interroger sur la nécessité de changements profonds au regard des évolutions de la mondialisation de l’information et des aspirations démocratiques.
Merci.
Pierre Vermeren est maître de conférences en Histoire contemporaine à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Spécialiste du Maroc, il a entre autres publié :
- Maghreb : les origines de la révolution démocratique, Pluriel, 2011 (réédition avec préface inédite de Maghreb : la démocratie impossible ?, Fayard, 2004). Recension à venir sur HPT.
- Le Maghreb, idées reçues, Le Cavalier Bleu, 2010.
- Le Maroc de Mohammed VI. La transition inachevée, La Découverte, rééd. 2011.
- Le Maroc, idées reçues, Le Cavalier Bleu, rééd. 2010.
- Histoire du Maroc depuis l’indépendance, La Découverte, rééd. 2010.

