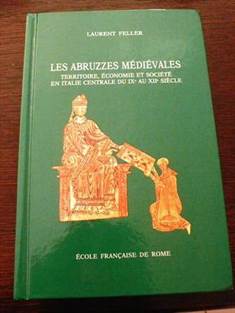 Histoire pour tous rencontre aujourd’hui Laurent Feller, professeur d’histoire médiévale à Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’Italie du haut Moyen Âge, et directeur du Lamop. Il évoque son métier d’historien, son travail de recherche dans le contexte de la réforme de l’Université, et les questions de publication et de vulgarisation de l’histoire.
Histoire pour tous rencontre aujourd’hui Laurent Feller, professeur d’histoire médiévale à Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’Italie du haut Moyen Âge, et directeur du Lamop. Il évoque son métier d’historien, son travail de recherche dans le contexte de la réforme de l’Université, et les questions de publication et de vulgarisation de l’histoire.
« Un parcours classique »
Histoire pour tous : Comment êtes-vous devenu historien ?
Laurent Feller : Mon parcours est assez classique dans la maison [Paris I Sorbonne] : devenir historien, cela signifie certes répondre à des inclinations intellectuelles. Cela signifie aussi choisir un métier, et donc suivre un cursus. Après mon bac, je me suis retrouvé en hypokhâgne à Henri IV, puis j’ai intégré l’Ecole Normale Supérieure, où je me suis spécialisé en médiévale. Au départ, je voulais faire de l’archéologie médiévale. Après des hésitations ou des tergiversations, j’ai fini par m’orienter vers des choix correspondant mieux à ma formation initiale et, au fond, à mes goûts. Souhaitant travailler sur les lettres de rémission du Trésor des Chartes, j’ai choisi Bernard Guenée comme directeur de maîtrise, avec un projet peut-être un peu fumeux ou mal formulé d’étude de la « culture matérielle ». Celui-ci a, comme on dit, recadré le débat et m’a orienté vers les faux monnayeurs au bas Moyen Âge, ce qui en fait, combinait plutôt bien mes aspirations : faire une histoire économique et sociale qui inclue aussi les questions liées au territoire. En 1981, j’ai obtenu l’agrégation, avant d’être élu, en 1983, à l’Ecole française de Rome où j’ai bénéficié des meilleures conditions possibles pour préparer mon troisième cycle.
Pourquoi avoir choisi l’histoire du Moyen Âge ?
D’abord un intérêt familial. Mon père était véritablement passionné d’histoire et nous avions à la maison une véritable bibliothèque constamment enrichie par ses achats : on y trouvait tous les livres importants sortant à ce moment. Il avait, par exemple, pensé à se procurer les Mélanges Historiques de M. Bloch qui sont désormais dans ma bibliothèque… Et me rendent les plus grands services. J’ai eu la chance, aussi, de rencontrer J.-M. Pesez, un ami de la famille et l’un des personnages les plus importants des années 1970-1990 (il est décédé en 1998) dans le champ de l’archéologie médiévale française. C’était un très grand professeur, un des meilleurs enseignants dont j’ai pu suivre les cours, et ma formation de chercheur lui doit beaucoup. J’avais aussi le sentiment que l’histoire du Moyen Âge était un secteur qui bougeait, où l’on travaillait bien, et c’était également une période où des personnages marquants enseignaient l’histoire du Moyen Âge à Paris 1 : Robert Fossier, Pierre Toubert, Bernard Guenée,…L’équipe des maîtres-assistants, d’autre part, que j’ai rejointe par la suite, en 1988, avait fait un travail pédagogique absolument formidable et, pour apprendre à faire de l’histoire, pas seulement de l’histoire médiévale, d’ailleurs, Paris 1 était l’endroit où il fallait étudier. Et l’histoire du Moyen Âge une des disciplines les plus vivantes de cette période. Après l’agrégation, je me suis intéressé à l’histoire de l’Italie au haut Moyen Âge, pour soutenir ma thèse de troisième cycle sur le cartulaire-chronique de Saint Clement de Casauria, en 1987. Je me suis ainsi orienté vers un sujet qui m’a amené un certain temps après à ma thèse d’habilitation sur les Abruzzes, habilitation finalement obtenue en 1996.
Qu’en est-il de vos publications ?
C’est un parcours qui est double. D’abord l’enseignement, et c’est par exemple Eglise et société en Occident (VII-XIe siècle), dans le cadre d’une commande de Jean-Louis Biget pour l’agrégation. Une expérience payante pédagogiquement. Le deuxième manuel, Paysans et seigneurs au Moyen Âge (VIIIe-XVe siècles), est lié à l’enseignement et au cœur même de ma recherche, c’est-à-dire une réflexion sur la production et la domination dans le monde rural entre le VIIIe et le XIVe siècle. L’idée étant de faire une histoire sociale et économique, de comprendre les conditions de la croissance et de l’apparition des crises. Il y a eu ensuite le moment, important, de la préparation de l’agrégation quand j’étais à Marne-la-Vallée, ce qui a amené à notre ouvrage avec Bruno Judic [Les sociétés du haut Moyen Âge en Occident]. Nous avions traduit de nombreux textes, et cela nous a semblé être une bonne idée de les regrouper dans un ouvrage. L’autre volet de mes publications, outre l’édition de ma thèse sur les Abruzzes au Moyen Âge, ce sont les articles et communications faites à des colloques. Nous travaillons beaucoup en équipe, en groupes de recherches : une part non négligeable de notre production se retrouve ainsi dans les Actes de colloques auxquels nous avons participé voire que nous avons organisés. Dans mon cas, deux groupes de travail sont marquants : celui sur l’économie et la société à l’intérieur duquel nous avons produit, par exemple, l’étude collective sur le marché de la terre au Moyen Âge ; celui sur le haut Moyen Âge, qui a connu deux programmes successifs, les transferts patrimoniaux et les élites. Actuellement, je travaille, toujours au sein d’un collectif, sur les questions liées à l’échange marchand au Moyen Âge. Enfin, pour revenir sur les manuels, et en particulier sur Paysans et Seigneurs, je me suis efforcé de leur donner un ton et une tournure qui les rapprochent de l’essai et en fassent des objets un peu différents de simples manuels. Il ne s’agissait pas tant de proposer une doctrine que de présenter des problèmes.
Les sociétés du haut Moyen Âge en Occident : « un ouvrage d’anthropologie historique »
Ce volume est construit de façon originale.
En effet. Nous avons beaucoup réfléchi sur la construction avec Bruno Judic, qui travaille comme moi avec une approche anthropologique des questions historiques. Et c’est finalement bien un ouvrage d’anthropologie historique : les textes ne sont pas classés chronologiquement, mais selon une problématique, s’intéressant à l’ensemble du fonctionnement des sociétés en question. Mais cela reste un recueil de documents destiné à un public étudiant.
Est-ce un ouvrage qui peut être utile aux étudiants que vous avez en ce moment à l’Université ?
Certainement. Il s’agissait de donner des outils permettant d’approcher l’histoire du haut Moyen Âge en privilégiant une approche anthropologisante ou sociologisante. Ce n’est pas beaucoup plus difficile qu’une approche événementielle ou strictement politique et c’est tout de même un peu plus excitant. Il faut cependant faire l’effort d’admettre que les faits ne sont pas des objets donnés mais que, pour les comprendre, il faut construire une réflexion méthodologique. Mais, après tout, c’est le fondement même de la science historique depuis le positivisme. Il est cependant nécessaire, parfois, de faire des détours théoriques pour lesquels nos étudiants ne sont pas nécessairement très bien armés. C’est pourquoi la division de la matière de cet ouvrage à l’aide de critères empruntés à l’anthropologie peut permettre d’ouvrir des voies de réflexion. Cela dit, ce n’est pas facile et requiert un effort réflexif particulier.
Comment avez-vous abordé votre thèse de troisième cycle ?
Celle-ci portait sur le cartulaire-chronique de San Clemente a Casauria, une abbaye des Abruzzes. Le document datait des années 1180 et renfermait une documentation abondante et continue des années 820 à 1170, à peu près. C’est la source essentielle, mais pas unique, de l’histoire de la région au Moyen Âge. J’ai été, en le découvrant, confronté à un problème important, celui d’avoir une source unique pour traiter d’une histoire régionale. C’était un cartulaire très complexe, l’un des plus gros que l’Italie centrale avait produit, mais dont on ne savait pas comment il avait été constitué. J’ai donc essayé de comprendre comment la documentation se présentait dans le monastère au XIIe siècle, de savoir quel degré d’adhésion au réel avaient les documents –très nombreux- du IXe siècle. Comment ces derniers ont-ils été transmis, transformés, comment sont-ils utilisables maintenant ? C’était la question fondamentale de ma thèse : comment se servait-on de l’écrit pragmatique dans les sociétés du XIIe siècle ? Une question devenue centrale aujourd’hui dans l’histoire économique, sociale et politique du Moyen Âge. Ce n’est qu’après avoir mené à bien cette démarche que j’ai entrepris de traiter les documents du cartulaire, parce qu’il fallait avoir d’abord un regard critique sur la source avant même de pouvoir en parler.
« Un rôle de coordinateur »
Sur quoi portent vos recherches actuelles ?
Je continue de travailler sur des dossiers que je constitue, mais je suis surtout amené à définir et organiser des programmes de recherches dans lesquels je joue un rôle de coordinateur, plus que de producteur. Cela ne fait que s’accentuer (ou s’aggraver) depuis que j’ai pris la direction du Lamop (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, UMR 8589) l’an passé. Ainsi, il y a quelques années, j’ai dirigé, en collaboration avec Chris Wickham et Monique Bourin, une recherche sur le marché de la terre, centre de la problématique que j’avais traitée dans ma thèse d’habilitation. Cela concernait les problèmes d’échanges à l’intérieur des sociétés médiévales, et la question particulièrement complexe de la formation du prix. Après cela, j’ai lancé le programme sur la circulation des richesses au Moyen Âge ; nous avons par exemple fait un colloque sur les conversions de redevances, appelé « Calcul et rationalité dans la seigneurie médiévale ». Comment s’y prenait-on pour évaluer, pour convertir une chose en une autre chose ? Se sont posé un problème de périodisation, et un problème économique : à un moment, les seigneurs choisissent délibérément de passer des redevances en nature aux redevances en argent, et l’inverse. Quelle logique y a-t-il ? Le point de départ est très connu : l’Angleterre de la fin du XIIe siècle, quand on abandonne le régime de la ferme pour le régime domanial, avec tout ce que cela implique en matière de mobilisation de l’écriture. Les seigneurs n’étaient pas seulement des acteurs passifs, mais également des agents qui prenaient des décisions en fonction d’informations disponibles, par exemple la perception de l’existence de l’inflation. Le seigneur était ainsi amené à intervenir lui-même sur le marché.
Pour donner suite à ce programme, nous avons ensuite essayé de construire une anthropologie des choses, avec toujours en tête cette idée de la conversion : on peut convertir en valeur, mais aussi en usage. Comment la terre se transforme en pouvoir ? Ou comment un objet d’usage courant peut-il devenir un objet sacré ? Il y a l’exemple des bacini, importés en Italie après le sac de Mahdiya (1087), des céramiques de luxe à usage domestique qui deviennent « sacrées » en étant collées sur la façade de l’église à Pise. Nous nous sommes ensuite intéressés à la circulation des objets dans le colloque « Les objets sous contrainte », toutes les formes de circulation forcées comme le pillage, la saisie, etc, comment les objets circulaient en dehors du marché. Le programme suivant a abordé le problème de l’expertise au Moyen Âge, une recherche sur trois ans : dans quelle mesure a-t-on besoin des experts ? Qui sont-ils ? Quels sont les écrits d’expertise dont nous disposons ? Des thèmes qui nous rapprochent de problématiques juridiques. Mon dernier projet, pour la réalisation duquel j’ai été nommé à l’IUF, porte sur la dialectique des échanges, c’est-à-dire sur l’opposition échanges commerciaux-échanges non commerciaux au Moyen Âge. Je suis en train de mettre la dernière main à un article sur la formation des prix au haut Moyen Âge.
« La vulgarisation : un problème de communication »
Que pensez-vous de la vulgarisation de l’histoire ? Comment rendre cette discipline plus abordable par le plus grand nombre ?
La vulgarisation est quelque chose qui fonctionne à plusieurs niveaux. C’est avant tout un problème de communication. Nos choix professionnels fragmentent nos champs de compétence, nous communiquons par groupes qui éditent des colloques où chacun apporte sa contribution par des articles. Mais le public est extrêmement limité, ceux qui étaient au colloque, plus une frange de gens « informés ». L’offre de savoir est de ce fait limitée. Nous n’utilisons pas assez les revues, certaines ont même des difficultés à trouver de la copie. J’ai donc décidé de réorienter mon travail vers cette communication savante, mais à destination non pas d’un public d’hyper-spécialistes, mais de gens intéressés, la communauté historienne au sens large. Il faut trouver un endroit où la production érudite soit accessible au plus grand nombre.
Et pour ce qui concerne ce qu’on appelle « le grand public » ?
C’est un deuxième niveau, celui des manuels par exemple. J’en ai fait deux, et cela prend du temps. Certains transforment leurs cours en manuel, même s’il vaut mieux le faire après pour éviter que les étudiants se contentent du livre…Il y a ensuite la participation à des revues comme L’Histoire, ce qui prend également du temps ; j’ai d’ailleurs fait un article sur les faux monnayeurs il y a quelques années. Là, c’est un type d’écriture particulier pour lequel on a ou on n’a pas de charisme. Il faut de plus pouvoir aborder le problème de manière attractive, ce qui n’est pas toujours facile. Je remarque surtout qu’il est difficile de faire passer notre discours, pas seulement au grand public, mais aussi aux professeurs du secondaire, pour qu’ils puissent suivre l’évolution de la recherche et trouvent une stimulation intellectuelle à le faire ! Là, notre responsabilité pédagogique est très grande et je ne suis pas sûr que nous sachions bien le faire.
On le voit par exemple avec les cours de cinquième sur « Paysans et seigneurs », et l’étude d’une seigneurie…
Oui, c’est très compliqué de renouveler la façon d’aborder ce genre de sujet, surtout avec de moins en moins d’heures disponibles. La seigneurie présentée dans le secondaire est pourtant un concept approximatif et dont la définition est en train d’évoluer, du simple fait de l’approfondissement des discussions à l’intérieur de l’historiographie européenne. Il est fascinant de voir que le concept n’est pas le même en France, en Italie, en Grande-Bretague et en Allemagne, alors que les rapports de pouvoir et les structures de la domination sociale n’y sont pas fondamentalement différentes.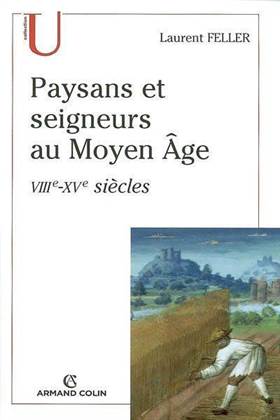
Il faudrait en fait partir de l’époque carolingienne, dire que la seigneurie était déjà là avec le grand domaine. Et évoquer toute la propriété foncière non seigneuriale, extrêmement importante, pour ensuite expliquer tous les processus de domination sociale. La seigneurie ne serait ainsi plus l’élément de base. Le problème est en fait celui de l’exploitation du sol, plus que de la propriété.
Quel est votre avis sur internet, son utilisation pour la recherche et par les étudiants ?
C’est d’abord un outil de travail qui nous met en communication avec des bibliothèques. Cela permet de télécharger des articles ou d’avoir accès à des dictionnaires indispensables, aux MGH,…On y gagne un temps précieux. Le deuxième aspect est celui de la communication avec les étudiants : à Paris I, l’epi [espace pédagogique interactif] est quelque chose de très pratique pour fournir aux étudiants un powerpoint (ou d’autres choses) projeté en cours. Il faut toutefois faire attention à la transmission de ces documents, quand on utilise par exemple ceux d’un autre, ce qui peut poser un cas de déontologie. Les étudiants connaissent le même problème, avec des sites comme Oboulo.com, qui fournissent des exposés clé en main, mais tirés souvent de cours. Enfin, il y a wikipedia : l’accès à une information non fiable, mais très rapide et facile à obtenir. Nous mettons en garde les étudiants sur ce danger, et sur celui du copier-coller.
On a parfois l’impression que les gens ont moins de recul critique par rapport à internet que pour d’autres sources d’informations, et qu’ils se fient uniquement au classement google…
Oui, il y a un problème de hiérarchisation du savoir. Comment classer l’information en fonction de la valeur attribuée à la source ? Tout ne se vaut pas. La démarche historienne consiste, précisément, à construire un regard critique et à apprendre à porter un jugement sur la valeur d’une source ou d’une information : la distinction entre le vrai et le faux, entre l’authentique et la copie, le document sincère et celui qui ne l’est pas, tout cela a des incidences immédiates dans la vie intellectuelle, voire dans notre vie quotidienne et dans notre vie de citoyen
Paris I a mis en place cette année des enseignements dès le L1 pour insister sur la lecture critique, mais également l’écriture.
C’est une initiative des maîtres de conférences d’histoire du Moyen Âge, liée à la réorganisation des enseignements et au fait que, désormais, l’histoire médiévale est enseignée en S1 (donc au sortir du bac) et en S4 (donc juste avant de passer en licence). Ils ont bouleversé leurs pratiques pédagogiques pour introduire une maîtrise plus grande de l’écrit en histoire. Ils contraignent aussi leurs étudiants à lire beaucoup d’articles et à exercer leur esprit critique. La L1 est une étape importante, on y récupère les gens qui sortent du bac ; c’est donc un public très divers qu’il faut former, auquel il faut adapter nos méthodes d’enseignement. Le but étant de leur apporter un savoir académique. Ce type d’initiative pédagogique a souvent été le fait des médiévistes à Paris I, il y a une tradition depuis les années 70, et un véritable renouveau qui s’opère en ce moment même.
« La plus importante réforme de structure depuis le début des années 70 »
Comment vivez-vous, en tant qu’enseignant-chercheur, la réforme qui touche l’Université depuis la loi LRU ?
Il y a un sentiment d’irréversible. C’est sans doute la plus importante réforme de structure depuis le début des années 70. Quelque chose s’est mis en marche, pour le bien ou pour le mal, mais je ne crois pas nécessairement pour le bien…Il sera toutefois difficile de revenir dessus, car il y a globalement un consensus au sein des politiques. Que cela change-t-il pour notre quotidien ? La loi a induit des modifications importantes dans le mode de gouvernement des Universités. Le passage aux compétences élargies et donc l’autonomie financière des Universités pose des problèmes matériels complexes qu’il faut résoudre au fur et à mesure qu’ils se posent. Cela va créer des situations de contrainte considérables, d’abord au niveau administratif puis au niveau pédagogique.
Qu’est-ce que ça change concrètement ? Y a-t-il, par exemple, une conséquence sur les masters recherche ?
On ne sait pas encore, il est trop tôt pour le dire. Nous pourrons faire un premier bilan dans deux ans. Mécaniquement, cela devrait vider les masters recherche mais, dans une maison comme Paris I, nous avons des étudiants qui préfèrent terminer d’abord un master recherche, puis tenter les concours de recrutement. Ailleurs, le calcul sera plus « il faut faire vite pour avoir un salaire rapidement ». Et la mastérisation, qui impose une année supplémentaire, aggrave bien des situations. Je pense qu’au bout du compte les étudiants reviendront vers nous, accepteront une année d’études supplémentaire. Et il ne faut pas non plus oublier les masters professionnels.
La mastérisation, justement, qui touche la formation des enseignants.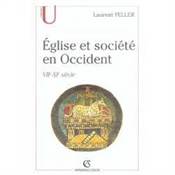
Oui. Les concours ne sont sans doute pas amenés à disparaître, mais on semble se diriger vers un système de recrutement où le niveau territorial acquerrait un rôle accru. L’existence de masters « enseignement » va créer une catégorie nouvelle, celle des diplômés d’un master pro collés au concours et donc sans situation autre que celle de vacataire. C’est un problème lourd qui risque de mettre le système de recrutement sous tension. D’autre part, l’absence de formation initiale est un retour en arrière. Même si les IUFM avaient des défauts (et on remarquera que les anciens élèves de ces institutions leur sont extrêmement peu attachés), ils remplissent une fonction utile, voire indispensable, ne serait-ce que pour opérer la bascule entre la vie étudiante et la vie professionnelle. L’institution scolaire est, d’autre part, très complexe et une information structurée, construite et dispensée par des professionnels risque d’être plus efficace qu’une formation sur le terrain. Il est d’autre part illusoire, dans l’état actuel des choses, de penser que cette connaissance pourrait être acquise durant les études universitaires, c’est-à-dire durant le parcours académique des étudiants. A moins de créer des filières dès le L1, ce qui serait évidemment dommageable. L’une des grandes forces du système ayant existé jusqu’à présent était de restreindre le chômage intellectuel tout en donnant un métier honorable et une situation sociale aux lauréats des concours. C’est cela qui change à toute vitesse, autant du fait de la perception du métier d’enseignant par le corps social que du fait de la dégradation objective des conditions d’exercice. La désillusion et l’amertume sont le grand risque de ce métier.
Pour terminer, que pensez-vous de l’image actuelle du Moyen Âge ?
Le Moyen Âge semble avoir cessé de fasciner autant qu’il l’a fait voici 20 ou 30 ans, au moment des grandes entreprises éditoriales menées par Duby, Le Goff ou Fossier. Il attire peut-être moins mais, en même temps, son étude s’est considérablement complexifiée, du fait de l’intrusion des problématiques anthropologiques et sociologiques. Nous pratiquons de manière systématique une véritable interdisciplinarité, ce qui nous rend peut-être un peu compliqués à aborder. Cela dit, les modernistes suivent le même chemin, et même avec de l’avance sur nous.
L’une des difficultés que nous rencontrons est de montrer ce qu’est une société chrétienne, à un moment où les problèmes religieux ont largement cessé d’être compris. Beaucoup d’étudiants de licence n’ont plus les connaissances de base, comme la Trinité par exemple, et c’est problématique quand on étudie le Moyen Âge occidental ! On enseigne peut-être plus facilement l’islam comme objet historique, car on a plus la possibilité d’être « à l’extérieur », même si c’est en train de devenir un objet politique. Notre rapport à la foi chrétienne est bien plus conflictuel, puisque l’Eglise catholique est restée une structure d’oppression très longtemps, et qu’il y a donc toujours un peu de lutte politique quand on aborde ces sujets. Traiter une religion comme un objet historique provoque toujours des réactions. Or, la question religieuse est au cœur des problèmes de l’histoire du Moyen Âge, non pas tant pour des raisons institutionnelles parce que l’Église occupe une place centrale, que pour des raisons idéologiques au sens propre. L’enseignement de l’Église catholique, seul producteur d’idées durant près de 1000 ans, rappelons-le, a eu une efficacité et a véritablement modelé les comportements. Par exemple, il existe en matière économique, une morale de l’action tout à fait particulière, dont la construction s’opère à travers les règles monastiques et qui ont des incidences sur toute la vie économique médiévale. L’objet scientifique que nous sommes en train de construire semble ainsi s’éloigner des préoccupations immédiates de nos contemporains, un peu à la façon dont la musique savante contemporaine s’est éloignée des désirs immédiats de la société. C’est contre cela, évidemment, qu’il faut lutter en s’efforçant d’établir des ponts entre les producteurs d’histoire savante et le public le plus large possible.
Merci beaucoup.
Laurent Feller est professeur d’histoire médiévale à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il dirige actuellement le Lamop (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, UMR 8589). Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), ancien membre de l’Ecole Française de Rome, il a entre autres publié :
- Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIe siècle, Rome, 1998 (Bibliothèque des Ecoles française d’Athènes et de Rome, n°300)
- Eglise et société en Occident (VII-XIe siècle), Armand Colin, 2004 (rééd).
- En collaboration avec Agnès Gramain et Florence Weber, La fortune de Karol. Marché de la terre et liens personnels dans les Abruzzes au haut Moyen Âge, Rome, 2005 (Collection de l'EFR, n°347).
- Calculs et rationalités dans la seigneurie médiévale : les conversions de redevances entre XIe et XVe siècles. Actes de la table ronde organisée par le Lamop à Auxerre les 26 et 27 octobre 2006, L. Feller éd., Paris, 2009.
- Paysans et seigneurs au Moyen Âge (VIIIe-XVe siècles), Armand Colin, 2007.
- Les sociétés du haut Moyen Âge en Occident (en collaboration avec Bruno Judic), Publications de la Sorbonne, 2010.

