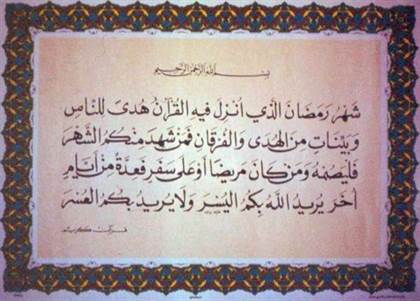 Le statut de dhimmi charrie avec lui nombre de fantasmes opposés : certains y voient la preuve d’une grande tolérance des musulmans envers les non-musulmans, allant jusqu’à une idéalisation transposée à la période tout aussi fantasmée d’Al Andalus ; d’autres y voient la preuve d’une volonté des musulmans d’assimiler petit à petit les non-musulmans, les poussant à se convertir pour sortir de ce statut de minorité. Evidemment, c’est bien plus complexe.
Le statut de dhimmi charrie avec lui nombre de fantasmes opposés : certains y voient la preuve d’une grande tolérance des musulmans envers les non-musulmans, allant jusqu’à une idéalisation transposée à la période tout aussi fantasmée d’Al Andalus ; d’autres y voient la preuve d’une volonté des musulmans d’assimiler petit à petit les non-musulmans, les poussant à se convertir pour sortir de ce statut de minorité. Evidemment, c’est bien plus complexe.
Les origines, du Coran à la Sunna
La dhimma est « un contrat indéfiniment reconduit par lequel la communauté musulmane accorde hospitalité et protection aux membres des autres religions révélées, s’ils respectent la domination de l’islam » (cf Encyclopédie de l’Islam).
Le Coran est la base (avec la Sunna) des dispositions juridiques qui vont mener à la shari’a (Loi islamique) et donc entre autres au statut de dhimmi. Dans le Coran, pour définir les chrétiens et les juifs, il ne faut pas perdre de vue que l’avis dépend et varie selon les circonstances et les événements vécus par le Prophète, c’est-à-dire ses relations avec les uns et les autres au fil de la Révélation. Le Coran s’avère relativement tolérant (ou selon les interprétations « résigné » devant ce qui l’a précédé) envers le pluralisme religieux, comme l’atteste la sourate II, 256 : « Pas de contrainte en religion ! » ou la sourate CIX, 6 : « A vous votre religion ; à moi ma religion ». Mais cette attitude ne s’applique qu’aux Gens du Livre, les ahl al-Kitab, c’est-à-dire chrétiens, juifs et les mystérieux sabéens. Nous le voyons à la sourate II, 62 : « Ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont Chrétiens ou Sabéens, ceux qui croient en Dieu et au dernier jour, ceux qui font le bien : voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n’éprouveront plus alors aucune crainte, ils ne seront pas affligés ».
Bien sûr, ce point de vue évolue avec les rencontres de Mahomet et ses contacts de plus en plus fréquents et conflictuels avec les chrétiens et surtout les juifs ; ainsi, entre autres sourates hostiles, la V, 51 : « Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour amis les Juifs et les Chrétiens ; ils sont amis les uns des autres. Celui qui, parmi vous, les prend pour amis est des leurs. –Dieu ne dirige pas le peuple injuste- » et surtout la sourate IX, 29 : « Combattez […] ceux qui, parmi les Gens du Livre, ne pratiquent pas la vraie Religion. Combattez-les jusqu’à ce qu’ils payent directement le tribut (djizya) après s’être humiliés ». En effet, c’est cette dernière sourate qui va être directement à l’origine de la dhimma et de sa base, le paiement de l’impôt de capitation, la djizya, sur lequel nous reviendrons.
Les actes du prophète sont eux aussi décisifs. Après l’Hégire, Mahomet tente de convertir les juifs de Médine ; les trois tribus sont vaincues, deux ont le choix entre conversion et exil, une troisième (les Banu Quraysa) entre conversion et mort. Il y a ensuite, et surtout, la conquête en l’an 7 de l’Hégire (629) de l’oasis de Khaybar, avec le premier cas de soumission d’une tribu juive à l’islam : les juifs seront « protégés » (dhimmis) par les Musulmans, mais doivent leur verser la moitié de leur récolte. C’est sans doute le premier cas de « tribut » (référence à IX, 29) et donc aussi l’une des sources de la dhimma. Pour les chrétiens, les relations sont moins nombreuses et moins conflictuelles, ils sont ainsi mieux vus que les juifs, comme le montre la sourate V, 82 : « Tu constateras que les hommes les plus hostiles aux croyants sont les Juifs et les polythéistes. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants par l’amitié sont ceux qui disent : « Oui, nous sommes Chrétiens » […] ». Mahomet passe par exemple des accords avec les chrétiens de Nadjran. Pourtant, il nous faut noter que par la suite, la distinction entre les deux ne sera plus de mise au sujet de la dhimma, et que même la vision qu’auront les Musulmans vis-à-vis des juifs et des chrétiens aura tendance à s’inverser, à cause des affrontements entre Islam et Occident chrétien.
On le voit, le point de vue du Coran et de la Sunna sur chrétiens et juifs est contrasté : ils sont plus respectés que les polythéistes, les païens ou les athées, car considérés comme des « Gens du Livre », mais ils le sont également comme hérétiques, indignes de confiance et dans l’erreur, qu’il faut soumettre absolument.
L’évolution juridique de la dhimma
Il existe d’autres sources qui ont contribué à mettre en forme le statut de dhimmi ; on doit citer le « Pacte d’Umar » pour commencer. La tradition en fait l’origine de la dhimma, à partir d’un événement qui aurait concerné le deuxième calife, Umar (634-644), et des chrétiens de Syrie. Ceux-ci lui auraient adressé une lettre où ils donnaient les conditions de leur soumission ! Ce document est sans doute apocryphe, car on voit mal les vaincus imposer leurs conditions...D’ailleurs, la trace de ce pacte n’intervient qu’au XIè siècle. Plus véridique sans doute sont les dispositions à l’égard des dhimmis prises par l’omeyyade Umar II (717-720) : celui-ci aurait introduit les différences au niveau vestimentaire, ou encore la défense de monter un cheval, de porter des armes,…Des mesures qui prirent par la suite valeur de Loi. On peut citer aussi le mystérieux Edit du Prophète aux Chrétiens, qui fait sans doute référence aux accords avec les chrétiens de Nadjran.
Quoiqu’il en soit, les différentes versions et applications nous permettent de définir les modalités de la dhimma. Il faut d’abord insister sur la symbolique : nous l’avons vu plus haut, l’une des sourates ayant inspiré le contrat (IX, 29) insiste sur le caractère humiliant de la dhimma et du paiement du tribut. Selon l’exégète Mahmud ibn ‘Umar al-Zamakhshari (1075-1144), « le recouvrement de la djizya doit s’accompagner de mépris et d’humiliation. [Le dhimmi] viendra en personne, à pied et non à cheval. Pour payer, il se tiendra debout, tandis que le percepteur restera assis. Le percepteur l’empoignera par le collet et le secouera en lui disant : « Acquitte-toi de la djizya ! » ; et quand il aura payé, il lui donnera une tape sur la nuque. » D’autres sources exigent que le dhimmi se présente dos courbé, que le percepteur le traite avec dédain et mépris, ou que la main du dhimmi se trouve en dessous de celle du percepteur au moment de l’échange.
Pourtant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité, en particulier au sein des juristes. Ceux-ci sont avant tout intéressés par le paiement de la djizya ; ainsi, Abu ‘Ubayd (770-838) dans son Traité sur les impôts (Kitab al-Amwal) affirme qu’on ne doit « pas imposer les dhimmis au-delà de leurs capacités, ni leur infliger des souffrances. » De même Abu Yusuf (731-808), qadi d’Harûn al-Rashîd (786-809) dans son Kitab al-Kharaj : « Aucun ressortissant de la dhimma ne sera battu afin d’exiger de lui le paiement de la djizya ; on ne le fera pas attendre sous la chaleur ardente du soleil, on ne lui infligera pas de châtiments corporels haïssables, ni d’autres sévices du même genre. Il convient, au contraire, de le traiter avec clémence. » En revanche, un dhimmi qui n’aura pas payé la djizya sera bien sûr sévèrement puni, et devra la payer. Ce même Abu Yusuf insiste sur l’interdiction de traiter le dhimmi comme du butin, mais pour des raisons plus pragmatiques qu’humanistes : « Dès lors [quand ils ont payé le tribut], tu n’as plus aucun titre ni aucun droit sur eux. Pense donc ! Si nous les prenons et les distribuons, que restera-t-il aux musulmans qui viendront après nous ? » L’impôt de capitation est, on le voit, primordial. D’origine coranique (IX, 29), la djizya est un impôt de capitation qui s’ajoute au kharadj (impôt foncier).
D’après la source juive de la Geniza du Caire (XIè), c’est un impôt qui peut être lourd, surtout pour les classes les plus pauvres. Elle est supprimée en cas de conversion. Elle est perçue régulièrement depuis les Abbassides et s’applique sur les mâles, valides, libres, capables et donc pas aux femmes (sauf veuves propriétaires sous les Ottomans) ni aux vieillards. Les moines sont exemptés pendant longtemps. Elle doit être versée en argent, de la main à la main, chaque année lunaire.
Quelles sont les autres principales dispositions juridiques ? Un musulman peut épouser une dhimmie, mais un dhimmi ne peut épouser une musulmane ; un dhimmi ne peut posséder d’esclave musulman, mais un musulman peut posséder un esclave dhimmi. En ce qui concerne la justice, le dhimmi peut être jugé par les siens (droit interne) sauf si un musulman est concerné ; il peut aussi demander l’arbitrage d’un juge musulman, mais ce sera bien sûr la Loi islamique qui sera appliquée. Dans ce cas, le témoignage d’un dhimmi n’était pas recevable et le prix du sang (diya) d’un dhimmi était inférieur à celui des musulmans (sauf pour l’école hanafite). Pour les droits de succession : un musulman ne peut hériter d’un dhimmi, ni l’inverse (même si sur le premier point, les sources divergent) ; une disposition critiquée par certains oulémas et surtout par les chiites, qui veulent insister sur l’inégalité entre musulman et dhimmi. Le dhimmi doit aussi respecter l’islam, ne pas faire de prosélytisme, ne pas être ostentatoire dans la pratique de son culte (cloches, processions,…).
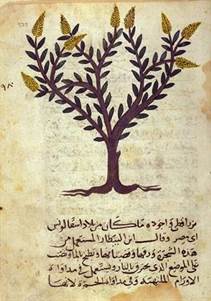 Enfin, nous l’avons déjà évoqué, certaines différences vestimentaires et de comportement étaient imposées. Etant plus liées au contexte qu’à une base juridique, nous le verrons dans la partie suivante. La dhimma, qui prend donc son origine dans le Coran, la Sunna et les interprétations d’exégètes et juristes, est pour résumer un contrat basé sur une inégalité face à l’impôt et au droit, chose que l’on retrouve tout au long de l’Histoire, à la différence de ce que nous allons voir par la suite.
Enfin, nous l’avons déjà évoqué, certaines différences vestimentaires et de comportement étaient imposées. Etant plus liées au contexte qu’à une base juridique, nous le verrons dans la partie suivante. La dhimma, qui prend donc son origine dans le Coran, la Sunna et les interprétations d’exégètes et juristes, est pour résumer un contrat basé sur une inégalité face à l’impôt et au droit, chose que l’on retrouve tout au long de l’Histoire, à la différence de ce que nous allons voir par la suite.
Les bases coraniques et juridiques de la dhimma posées, il faut insister à présent sur le contexte de son application. En effet, c'est ce dernier qui a le plus conditionné les relations entre musulmans et Gens du Livre, en particulier dans les périodes de persécutions, souvent apparues durant des temps où l'Islam se sentait en danger. Nous pourrons peut-être ainsi, après avoir abordé tant les bases que l'application de la dhimma, sortir des clichés "positifs" ou "négatifs" sur ce statut original à plus d'un titre.
Dhimmis et Musulmans : du temps du Prophète aux conquêtes
On a déjà parlé des relations du Prophète avec les juifs et les chrétiens, et vu qu’elles avaient été de plus en plus conflictuelles au fur et à mesure que Mahomet étendait son influence et tentait de convertir ceux qu’il rencontrait. Il en va différemment de ses successeurs, à l’exception d’Umar qui aurait voulu appliqué la Sunna : le Prophète avait ainsi, selon elle, déclarer sur son lit de mort : « Deux religions ne doivent pas coexister dans la péninsule arabique ». Umar décide alors d’expulser juifs et chrétiens du Hedjaz. Mais, dans les faits, il y aura encore une présence de ces deux confessions dans la péninsule : ainsi, c’est un chrétien qui assassine Umar ; la police de Mu’awiya (fondateur de la dynastie omeyyade) est constituée de chrétiens ; et il y aura encore longtemps des juifs jusqu’au Yémen…En revanche, leur présence (juifs comme chrétiens) sera strictement interdite dans les Lieux Saints d’Arabie.
La conquête s’avère relativement facile ; en effet, les peuples conquis, en particulier chrétiens, ne voient pas les musulmans comme une menace et parfois se trouvent libérés du joug byzantin ! On assiste même à des vagues de conversion. Mais les conquérants sont toujours très minoritaires, et s’impose alors la nécessité d’une occupation et d’une attitude souples vis-à-vis des peuples conquis. C’est ici que germe le contrat de la dhimma. Aidé par le préjugé favorable des autochtones, il est lié au début à des obligations de logement, de ravitaillement, parfois d’espionnage ; c’est d’ailleurs l’une des premières raisons de l’interdiction pour les dhimmis de s’habiller comme les Arabes. Les musulmans ont aussi une difficulté à surmonter : la gestion de l’immense territoire conquis.
C’est pourquoi ils n’hésitent pas à conserver à leur poste ou à employer des dhimmis dans l’administration, y compris à des niveaux élevés (même si c’est relativement rare) ; on peut voir un vizir dhimmi, même si cela doit être à des tâches d’exécution et pas de décision. Mais le fait d’employer des dhimmis provoque un débat au sein des musulmans, et ce dès Umar, en tout cas selon la tradition. Celui-ci aurait déclaré : « Garde-toi de nommer un juif ou un chrétien à une charge publique car, par leur religion, ce sont des gens de corruption. ». Mais le débat montre justement l’importance et la nécessité de ces dhimmis, avec une anecdote encore liée à Umar : celui-ci rend visite au gouverneur de Kufa, Abu Musa qui dit à son calife que son secrétaire est chrétien ; Umar s’en offusque alors en citant le Coran (V, 51) : « Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens », ce à quoi Abu Musa répond : « Sa religion est à lui, son secrétariat est à moi ». En revanche, les dhimmis n’ont pas d’interdiction pour pratiquer d’autres métiers. On les retrouve ainsi en masse dans le commerce, la finance et dans les métiers mal considérés par les musulmans, comme la tannerie, la boucherie, le métier de bourreau…Ils sont aussi présents dans des domaines qui nécessitent des contacts avec des étrangers : la diplomatie, le courtage, la banque.
Pourtant, les premières tensions et discriminations réelles vont débuter dès le VIIIè siècle. A cette époque, l’Islam voit sa conquête stoppée. C’est sans doute l’échec de son prédécesseur devant Constantinople en 717 qui conduit Umar II (717-720) à adopter les premières vraies mesures discriminatoires envers les dhimmis. En effet, et ce sera encore plus le cas par la suite, la situation des dhimmis sera difficile à chaque fois que l’Islam sera en difficulté et qu’il y aura nécessité de « purifier » l’Empire musulman. Si les juristes et la pratique générale seront plutôt « laxistes », les théologiens et les califes les plus piétistes seront toujours plus violents envers leurs sujets non musulmans, et toujours à cause du contexte.
Des disparités nombreuses et variées
Le VIIIè siècle est déjà un tournant, en particulier en Orient. Umar II impose des vêtements différents aux dhimmis, l’interdiction de monter à cheval et de porter une arme. Il impose également le port de signes distinctifs comme la ceinture zunnâr, et l’interdiction de porter de beaux tissus. A la nécessité de distinguer musulmans et dhimmis pour des raisons de sécurité s’ajoute la volonté d’humilier les non musulmans. Il renforce également les contraintes fiscales. Ce durcissement continue sous certains de ses successeurs et aux siècles suivants : sous Yazid II (720-724), puis Harûn al-Rashid (786-809) qui lui aussi insiste sur les vêtements différents, par peur d’une tentative d’influence de l’Empire de Charlemagne…Al Mutawakkil (847-861) exclut les chrétiens de l’administration, et les oblige à porter des capuchons et des ceintures couleur de miel ; il rase aussi les églises nouvellement construites. Le point d’orgue est la persécution par al-Hakim (996-1021), qui va jusqu’à détruire le Saint Sépulcre à Jérusalem.
En fait, on note que les persécutions des dhimmis interviennent dans des contextes précis (et surtout en zone urbaine) : on l’a dit pour Umar II (échec devant Constantinople) et c’est le cas pour quelques-uns de ses successeurs, mais c’est à la fois le danger sur l’Islam et le basculement démographique qui l’expliquent. En danger, les Musulmans reviennent aux bases de leur religion et « purifient » le dar al-Islam ; il est donc logique que ce soit les dhimmis qui souffrent en premier. Ensuite, dès les IXè et Xè siècles, par le biais des conversions ou de la démographie, les musulmans se retrouvent majoritaires et ont donc moins besoin, et moins de crainte vis-à-vis des non musulmans.
Enfin, pour aggraver le tout, il y a les relations avec les ennemis extérieurs de l’Islam : c’est en Occident la Reconquista espagnole, et en Orient les Croisades ; à cela s’ajoute une crise économique qu’il ne faut pas négliger. C’est à ce moment que, globalement, l’attitude des musulmans vis-à-vis des juifs et des chrétiens s’inverse. Alors que dans le Coran, les juifs -on l’a vu- sont moins considérés que les chrétiens, les événements à partir du XIè (prise de Tolède en 1085, et Première Croisade en 1095) vont faire de ces derniers les ennemis potentiels des musulmans, y compris dans le dar al-Islam. En Orient, les chrétiens de rite non latin demeurent relativement tolérés, à l’exception des coptes et des Arméniens qui commencent à subir des persécutions.
En Occident, les mozarabes sont soupçonnés de complicité avec les royaumes espagnols du Nord. C’est sous les dynasties Almoravides (1031-1147) et surtout Almohades (1147-1226) que les dhimmis souffrent le plus dans le Maghreb : les chrétiens disparaissent d’Afrique du Nord, les juifs sont cantonnés dans des quartiers spéciaux (mellâh, hâra), ce qui n’était pas le cas auparavant (ils n’étaient pas obligés de se regrouper, mais le faisaient la plupart du temps pour des raisons économiques). En Orient, la situation change selon la période : l’arrivée des Seldjukides au XIè siècle est un moment relativement calme, mais les Turcs emploient moins de dhimmis dans l’administration ; lors des Croisades, on l’a vu, la situation est compliquée et les dhimmis, chrétiens en particulier, sont entre deux feux ; l’invasion mongole du XIIIè siècle est en revanche temporairement profitable aux chrétiens…sans doute en abusent-ils car sous les Mamelouks, la répression des chrétiens maronites et coptes est féroce. Apparaît à l’époque la figure d’Ibn Taymiyya (1263-1328), qui influencera au XIXè le wahhabisme, et qui insiste lui sur le caractère vexatoire et humiliant du statut de dhimmi.
Reviennent alors durant toute cette période, les obligations et les discriminations : signes distinctifs jusque dans les bains ; taille des maisons différentes ; interdiction de construire des lieux de culte ou d’en rénover et parfois même destruction de ces lieux ; obligation des femmes dhimmies de ne pas être voilées,…
Il faut en fait attendre les XV-XVIè siècle et la consolidation de l’Empire ottoman pour voir la situation se stabiliser, voire s’améliorer. Les juifs expulsés d’Espagne par Isabelle de Castille sont accueillis en Turquie, et surtout au Maroc. Les chrétiens d’Orient ont résisté, en particulier en Egypte, et les nouveaux conquis de la Grèce et des Balkans ne subissent pas les mêmes persécutions…
La situation des dhimmis dans l’Empire musulman a donc grandement évolué, et a été parcourue de crises et de périodes plus tolérantes. Mais, à chaque fois, les périodes difficiles ont résulté d’un contexte particulier : attaques extérieures, regain piétiste, crise économique, évolution démographique.
Bibliographie non exhaustive
- D. SOURDEL, La civilisation de l'Islam classique, Arthaud, 1991.
- H. KENNEDY, The Prophet and The Age of The Caliphates, Longman, 1986.
- B. LEWIS, Islam, Gallimard, 2005.
- Encyclopédie de l'Islam, Brill, nouvelle édition.

