Histoire de France
 La France d’avant la France commence traditionnellement avec la conquête de la Gaule par Jules César et se poursuit avec les premiers personnages historiques : le roi des francs Clovis Ier, Pépin le bref et Charles Martel... Dès le milieu du Moyen Age, l’histoire de France se confond avec celle du royaume de France et une longue liste de monarques, de Charles VII à Louis XI, de François Ier à Henri IV, de Louis XIV à Louis XVI... Avec la Révolution de 1789 commence l’histoire d’une nation faite par des hommes et des femmes, des batailles et des tragédies, des moments de gloire mais aussi des heures sombres.
La France d’avant la France commence traditionnellement avec la conquête de la Gaule par Jules César et se poursuit avec les premiers personnages historiques : le roi des francs Clovis Ier, Pépin le bref et Charles Martel... Dès le milieu du Moyen Age, l’histoire de France se confond avec celle du royaume de France et une longue liste de monarques, de Charles VII à Louis XI, de François Ier à Henri IV, de Louis XIV à Louis XVI... Avec la Révolution de 1789 commence l’histoire d’une nation faite par des hommes et des femmes, des batailles et des tragédies, des moments de gloire mais aussi des heures sombres.
 Le Second Empire, dirigé par Napoléon III du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870, a succédé à l'éphémère IIe République. C'est une période de grand essor économique, notamment industriel, financier et bancaire, qui provoque des changements sociaux, tel le développement de la classe ouvrière. Après une phase autoritaire, marquée par la répression de l’opposition, se fait jour une certaine libéralisation du régime. Malgré plusieurs succès militaires et diplomatiques (guerre de Crimée, campagne d’Italie), l’échec de l’expédition mexicaine et surtout la défaite militaire face à la Prusse en 1870 entraînent la chute du second Empire.
Le Second Empire, dirigé par Napoléon III du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870, a succédé à l'éphémère IIe République. C'est une période de grand essor économique, notamment industriel, financier et bancaire, qui provoque des changements sociaux, tel le développement de la classe ouvrière. Après une phase autoritaire, marquée par la répression de l’opposition, se fait jour une certaine libéralisation du régime. Malgré plusieurs succès militaires et diplomatiques (guerre de Crimée, campagne d’Italie), l’échec de l’expédition mexicaine et surtout la défaite militaire face à la Prusse en 1870 entraînent la chute du second Empire.
 Les Celtes sont des peuples indo-européens originaires de la vallée du Danube, qui se sont installés dans une grande partie de l’Europe de l’Antiquité. Ces peuplades parlent la même langue, avec des variantes, et ont en commun certaines croyances religieuses. Ce sont les diffuseurs de la civilisation du fer en Europe occidentale. La plupart des historiens refusent de parler de civilisation celte, évoquant plutôt un monde celtique présentant des similitudes linguistiques et culturelles. Organisés en d’innombrables tribus et fédérations aux contours mouvants, les celtes de Gaule étaient des cultivateurs laborieux et ingénieux, mais aussi des guerriers farouches et des commerçants avisés, en contact avec le monde méditerranéen antique.
Les Celtes sont des peuples indo-européens originaires de la vallée du Danube, qui se sont installés dans une grande partie de l’Europe de l’Antiquité. Ces peuplades parlent la même langue, avec des variantes, et ont en commun certaines croyances religieuses. Ce sont les diffuseurs de la civilisation du fer en Europe occidentale. La plupart des historiens refusent de parler de civilisation celte, évoquant plutôt un monde celtique présentant des similitudes linguistiques et culturelles. Organisés en d’innombrables tribus et fédérations aux contours mouvants, les celtes de Gaule étaient des cultivateurs laborieux et ingénieux, mais aussi des guerriers farouches et des commerçants avisés, en contact avec le monde méditerranéen antique.
 Terme d'origine latine, l'oppidum est un village fortifié de la fin de l'âge du fer, de conception celtique, établi sur une hauteur. Simple refuge fortifié utilisé essentiellement en cas de danger, l'oppidum gaulois se transforme en véritable cité ou se développe le commerce et l'artisanat. Occupant la plupart du temps des positions stratégiques situées en hauteur, certains deviennent la capitale d'une des nombreuses tribus qui peuplent la Gaule : ainsi Bibracte, capitale des éduens située sur le mont Beuvray (Morvan). Deux autres places fortifiées, Gergovie et Alésia, seront au coeur de la guerre des Gaules menée par Jules César.
Terme d'origine latine, l'oppidum est un village fortifié de la fin de l'âge du fer, de conception celtique, établi sur une hauteur. Simple refuge fortifié utilisé essentiellement en cas de danger, l'oppidum gaulois se transforme en véritable cité ou se développe le commerce et l'artisanat. Occupant la plupart du temps des positions stratégiques situées en hauteur, certains deviennent la capitale d'une des nombreuses tribus qui peuplent la Gaule : ainsi Bibracte, capitale des éduens située sur le mont Beuvray (Morvan). Deux autres places fortifiées, Gergovie et Alésia, seront au coeur de la guerre des Gaules menée par Jules César.
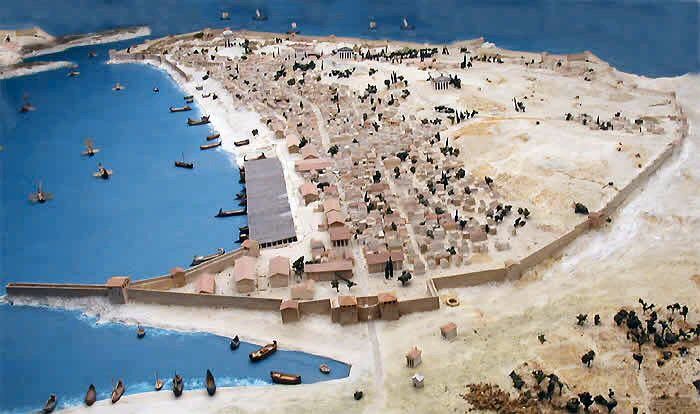 Massalia (aujourd'hui Marseille) a été fondée vers 600 avant J.C. par des Grecs venus de Phocée, en Asie mineure. C’est pour cette raison que Marseille est appelée la « citée phocéenne ». Cette colonie prospère, qui porte alors le nom de Massalia, a eu un destin particulier et une place à part dans l’histoire des Gaules et de la Méditerranée occidentale. Alliée de Rome contre Carthage, elle devient un foyer de peuplement pour les celtes de Gaule. Après avoir soutenu Pompée dans la guerre civile qui l’opposait à Jules César, la ville est annexée par ce dernier en 49 avant J.C. au sein de l’Empire romain, devenant Massilia.
Massalia (aujourd'hui Marseille) a été fondée vers 600 avant J.C. par des Grecs venus de Phocée, en Asie mineure. C’est pour cette raison que Marseille est appelée la « citée phocéenne ». Cette colonie prospère, qui porte alors le nom de Massalia, a eu un destin particulier et une place à part dans l’histoire des Gaules et de la Méditerranée occidentale. Alliée de Rome contre Carthage, elle devient un foyer de peuplement pour les celtes de Gaule. Après avoir soutenu Pompée dans la guerre civile qui l’opposait à Jules César, la ville est annexée par ce dernier en 49 avant J.C. au sein de l’Empire romain, devenant Massilia.
 A l'époque de la Gaule celtique, les arvernes étaient un peuple prospère et influent occupant la région actuelle de l'Auvergne. Ils sont essentiellement connus par le grand public à travers la figure de Vercingétorix et la fameuse bande dessinée Astérix dans lequel le héros éponyme part à la recherche du bouclier du grand chef « résistant ». Or, les Arvernes sont bien plus que ces images d'Épinal : ils ont été l'un des peuples les plus puissants des Gaules qui ont eu un rôle important bien avant la guerre menée par César.
A l'époque de la Gaule celtique, les arvernes étaient un peuple prospère et influent occupant la région actuelle de l'Auvergne. Ils sont essentiellement connus par le grand public à travers la figure de Vercingétorix et la fameuse bande dessinée Astérix dans lequel le héros éponyme part à la recherche du bouclier du grand chef « résistant ». Or, les Arvernes sont bien plus que ces images d'Épinal : ils ont été l'un des peuples les plus puissants des Gaules qui ont eu un rôle important bien avant la guerre menée par César.
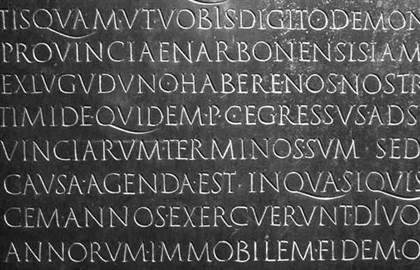 La conquête des Gaules par César en 51 av. J-C amène à leur provincialisation, et ainsi à leur intégration dans l’Empire, en particulier avec Auguste qui créé la Lyonnaise, l’Aquitaine et la Belgique, alors que la Transalpine est devenue la Narbonnaise. Qu’en est-il toutefois des élites gauloises ? Les notables ont-ils réussi eux aussi à s’intégrer aux élites impériales ? Quels sont leurs rapports avec Rome et l’empereur ?
La conquête des Gaules par César en 51 av. J-C amène à leur provincialisation, et ainsi à leur intégration dans l’Empire, en particulier avec Auguste qui créé la Lyonnaise, l’Aquitaine et la Belgique, alors que la Transalpine est devenue la Narbonnaise. Qu’en est-il toutefois des élites gauloises ? Les notables ont-ils réussi eux aussi à s’intégrer aux élites impériales ? Quels sont leurs rapports avec Rome et l’empereur ?
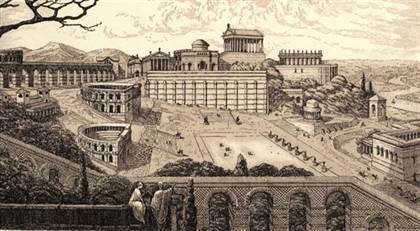 Après la conquête par Jules César, la Pax Romana s'impose dans la Gaule romaine, qui devient rapidement l’une des plus prospères provinces de l’Empire. Malgré quelques dernières révoltes, la "paix romaine" s’installe dès le principat d'Auguste et en deux siècles, le paysage de la Gaule se transforme. La campagne s’organise, le pays se pare de cités nouvelles, les architectes implantent routes et monuments. La romanisation semble acquise. Ces deux siècles de Pax Romana donnent une impression de prospérité : agriculture et artisanat se développent, les échanges sont fructueux. Pourtant de réelles difficultés apparaissent peu à peu, signes avant-coureurs des grandes crises ultérieures.
Après la conquête par Jules César, la Pax Romana s'impose dans la Gaule romaine, qui devient rapidement l’une des plus prospères provinces de l’Empire. Malgré quelques dernières révoltes, la "paix romaine" s’installe dès le principat d'Auguste et en deux siècles, le paysage de la Gaule se transforme. La campagne s’organise, le pays se pare de cités nouvelles, les architectes implantent routes et monuments. La romanisation semble acquise. Ces deux siècles de Pax Romana donnent une impression de prospérité : agriculture et artisanat se développent, les échanges sont fructueux. Pourtant de réelles difficultés apparaissent peu à peu, signes avant-coureurs des grandes crises ultérieures.
 À l’époque gauloise, les éduens étaient un peuple celte qui occupait la région de l'actuelle Bourgogne avec pour capitale Bibracte, sur le mont Beuvray. L’évocation de « nos ancêtres les Gaulois » déclenche de nos jours à coup sûr une polémique, et l’enseignement de leur histoire (et par leur biais, de la nôtre) est souvent caricaturé. Pourtant, nous savons aujourd’hui que les Gaulois étaient pluriels, tant dans leurs structures que dans leurs rapports avec Rome, mais aussi entre eux, et que cette pluralité est peut-être aussi l’une des richesses de nos « racines ». Les Eduens étaient l’un de ces peuples, singulier en de nombreux points, et en particulier dans ses relations avec Rome.
À l’époque gauloise, les éduens étaient un peuple celte qui occupait la région de l'actuelle Bourgogne avec pour capitale Bibracte, sur le mont Beuvray. L’évocation de « nos ancêtres les Gaulois » déclenche de nos jours à coup sûr une polémique, et l’enseignement de leur histoire (et par leur biais, de la nôtre) est souvent caricaturé. Pourtant, nous savons aujourd’hui que les Gaulois étaient pluriels, tant dans leurs structures que dans leurs rapports avec Rome, mais aussi entre eux, et que cette pluralité est peut-être aussi l’une des richesses de nos « racines ». Les Eduens étaient l’un de ces peuples, singulier en de nombreux points, et en particulier dans ses relations avec Rome.
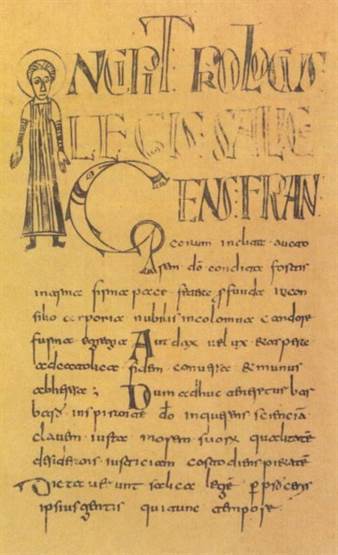 La loi salique, ou loi des francs saliens, est un code civil et pénal dont l’origine mythique remonte au roi franc légendaire Pharamond. Rédigée entre le VIe et le VIIe siècle, la loi salique a été, sauf dans certains centres monastiques, oubliée. Une disposition de cette loi, excluant les femmes de la succession à la terre, a été opportunément interprétée plus tard de façon à les évincer de la couronne de France. Pourtant, il n'est pas question de la succession du royaume dans la loi salique, mais des biens du clan familial. La terre, source de richesse, est attribuée aux héritiers mâles, les guerriers, tandis que les femmes reçoivent les biens meubles.
La loi salique, ou loi des francs saliens, est un code civil et pénal dont l’origine mythique remonte au roi franc légendaire Pharamond. Rédigée entre le VIe et le VIIe siècle, la loi salique a été, sauf dans certains centres monastiques, oubliée. Une disposition de cette loi, excluant les femmes de la succession à la terre, a été opportunément interprétée plus tard de façon à les évincer de la couronne de France. Pourtant, il n'est pas question de la succession du royaume dans la loi salique, mais des biens du clan familial. La terre, source de richesse, est attribuée aux héritiers mâles, les guerriers, tandis que les femmes reçoivent les biens meubles.
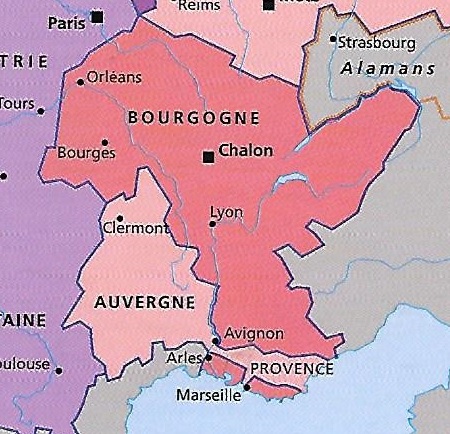 Durant le haut Moyen Age, plusieurs Etats sont connus sous le nom de royaume de Bourgogne. Au deuxième quart du VIe siècle, si les rois burgondes ont été définitivement vaincus par les Francs, le peuple burgonde lui n’a pas disparu. Ses lois et son aristocratie, alliée à la noblesse gallo-romaine survivent. Le regnum Burgondiæ, ne fait que passer sous l’égide mérovingienne où s’opposent neustriens et austrasiens. Au Xe siècle, le royaume de Bourgogne-Provence est partagé entre l'Empire et la Francie Occidentale, et la Bourgogne devient un duché.
Durant le haut Moyen Age, plusieurs Etats sont connus sous le nom de royaume de Bourgogne. Au deuxième quart du VIe siècle, si les rois burgondes ont été définitivement vaincus par les Francs, le peuple burgonde lui n’a pas disparu. Ses lois et son aristocratie, alliée à la noblesse gallo-romaine survivent. Le regnum Burgondiæ, ne fait que passer sous l’égide mérovingienne où s’opposent neustriens et austrasiens. Au Xe siècle, le royaume de Bourgogne-Provence est partagé entre l'Empire et la Francie Occidentale, et la Bourgogne devient un duché.
 Le baptême du roi mérovingien Clovis à Reims un 25 décembre 498 (1), suivi par 3.000 de ses guerriers francs, est un événement majeur de l’histoire médiévale balbutiante. Avec cette conversion au christianisme, il s'assure non seulement le soutien de l'Église, mais aussi celui de ses sujets latins - pour la plupart chrétiens - et réunit ainsi les conditions préalables à la montée en puissance du royaume des Francs. Cet acte religieux marque aussi le début de la renaissance de la civilisation chrétienne occidentale, qui failli périr noyée avec l’empire romain sous les coups portés par les invasions, et scelle une alliance pereine entre l'Eglise catholique romaine et la monarchie franque puis française.
Le baptême du roi mérovingien Clovis à Reims un 25 décembre 498 (1), suivi par 3.000 de ses guerriers francs, est un événement majeur de l’histoire médiévale balbutiante. Avec cette conversion au christianisme, il s'assure non seulement le soutien de l'Église, mais aussi celui de ses sujets latins - pour la plupart chrétiens - et réunit ainsi les conditions préalables à la montée en puissance du royaume des Francs. Cet acte religieux marque aussi le début de la renaissance de la civilisation chrétienne occidentale, qui failli périr noyée avec l’empire romain sous les coups portés par les invasions, et scelle une alliance pereine entre l'Eglise catholique romaine et la monarchie franque puis française.
 Clovis Ier, roi des francs de 482 à 511, est le plus illustre des rois mérovingiens. Au tournant du Ve et du VIe siècle, ce petit-fils du légendaire roi Mérovée s'est emparé de la quasi totalité de la Gaule romaine. Pour consolider son autorité sur son immense domaine, il a habilement passé une alliance avec l'Eglise catholique romaine, seule institution à avoir survécu à la chute de l'empire romain d'occident. Vers 498, il se convertit au christianisme avec plusieurs milliers de ses guerriers. Mettant sur un pied d'égalité les Francs conquérants et les Gallo-romains, Clovis a fait de ces deux peuples une seule nation : le Regnum francorum, le royaume des francs. L'histoire des francs, écrite un siècle plus tard par Grégoire de Tours, est l'une des rares sources sur le règne de Clovis dont nous disposions.
Clovis Ier, roi des francs de 482 à 511, est le plus illustre des rois mérovingiens. Au tournant du Ve et du VIe siècle, ce petit-fils du légendaire roi Mérovée s'est emparé de la quasi totalité de la Gaule romaine. Pour consolider son autorité sur son immense domaine, il a habilement passé une alliance avec l'Eglise catholique romaine, seule institution à avoir survécu à la chute de l'empire romain d'occident. Vers 498, il se convertit au christianisme avec plusieurs milliers de ses guerriers. Mettant sur un pied d'égalité les Francs conquérants et les Gallo-romains, Clovis a fait de ces deux peuples une seule nation : le Regnum francorum, le royaume des francs. L'histoire des francs, écrite un siècle plus tard par Grégoire de Tours, est l'une des rares sources sur le règne de Clovis dont nous disposions.
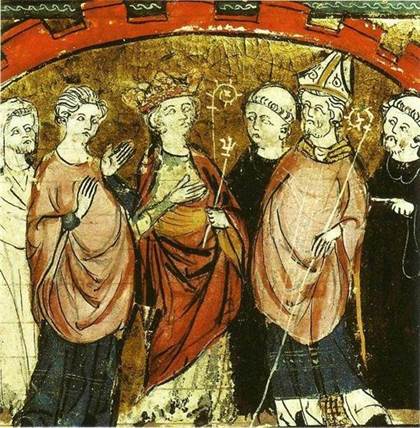 Dynastie de rois francs descendant de Mérovée, les Mérovingiens ont régné sur la Gaule jusqu'en 751. Cette dynastie matrice de la royauté française a longtemps été victime d’une « légende noire », entretenue dès le VIe siècle par Grégoire de Tours, puis par leurs successeurs, les Carolingiens, sous la plume d’Eginhard. Les mérovingiens sont ainsi devenus les « rois fainéants » des images pour écoliers jusqu’au XIXe siècle (et au-delà…). A part Clovis, et pour d’autres raisons Dagobert Ier, la période mérovingienne était comme un trou noir dans l’histoire de France. Pourtant, ces rois et reines ont été à la frontière entre la fin d’une Antiquité « barbare » et un Moyen Âge où allait se construire la France.
Dynastie de rois francs descendant de Mérovée, les Mérovingiens ont régné sur la Gaule jusqu'en 751. Cette dynastie matrice de la royauté française a longtemps été victime d’une « légende noire », entretenue dès le VIe siècle par Grégoire de Tours, puis par leurs successeurs, les Carolingiens, sous la plume d’Eginhard. Les mérovingiens sont ainsi devenus les « rois fainéants » des images pour écoliers jusqu’au XIXe siècle (et au-delà…). A part Clovis, et pour d’autres raisons Dagobert Ier, la période mérovingienne était comme un trou noir dans l’histoire de France. Pourtant, ces rois et reines ont été à la frontière entre la fin d’une Antiquité « barbare » et un Moyen Âge où allait se construire la France.
 La damasquinure est apparue en Orient dès que l’usage des métaux s’y fut généralisé. L'étymologie même du mot témoigne de cette origine. Le terme « damasquiner » est en effet dérivé du nom de la ville de Damas. Cet art d’incruster des fils métalliques ou d’appliquer des plaques de métal sur un autre support métallique est ensuite pratiqué par les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Il est introduit en Gaule dès la fin du VIe siècle. Il y sera surtout apprécié et maîtrisé à l'époque mérovingienne. Les Francs ornent les objets de la vie quotidienne avec beaucoup d’inventivité. A cette fin, ils développent plusieurs techniques : la damasquinure et l'orfèvrerie cloisonnée.
La damasquinure est apparue en Orient dès que l’usage des métaux s’y fut généralisé. L'étymologie même du mot témoigne de cette origine. Le terme « damasquiner » est en effet dérivé du nom de la ville de Damas. Cet art d’incruster des fils métalliques ou d’appliquer des plaques de métal sur un autre support métallique est ensuite pratiqué par les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Il est introduit en Gaule dès la fin du VIe siècle. Il y sera surtout apprécié et maîtrisé à l'époque mérovingienne. Les Francs ornent les objets de la vie quotidienne avec beaucoup d’inventivité. A cette fin, ils développent plusieurs techniques : la damasquinure et l'orfèvrerie cloisonnée.
 Les burgondes étaient un peuple barbare originaire de Scandinavie puis de Germanie qui s'installa en Gaule au Ve siècle, donnant son nom à la Bourgogne actuelle. Rendus célèbre par Richard Wagner à travers l’épopée des Nibelungen, le royaume burgonde et son peuple n’apparaissent cependant pas moins dans l’Histoire comme un voisin discret face aux principaux royaumes barbares. Sans chroniqueur tel un Grégoire de Tours pour relater leurs faits, entourés par de grandes puissances, les Burgondes se montrent trop peu pour intéresser les auteurs grecs et latins de l’Antiquité tardive. En effet, ils ne ravagent pas la Gaule, ils ne s’emparent pas de Rome, ils ne tuent pas non plus l’empereur, ils restent dans l’ombre et demeurent aujourd’hui encore méconnus. Leur histoire, bien que lacunaire, est toutefois riche en événements et en rebondissements.
Les burgondes étaient un peuple barbare originaire de Scandinavie puis de Germanie qui s'installa en Gaule au Ve siècle, donnant son nom à la Bourgogne actuelle. Rendus célèbre par Richard Wagner à travers l’épopée des Nibelungen, le royaume burgonde et son peuple n’apparaissent cependant pas moins dans l’Histoire comme un voisin discret face aux principaux royaumes barbares. Sans chroniqueur tel un Grégoire de Tours pour relater leurs faits, entourés par de grandes puissances, les Burgondes se montrent trop peu pour intéresser les auteurs grecs et latins de l’Antiquité tardive. En effet, ils ne ravagent pas la Gaule, ils ne s’emparent pas de Rome, ils ne tuent pas non plus l’empereur, ils restent dans l’ombre et demeurent aujourd’hui encore méconnus. Leur histoire, bien que lacunaire, est toutefois riche en événements et en rebondissements.
 Charlemagne (742-814) est un roi franc puis un empereur d’Occident qui a régné de 768 à 814 et a donné son nom à la dynastie des carolingiens. Fils aîné de Pépin le Bref, il règne seul après la mort de son frère Carloman en 771 sur un domaine qui recouvre alors la Gaule et une partie de la Germanie. En 774, il se proclame roi des Lombards et débute sa politique d’expansion, menant de nombreuses campagnes militaires. En 46 années de règne, il fait du royaume franc le plus vaste territoire depuis la chute de l’Empire romain. Soutenu par la papauté, car il impose le christianisme aux peuples vaincus, Charlemagne est couronné empereur d’Occident le jour de Noël 800. Appelé « l’empereur à la barbe fleurie », il est connu grâce à la description qu’en a donné le chroniqueur Eginhard, qui a rédigé vers 830 la Vie de Charlemagne, sa biographie.
Charlemagne (742-814) est un roi franc puis un empereur d’Occident qui a régné de 768 à 814 et a donné son nom à la dynastie des carolingiens. Fils aîné de Pépin le Bref, il règne seul après la mort de son frère Carloman en 771 sur un domaine qui recouvre alors la Gaule et une partie de la Germanie. En 774, il se proclame roi des Lombards et débute sa politique d’expansion, menant de nombreuses campagnes militaires. En 46 années de règne, il fait du royaume franc le plus vaste territoire depuis la chute de l’Empire romain. Soutenu par la papauté, car il impose le christianisme aux peuples vaincus, Charlemagne est couronné empereur d’Occident le jour de Noël 800. Appelé « l’empereur à la barbe fleurie », il est connu grâce à la description qu’en a donné le chroniqueur Eginhard, qui a rédigé vers 830 la Vie de Charlemagne, sa biographie.
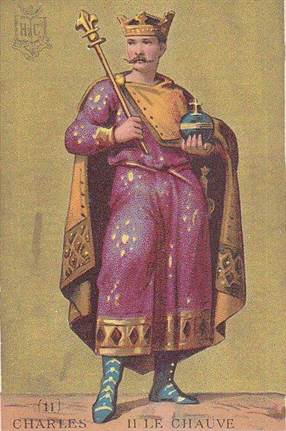 En juin 861, Charles le Chauve (823, †877) convoque le plaid général annuel en la villa royale de Pîtres, demandant aux grands de venir accompagnés d'ouvriers et de chars. Il donne alors ordre de commencer la construction d'un pont fortifié enjambant les cours de la Seine et de l'Eure afin de barrer la route aux flottes vikings qui infestent la vallée. Commence alors un des plus grands chantiers de l'époque qui dura près de dix ans et mobilisa une énorme main-d'œuvre.
En juin 861, Charles le Chauve (823, †877) convoque le plaid général annuel en la villa royale de Pîtres, demandant aux grands de venir accompagnés d'ouvriers et de chars. Il donne alors ordre de commencer la construction d'un pont fortifié enjambant les cours de la Seine et de l'Eure afin de barrer la route aux flottes vikings qui infestent la vallée. Commence alors un des plus grands chantiers de l'époque qui dura près de dix ans et mobilisa une énorme main-d'œuvre.
 Eginhard (770, †840), dans son ouvrage « Vie de Charlemagne », décrit ainsi l'habillement du roi des Francs : «Le costume ordinaire du roi était celui de ses pères, l'habit des Francs ; il avait sur la peau une chemise et des hauts-de-chausse de toile de lin ; par-dessus était une tunique serrée avec une ceinture de soie et des chaussettes ; des bandelettes entouraient ses jambes, des sandales renfermaient ses pieds, et l'hiver un justaucorps de peau de loutre lui garantissait la poitrine et les épaules contre le froid...»
Eginhard (770, †840), dans son ouvrage « Vie de Charlemagne », décrit ainsi l'habillement du roi des Francs : «Le costume ordinaire du roi était celui de ses pères, l'habit des Francs ; il avait sur la peau une chemise et des hauts-de-chausse de toile de lin ; par-dessus était une tunique serrée avec une ceinture de soie et des chaussettes ; des bandelettes entouraient ses jambes, des sandales renfermaient ses pieds, et l'hiver un justaucorps de peau de loutre lui garantissait la poitrine et les épaules contre le froid...»
 Le traité de Verdun de 843 est un traité de paix qui met un terme au conflit opposant les trois fils de Louis Ier le pieux pour la possession de l’Empire franc édifié par leur grand-père Charlemagne. Selon les termes de cet accord, l’Empire est partagé en trois parties, mettant de fait un terme à la brève unification de l’Europe occidentale : Charles le Chauve reçoit les territoires de l'ouest de la France actuelle, Louis le Germanique la Germanie et, entre les deux royaumes, Lothaire fonde la Lotharingie (Alsace, Lorraine, Pays-Bas, Bourgogne et Italie du nord). De cette partition naitront le royaume de France à l'ouest et le Saint Empire Romain Germanique à l'est.
Le traité de Verdun de 843 est un traité de paix qui met un terme au conflit opposant les trois fils de Louis Ier le pieux pour la possession de l’Empire franc édifié par leur grand-père Charlemagne. Selon les termes de cet accord, l’Empire est partagé en trois parties, mettant de fait un terme à la brève unification de l’Europe occidentale : Charles le Chauve reçoit les territoires de l'ouest de la France actuelle, Louis le Germanique la Germanie et, entre les deux royaumes, Lothaire fonde la Lotharingie (Alsace, Lorraine, Pays-Bas, Bourgogne et Italie du nord). De cette partition naitront le royaume de France à l'ouest et le Saint Empire Romain Germanique à l'est.
 Le Ludwigslied ou Rithmus Teutonicus (en français, « la chanson de Louis ») est un poème écrit en haut-allemand ancien par un anonyme, moine ou laïc de la cour. Il célèbre la victoire de Louis III, roi de Francie Occidentale, contre les Vikings, le 3 août 881 à Saucourt-en-Vimeu en Picardie. Il a sans doute été composé du vivant du roi Louis. Ce chant de louange est transcrit dans un manuscrit du IXe siècle du monastère de Saint-Amand. Cette abbaye, fondée au VIIe siècle par le moine Amand de Maastricht sous le patronage du roi Dagobert sous le nom initial d'abbaye d'Elnon, a fait partie des principaux foyers intellectuels de l'Occident du règne de Charles le Chauve jusqu'au Xe siècle, avec une importante bibliothèque et un scriptorium producteur de manuscrits importants, tel que la bible de Charles le Chauve. Redécouvert en 1672 par Don Mabillon, le chant est aujourd'hui conservé à la bibliothèque municipale de Valenciennes (Codex 150, f. 141v-143r), qui conserve les archives de l'ancienne abbaye. Ce poème est considéré comme l'un des plus anciens témoignages de la langue germanique.
Le Ludwigslied ou Rithmus Teutonicus (en français, « la chanson de Louis ») est un poème écrit en haut-allemand ancien par un anonyme, moine ou laïc de la cour. Il célèbre la victoire de Louis III, roi de Francie Occidentale, contre les Vikings, le 3 août 881 à Saucourt-en-Vimeu en Picardie. Il a sans doute été composé du vivant du roi Louis. Ce chant de louange est transcrit dans un manuscrit du IXe siècle du monastère de Saint-Amand. Cette abbaye, fondée au VIIe siècle par le moine Amand de Maastricht sous le patronage du roi Dagobert sous le nom initial d'abbaye d'Elnon, a fait partie des principaux foyers intellectuels de l'Occident du règne de Charles le Chauve jusqu'au Xe siècle, avec une importante bibliothèque et un scriptorium producteur de manuscrits importants, tel que la bible de Charles le Chauve. Redécouvert en 1672 par Don Mabillon, le chant est aujourd'hui conservé à la bibliothèque municipale de Valenciennes (Codex 150, f. 141v-143r), qui conserve les archives de l'ancienne abbaye. Ce poème est considéré comme l'un des plus anciens témoignages de la langue germanique.
 Par le traité de Saint-Clair-sur-Epte signé en 911, le roi carolingien Charles III le Simple donne en fief la Normandie au chef viking Rollon. Les relations entre Francs et Normands (également appelés Vikings) ont d’abord été longtemps conflictuelles. Tout le IXe siècle, dans le contexte du délitement de l’empire carolingien, est une succession d’attaques des Normands contre le royaume franc, et une bonne partie de l’Europe. Puis, à mesure que les Vikings s’installent, les échanges deviennent plus diplomatiques, jusqu’à ce que tout le monde y trouve son compte. Acte politique, militaire et religieux, la création de la Normandie marque l’émergence d’une nouvelle attitude monarchique : la fidélisation par la concession féodale.
Par le traité de Saint-Clair-sur-Epte signé en 911, le roi carolingien Charles III le Simple donne en fief la Normandie au chef viking Rollon. Les relations entre Francs et Normands (également appelés Vikings) ont d’abord été longtemps conflictuelles. Tout le IXe siècle, dans le contexte du délitement de l’empire carolingien, est une succession d’attaques des Normands contre le royaume franc, et une bonne partie de l’Europe. Puis, à mesure que les Vikings s’installent, les échanges deviennent plus diplomatiques, jusqu’à ce que tout le monde y trouve son compte. Acte politique, militaire et religieux, la création de la Normandie marque l’émergence d’une nouvelle attitude monarchique : la fidélisation par la concession féodale.
 La société franque, sous Charlemagne, voit la diffusion d’un phénomène massif de christianisation de tous les territoires placés, directement ou indirectement, sous son influence. La Dilatatio Regni, c’est-à-dire l’expansion territoriale du royaume, est avant tout une Dilatatio Christianitatis, autrement dit la christianisation de la société toute entière, la diffusion de la chrétienté dans toutes les sphères de la société. Les mécanismes qui avaient permis aux Arnulfiens-Pippinides, cette famille caractéristique de la noblesse franque, d’accéder aux plus hautes instances du pouvoir sont toujours d’actualité lors du « moment carolingien ». Ils ont même tendance à s’accentuer, voire même à se renouveler, en proposant des modalités toujours plus novatrices les unes que les autres.
La société franque, sous Charlemagne, voit la diffusion d’un phénomène massif de christianisation de tous les territoires placés, directement ou indirectement, sous son influence. La Dilatatio Regni, c’est-à-dire l’expansion territoriale du royaume, est avant tout une Dilatatio Christianitatis, autrement dit la christianisation de la société toute entière, la diffusion de la chrétienté dans toutes les sphères de la société. Les mécanismes qui avaient permis aux Arnulfiens-Pippinides, cette famille caractéristique de la noblesse franque, d’accéder aux plus hautes instances du pouvoir sont toujours d’actualité lors du « moment carolingien ». Ils ont même tendance à s’accentuer, voire même à se renouveler, en proposant des modalités toujours plus novatrices les unes que les autres.
 L'université de Paris a été fondée en 1200 par Philippe Auguste. Les deux premières décennies du XIIIè siècle voient en effet naître un peu partout en Europe (en Occident chrétien pour être plus précis) un certain nombre d’universités, à Paris, Bologne, Oxford, Montpellier, Salamanque,…Elles sont un tournant dans l’histoire de l’enseignement, en étant marquées par une réelle autonomie, au contraire par exemple des écoles des monastères. Elles se dotent de règles propres, relativement indépendantes des autorités politiques et religieuses. De plus, leur essor est parallèle à celui des villes en cette période de « beau Moyen Age ».
L'université de Paris a été fondée en 1200 par Philippe Auguste. Les deux premières décennies du XIIIè siècle voient en effet naître un peu partout en Europe (en Occident chrétien pour être plus précis) un certain nombre d’universités, à Paris, Bologne, Oxford, Montpellier, Salamanque,…Elles sont un tournant dans l’histoire de l’enseignement, en étant marquées par une réelle autonomie, au contraire par exemple des écoles des monastères. Elles se dotent de règles propres, relativement indépendantes des autorités politiques et religieuses. De plus, leur essor est parallèle à celui des villes en cette période de « beau Moyen Age ».
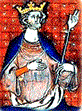 La question de la féodalité, dont le rôle des honores, est en plein essor actuellement. Les anciennes théories mutationnistes, notamment défendues par Georges Duby, sont remises en question par des chercheurs qui voient dans la constitution du système féodal plus de permanences par rapport au système Carolingien que de réelles nouveautés. En tout cas, hors de ce débat complexe, la question de la construction des principautés entre le IXe et le XIe siècle est fondamentale pour comprendre comment se structure la société médiévale. Ainsi, nous pouvons observer la construction de ces entités politiques, placées entre les mains de seigneurs de l’aristocratie, dans une phase de transition, alors que le système n’est pas encore fermement en place. Par ce biais, la compréhension de la société du Moyen Âge apparaît plus claire.
La question de la féodalité, dont le rôle des honores, est en plein essor actuellement. Les anciennes théories mutationnistes, notamment défendues par Georges Duby, sont remises en question par des chercheurs qui voient dans la constitution du système féodal plus de permanences par rapport au système Carolingien que de réelles nouveautés. En tout cas, hors de ce débat complexe, la question de la construction des principautés entre le IXe et le XIe siècle est fondamentale pour comprendre comment se structure la société médiévale. Ainsi, nous pouvons observer la construction de ces entités politiques, placées entre les mains de seigneurs de l’aristocratie, dans une phase de transition, alors que le système n’est pas encore fermement en place. Par ce biais, la compréhension de la société du Moyen Âge apparaît plus claire.
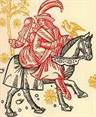 Au XIe siècle, un couple defraie la chronique et la relation entretenue par Anne de Kiev et Raoul de Crépy devient emblématique de l'amour courtois au Moyen Age. A cette époque, il était devenu difficile pour les rois de trouver une épouse, l'Eglise ayant durcit ses positions en frappant d'interdit tout mariage entre cousins jusqu'au 7ème degré. Après deux échecs consécutifs pour cause de parenté, on finit par trouver pour le roi Henri Ier de France, veuf et sans descendance, une princesse russe, Anne de Kiev. Séduit par sa grande beauté, Henri l'épouse en 1051, mariage dont seront issus quatre enfants. Neuf ans plus tard le roi meurt, laissant la belle reine slave veuve, et libre...
Au XIe siècle, un couple defraie la chronique et la relation entretenue par Anne de Kiev et Raoul de Crépy devient emblématique de l'amour courtois au Moyen Age. A cette époque, il était devenu difficile pour les rois de trouver une épouse, l'Eglise ayant durcit ses positions en frappant d'interdit tout mariage entre cousins jusqu'au 7ème degré. Après deux échecs consécutifs pour cause de parenté, on finit par trouver pour le roi Henri Ier de France, veuf et sans descendance, une princesse russe, Anne de Kiev. Séduit par sa grande beauté, Henri l'épouse en 1051, mariage dont seront issus quatre enfants. Neuf ans plus tard le roi meurt, laissant la belle reine slave veuve, et libre...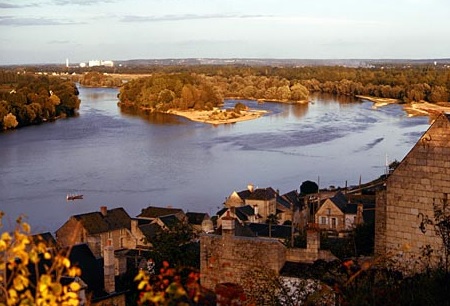 Loin des grandes batailles (souvent des défaites françaises), des chevauchées dévastatrices anglaises du Prince noir, ou des luttes pour les grandes villes (Orléans, Paris,...), il est une région en France qui fut le théâtre méconnu mais décisif de la guerre de Cent ans, et du conflit entre Armagnacs et Bourguignons. Situés sur les rives de la Loire, respectivement aux marges du duché de Berry et du duché de Bourgogne, le Sancerrois et le Nivernais ont vu passer et s'affronter les plus grands personnages du conflit, de Charles VII au duc de Bedford, en passant par Jean sans Peur et Jeanne d'Arc, vaincue à La Charité-sur-Loire par un curieux individu, Perrinet Gressart. Pendant une vingtaine d'années, au début du XVe siècle, la Loire a ainsi été une véritable frontière de la Guerre de Cent ans.
Loin des grandes batailles (souvent des défaites françaises), des chevauchées dévastatrices anglaises du Prince noir, ou des luttes pour les grandes villes (Orléans, Paris,...), il est une région en France qui fut le théâtre méconnu mais décisif de la guerre de Cent ans, et du conflit entre Armagnacs et Bourguignons. Situés sur les rives de la Loire, respectivement aux marges du duché de Berry et du duché de Bourgogne, le Sancerrois et le Nivernais ont vu passer et s'affronter les plus grands personnages du conflit, de Charles VII au duc de Bedford, en passant par Jean sans Peur et Jeanne d'Arc, vaincue à La Charité-sur-Loire par un curieux individu, Perrinet Gressart. Pendant une vingtaine d'années, au début du XVe siècle, la Loire a ainsi été une véritable frontière de la Guerre de Cent ans.
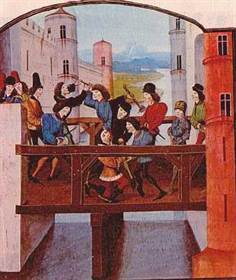 En plein cœur de la guerre de Cent Ans, une véritable guerre civile oppose les Armagnacs, fidèles à la famille royale, et les Bourguignons qui s'allient aux Anglais. Depuis 1389, le roi Charles VI est régulièrement atteint de crises de démence. Un conseil de régence est exercé par ses frères dont Louis est, au début du XVe siècle, le plus influent, malgré la puissance croissante de la maison de Bourgogne. Cette rivalité va atteindre son paroxysme avec l’assassinat de Louis, duc d’Orléans, sur ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, le 23 novembre 1407.
En plein cœur de la guerre de Cent Ans, une véritable guerre civile oppose les Armagnacs, fidèles à la famille royale, et les Bourguignons qui s'allient aux Anglais. Depuis 1389, le roi Charles VI est régulièrement atteint de crises de démence. Un conseil de régence est exercé par ses frères dont Louis est, au début du XVe siècle, le plus influent, malgré la puissance croissante de la maison de Bourgogne. Cette rivalité va atteindre son paroxysme avec l’assassinat de Louis, duc d’Orléans, sur ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, le 23 novembre 1407.
 La Renaissance en France est souvent réduite au règne du roi François Ier, une sorte de période faste avant l’horreur des guerres de Religion. Pourtant, il est plus juste de faire débuter cette période avec Charles VIII, premier roi de la Renaissance, et de la conclure avec Henri II. Pour des raisons politiques (la situation de la France, l’évolution de la monarchie), et dans d’autres domaines, comme celui des arts ou le rapport à l’Italie, dont la Renaissance a débuté depuis un moment déjà. On verra que les règnes de Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II sont bien plus qu’une transition et une parenthèse entre la fin de la Guerre de Cent ans et le début des guerres de Religion.
La Renaissance en France est souvent réduite au règne du roi François Ier, une sorte de période faste avant l’horreur des guerres de Religion. Pourtant, il est plus juste de faire débuter cette période avec Charles VIII, premier roi de la Renaissance, et de la conclure avec Henri II. Pour des raisons politiques (la situation de la France, l’évolution de la monarchie), et dans d’autres domaines, comme celui des arts ou le rapport à l’Italie, dont la Renaissance a débuté depuis un moment déjà. On verra que les règnes de Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II sont bien plus qu’une transition et une parenthèse entre la fin de la Guerre de Cent ans et le début des guerres de Religion.
 Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme (v. 1540-1614) a été abbé, puis soldat, courtisan et écrivain au XVIe siècle. Brantôme s'illustra d'abord à la cour et sur les champs de bataille : il fut de plusieurs expéditions militaires, en Italie, en France, en Afrique. Une chute de cheval, en 1583, le fit renoncer à la vie militaire et lui donna l'occasion de s'illustrer comme brillant mémorialiste. Ses Mémoires, qu'il annonça dans son testament, furent publiés seulement en 1665. Cette œuvre est une suite d'anecdotes sur les personnages qu'il avait côtoyés à la cour. Les chapitres les plus connus et commentés sont les « Vies des dames galantes » et les « Vies des hommes illustres et des grands capitaines ».
Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme (v. 1540-1614) a été abbé, puis soldat, courtisan et écrivain au XVIe siècle. Brantôme s'illustra d'abord à la cour et sur les champs de bataille : il fut de plusieurs expéditions militaires, en Italie, en France, en Afrique. Une chute de cheval, en 1583, le fit renoncer à la vie militaire et lui donna l'occasion de s'illustrer comme brillant mémorialiste. Ses Mémoires, qu'il annonça dans son testament, furent publiés seulement en 1665. Cette œuvre est une suite d'anecdotes sur les personnages qu'il avait côtoyés à la cour. Les chapitres les plus connus et commentés sont les « Vies des dames galantes » et les « Vies des hommes illustres et des grands capitaines ».
 Mère, sœur, épouses, maîtresses, nombreuses sont les femmes qui ont entouré d'une même adoration le roi de France François Ier, roi magnifique en sa cour comme un sultan dans son Harem, lui consacrant leur vie entière. Il accepta leur don comme un dû, en enfant gâté par la fortune. Louise de Savoie, Marguerite de Navarre, Anne de Pisseleu, Claude de France et surtout Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriant, toutes femmes d'exceptions d'un règne flamboyant et mouvementé.
Mère, sœur, épouses, maîtresses, nombreuses sont les femmes qui ont entouré d'une même adoration le roi de France François Ier, roi magnifique en sa cour comme un sultan dans son Harem, lui consacrant leur vie entière. Il accepta leur don comme un dû, en enfant gâté par la fortune. Louise de Savoie, Marguerite de Navarre, Anne de Pisseleu, Claude de France et surtout Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriant, toutes femmes d'exceptions d'un règne flamboyant et mouvementé.
 Né le 28 février 1518, François de France est le premier fils de François Ier et de la reine Claude de France. Prénommé comme son père, le prince est titré dauphin de France et c'est sur lui que reposent les espoirs de la dynastie. Après la défaite de Pavie, il est laissé tout comme son frère en otage en Espagne ou il subit une rude détention qui va durer quatre ans. De par la mort de sa mère en 1524, François hérite du duché de Bretagne et est couronné à Rennes en 1532 par l'évêque Yves Mahyeuc, il est alors connu comme François III de Bretagne. Mort à dix-huit ans, c'est son frère cadet le futur Henri II qui deviendra le dauphin de France.
Né le 28 février 1518, François de France est le premier fils de François Ier et de la reine Claude de France. Prénommé comme son père, le prince est titré dauphin de France et c'est sur lui que reposent les espoirs de la dynastie. Après la défaite de Pavie, il est laissé tout comme son frère en otage en Espagne ou il subit une rude détention qui va durer quatre ans. De par la mort de sa mère en 1524, François hérite du duché de Bretagne et est couronné à Rennes en 1532 par l'évêque Yves Mahyeuc, il est alors connu comme François III de Bretagne. Mort à dix-huit ans, c'est son frère cadet le futur Henri II qui deviendra le dauphin de France.
 Le massacre de la Saint-Barthélemy, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, est un épisode sanglant des guerres de religion entre catholiques et protestants en France. Alors que le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois est censé apaiser les conflits, l’idée s’impose de tuer les nombreux gentilshommes protestants venus à Paris pour l'occasion. Le massacre commence dans la nuit du 23 au 24 août par le meurtre de Coligny dont le cadavre est défenestré. Puis les cloches de la capitale appellent au carnage. Les Parisiens assassinent 3 000 à 4 000 protestants. Seuls, Henri de Navarre et le prince de Condé échappent à la mort en abjurant le protestantisme. Le massacre se poursuivit en province jusqu'en octobre et déclenche la quatrième guerre de Religion. Impossible à évaluer de manière précise, le nombre de victimes est estimé à 13 000.
Le massacre de la Saint-Barthélemy, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, est un épisode sanglant des guerres de religion entre catholiques et protestants en France. Alors que le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois est censé apaiser les conflits, l’idée s’impose de tuer les nombreux gentilshommes protestants venus à Paris pour l'occasion. Le massacre commence dans la nuit du 23 au 24 août par le meurtre de Coligny dont le cadavre est défenestré. Puis les cloches de la capitale appellent au carnage. Les Parisiens assassinent 3 000 à 4 000 protestants. Seuls, Henri de Navarre et le prince de Condé échappent à la mort en abjurant le protestantisme. Le massacre se poursuivit en province jusqu'en octobre et déclenche la quatrième guerre de Religion. Impossible à évaluer de manière précise, le nombre de victimes est estimé à 13 000.
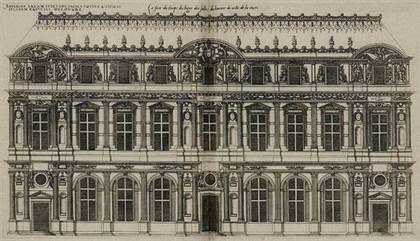 Si le mécénat et les relations entre le prince et les arts sont anciens, on considère souvent que la France de la Renaissance, celle de François Ier, en est l’un des exemples les plus parfaits. Les châteaux de la Loire, les commandes aux plus grands artistes de son temps, font du Valois le prince mécène idéal. Toutefois, on peut se poser la question : que s’est-il passé ensuite, jusqu’à l’avènement d’un prince mécène plus grand encore, le Roi Louis XIV dont nous vous proposons également la biographie ?
Si le mécénat et les relations entre le prince et les arts sont anciens, on considère souvent que la France de la Renaissance, celle de François Ier, en est l’un des exemples les plus parfaits. Les châteaux de la Loire, les commandes aux plus grands artistes de son temps, font du Valois le prince mécène idéal. Toutefois, on peut se poser la question : que s’est-il passé ensuite, jusqu’à l’avènement d’un prince mécène plus grand encore, le Roi Louis XIV dont nous vous proposons également la biographie ?
 Le seigneur de La Palice s'est distingué lors de la bataille de Marignan, ce qui lui vaudra le titre de maréchal de France en 1515. Il a donné son nom aux fameuses « lapalissades » ou « vérité de La Palice ». Pourtant, il n’y est pas pour grand-chose, il lui a suffit de mourir le 24 février 1525 à la bataille de Pavie pour que ses soldats lui dédient une chanson. L’originale disait « hélas, s’il n’était pas mort, il ferait encore envie » qui se transformait en «hélas, s’il n’était pas mort, il serait encore en vie » après une erreur de lecture de l’ancien français.
Le seigneur de La Palice s'est distingué lors de la bataille de Marignan, ce qui lui vaudra le titre de maréchal de France en 1515. Il a donné son nom aux fameuses « lapalissades » ou « vérité de La Palice ». Pourtant, il n’y est pas pour grand-chose, il lui a suffit de mourir le 24 février 1525 à la bataille de Pavie pour que ses soldats lui dédient une chanson. L’originale disait « hélas, s’il n’était pas mort, il ferait encore envie » qui se transformait en «hélas, s’il n’était pas mort, il serait encore en vie » après une erreur de lecture de l’ancien français.
 Dans la mémoire générale, favoris, mignons, archi-mignons sont des noms évocateurs de scandale et utilisés de manière moqueuse et dégradante, surtout pendant le règne d'Henri III ! Et pourtant, les rois, reines, personnages de haut rang s’entouraient très souvent d’un favori, la personne de confiance, l’ami intime, comblé de faveurs, dont l’influence politique était plus ou moins importante. Remettons un peu les choses à leur place…car il existait déjà des favoris pendant l’Antiquité puis au Moyen-âge, mais l’époque la plus fournie va du XV è siècle au XVII è siècle.
Dans la mémoire générale, favoris, mignons, archi-mignons sont des noms évocateurs de scandale et utilisés de manière moqueuse et dégradante, surtout pendant le règne d'Henri III ! Et pourtant, les rois, reines, personnages de haut rang s’entouraient très souvent d’un favori, la personne de confiance, l’ami intime, comblé de faveurs, dont l’influence politique était plus ou moins importante. Remettons un peu les choses à leur place…car il existait déjà des favoris pendant l’Antiquité puis au Moyen-âge, mais l’époque la plus fournie va du XV è siècle au XVII è siècle.
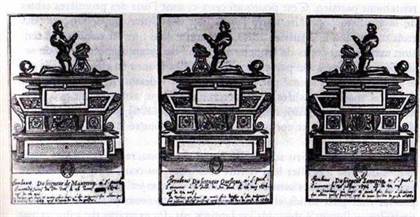 La majorité des membres du premier groupe des mignons ne purent pas obtenir de charges et de postes importants, une partie disparait lors du grand duel en 1578, d’autres sont disgraciés. Enfin, certains anciens compagnons du roi ont eu plus de chance et vécurent au temps d’Henri IV, puis de Louis XIII à des postes respectables. Voici donc pour chacun d’eux, leur petit curriculum vitae.
La majorité des membres du premier groupe des mignons ne purent pas obtenir de charges et de postes importants, une partie disparait lors du grand duel en 1578, d’autres sont disgraciés. Enfin, certains anciens compagnons du roi ont eu plus de chance et vécurent au temps d’Henri IV, puis de Louis XIII à des postes respectables. Voici donc pour chacun d’eux, leur petit curriculum vitae.
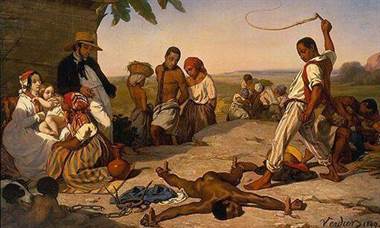 Vu comme le symbole de la traite atlantique et de Louis XIV, le Code noir (ou « édit sur la police des esclaves »), établi par Colbert et qui comporte soixante articles, visait à fixer le statut juridique des esclaves dans les Antilles françaises. Il est promulgué en 1685, la même année que la révocation de l’Edit de Nantes, sous le règne de Louis XIV, deux ans après la mort de son principal ministre. D’autres textes s’en inspirant seront ajoutés pour d’autres colonies, et l’on devrait ainsi parler plutôt de Codes noirs.
Vu comme le symbole de la traite atlantique et de Louis XIV, le Code noir (ou « édit sur la police des esclaves »), établi par Colbert et qui comporte soixante articles, visait à fixer le statut juridique des esclaves dans les Antilles françaises. Il est promulgué en 1685, la même année que la révocation de l’Edit de Nantes, sous le règne de Louis XIV, deux ans après la mort de son principal ministre. D’autres textes s’en inspirant seront ajoutés pour d’autres colonies, et l’on devrait ainsi parler plutôt de Codes noirs.
 André Le Nôtre (1613-1700) est un célèbre jardinier et paysagiste français, inventeur d’un style de jardin appelé « jardin à la française ». Nommé jardinier du roi Louis XIV en 1645, André Le Nôtre réalise le jardin du château de Vaux-le-Vicomte avec Louis Le Vau, architecte de cet édifice. Sa plus grande œuvre est la création du jardin du château de Versailles. Ce chantier gigantesque l’a occupé pendant plus de trente ans. Son style, qui mêle rigueur et harmonie, a influencé de nombreux paysagistes à travers toute l’Europe durant le XVIIe siècle.
André Le Nôtre (1613-1700) est un célèbre jardinier et paysagiste français, inventeur d’un style de jardin appelé « jardin à la française ». Nommé jardinier du roi Louis XIV en 1645, André Le Nôtre réalise le jardin du château de Vaux-le-Vicomte avec Louis Le Vau, architecte de cet édifice. Sa plus grande œuvre est la création du jardin du château de Versailles. Ce chantier gigantesque l’a occupé pendant plus de trente ans. Son style, qui mêle rigueur et harmonie, a influencé de nombreux paysagistes à travers toute l’Europe durant le XVIIe siècle.
 François de Bassompierre (1579-1646) était un militaire français puis un diplomate français durant le règne de Louis XIII. Si ses exploits sur le champ de bataille lui assurèrent la postérité, sa rivalité avec Richelieu lui sera fatale. Tallemant des Réaux dit : « le nom de Bassompierre était synonyme d'élégance et de perfection ». François de Bassompierre, « le beau maréchal », est non seulement un homme de guerre courageux, ambassadeur de grande allure, mais aussi un gentilhomme bien dans son temps, avec la rage de vivre (c'est l'époque des Chalais, Montmorency, Cinq Mars), beau, intelligent, joueur, bon « viveur ».
François de Bassompierre (1579-1646) était un militaire français puis un diplomate français durant le règne de Louis XIII. Si ses exploits sur le champ de bataille lui assurèrent la postérité, sa rivalité avec Richelieu lui sera fatale. Tallemant des Réaux dit : « le nom de Bassompierre était synonyme d'élégance et de perfection ». François de Bassompierre, « le beau maréchal », est non seulement un homme de guerre courageux, ambassadeur de grande allure, mais aussi un gentilhomme bien dans son temps, avec la rage de vivre (c'est l'époque des Chalais, Montmorency, Cinq Mars), beau, intelligent, joueur, bon « viveur ».
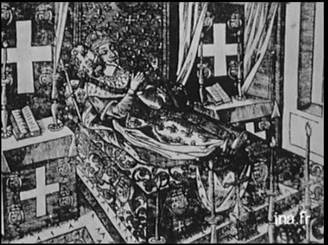 A la mort de Louis XIII le 14 mai 1643, la traditionnelle et célèbre formule « Le Roi est mort, Vive le Roi » est prononcée devant la dépouille du souverain, emporté par la maladie de Crohn . Mais les dernières semaines du roi furent bien occupées, car il lui a fallu penser à sa succession et baptiser son héritier. Déjà bien malade, il sort pour la dernière fois le 15 février 1643 à Versailles, lors d’un souper offert à son frère Gaston après leur réconciliation. Il rentre ensuite à Saint Germain, au Château Vieux pour s’aliter le 21, il ne se lèvera presque plus.
A la mort de Louis XIII le 14 mai 1643, la traditionnelle et célèbre formule « Le Roi est mort, Vive le Roi » est prononcée devant la dépouille du souverain, emporté par la maladie de Crohn . Mais les dernières semaines du roi furent bien occupées, car il lui a fallu penser à sa succession et baptiser son héritier. Déjà bien malade, il sort pour la dernière fois le 15 février 1643 à Versailles, lors d’un souper offert à son frère Gaston après leur réconciliation. Il rentre ensuite à Saint Germain, au Château Vieux pour s’aliter le 21, il ne se lèvera presque plus.
 Parmi les quatre Premiers Valets de Chambre du Roi Soleil, Alexandre Bontemps est resté dans l’Histoire de France pour avoir été le plus renommé, le plus courtois, le plus aimé du roi, mais le plus craint des ministres. Saint Simon, qui n’était pas tendre, a eu ces mots : « homme rare de son espèce, homme du secret domestique, qui sait tout du Roi, de ses habitudes, de sa vie privée, et fait rarissime, ne médit ni ne colporte aucun ragot ».
Parmi les quatre Premiers Valets de Chambre du Roi Soleil, Alexandre Bontemps est resté dans l’Histoire de France pour avoir été le plus renommé, le plus courtois, le plus aimé du roi, mais le plus craint des ministres. Saint Simon, qui n’était pas tendre, a eu ces mots : « homme rare de son espèce, homme du secret domestique, qui sait tout du Roi, de ses habitudes, de sa vie privée, et fait rarissime, ne médit ni ne colporte aucun ragot ».
 La Fronde, que certains ont qualifiée de prémices à la Révolution française, est une série de révoltes entre 1648 et 1653 contre la montée de l'absolutisme de la monarchie en France. Révoltes féminines, car jamais autant de femmes y ont participé, visant une femme Anne d’Autriche ; fronde du Parlement s’opposant aux réformes de Mazarin dans les domaines de la justice et de la finance ; fronde des Princes mécontents de l’emprise du cardinal sur la reine. Après cinq années de lutte acharnée, la Fronde s’arrêtera pour cause de contradictions entre les protagonistes ! Mais elle eut comme résultat d’étendre la puissance du ministre et de ramener l’autorité royale absolue.
La Fronde, que certains ont qualifiée de prémices à la Révolution française, est une série de révoltes entre 1648 et 1653 contre la montée de l'absolutisme de la monarchie en France. Révoltes féminines, car jamais autant de femmes y ont participé, visant une femme Anne d’Autriche ; fronde du Parlement s’opposant aux réformes de Mazarin dans les domaines de la justice et de la finance ; fronde des Princes mécontents de l’emprise du cardinal sur la reine. Après cinq années de lutte acharnée, la Fronde s’arrêtera pour cause de contradictions entre les protagonistes ! Mais elle eut comme résultat d’étendre la puissance du ministre et de ramener l’autorité royale absolue.
 Louis II de Bourbon (1621-1686), dit le Grand Condé, était un prince du sang et l'un des plus illustres chefs de guerre du Grand Siècle, considéré par Louis XIV comme le plus grand homme de son royaume. Formé dans sa jeunesse à l'art militaire, Condé se distingua durant la guerre de Trente Ans en battant les espagnols à Rocroi (1643), une victoire qui contribua beaucoup à sa gloire militaire. En 1650, il prend la tête de la Fronde des princes qui s'oppose à Anne d'Autriche et Mazarin. Passé du côté de l'armée espagnole, il est vaincu par Turenne au cours de la bataille des Dunes (1658). Il obtient l'année suivante le pardon de Louis XIV après la signature du traité des Pyrénées et se remet au service du roi de France. Victorieux en Franche-Comté et durant les guerres de Hollande, Il est promu commandant en chef des armées françaises en 1675 et livre la même année sa dernière bataille sur le front du Rhin.
Louis II de Bourbon (1621-1686), dit le Grand Condé, était un prince du sang et l'un des plus illustres chefs de guerre du Grand Siècle, considéré par Louis XIV comme le plus grand homme de son royaume. Formé dans sa jeunesse à l'art militaire, Condé se distingua durant la guerre de Trente Ans en battant les espagnols à Rocroi (1643), une victoire qui contribua beaucoup à sa gloire militaire. En 1650, il prend la tête de la Fronde des princes qui s'oppose à Anne d'Autriche et Mazarin. Passé du côté de l'armée espagnole, il est vaincu par Turenne au cours de la bataille des Dunes (1658). Il obtient l'année suivante le pardon de Louis XIV après la signature du traité des Pyrénées et se remet au service du roi de France. Victorieux en Franche-Comté et durant les guerres de Hollande, Il est promu commandant en chef des armées françaises en 1675 et livre la même année sa dernière bataille sur le front du Rhin.
 Coiffé d'une ample perruque, Louis XIV affirmait physiquement sa puissance grâce à cet accessoire vestimentaire. La perruque, signifiant à l’origine « une longue chevelure naturelle » par opposition aux faux cheveux appelés « perruque feinte », fut le symbole caractéristique de la monarchie des Bourbons jusqu’à la Révolution. La perruque est l’affirmation et la revendication — jusqu'à sa quasi-disparition au XIXe siècle — d’une appartenance à une certaine catégorie sociale. Ce simple accessoire vestimentaire eut une longévité vraiment exceptionnelle pendant 150 ans et les barbiers créateurs de perruques furent les artisans de la gloire du Roi Soleil.
Coiffé d'une ample perruque, Louis XIV affirmait physiquement sa puissance grâce à cet accessoire vestimentaire. La perruque, signifiant à l’origine « une longue chevelure naturelle » par opposition aux faux cheveux appelés « perruque feinte », fut le symbole caractéristique de la monarchie des Bourbons jusqu’à la Révolution. La perruque est l’affirmation et la revendication — jusqu'à sa quasi-disparition au XIXe siècle — d’une appartenance à une certaine catégorie sociale. Ce simple accessoire vestimentaire eut une longévité vraiment exceptionnelle pendant 150 ans et les barbiers créateurs de perruques furent les artisans de la gloire du Roi Soleil.
 Le Congrès est une pratique uniquement française, ayant duré environ cent ans sous l’Ancien Régime, demandée par une femme en vue d’annuler son mariage pour cause d’impuissance de l’époux. Cette pratique humiliante, réalisée en public, rabaissant les humains au rang d’animaux fut heureusement abolie en février 1677.
Le Congrès est une pratique uniquement française, ayant duré environ cent ans sous l’Ancien Régime, demandée par une femme en vue d’annuler son mariage pour cause d’impuissance de l’époux. Cette pratique humiliante, réalisée en public, rabaissant les humains au rang d’animaux fut heureusement abolie en février 1677.
 Lors de la journée des Dupes (11 novembre 1630), le roi de France Louis XIII réitère sa confiance au cardinal de Richelieu, aux dépens des grands du royaume, dont la mère et le frère du roi. Véritable pièce de théâtre aux accents mélodramatiques, cette journée, appelée la Journée des Dupes par Guillaume de Bautru, comte de Serrant, fut mémorable dans l’Histoire de France. La reine mère Marie de Médicis y perdit tout son pouvoir, le roi Louis XIII, perturbé, réussit à s’affirmer, dupant ses adversaires. Le cardinal Richelieu sorti vainqueur de cette crise politique et la voie était désormais ouverte à l'absolutisme royal.
Lors de la journée des Dupes (11 novembre 1630), le roi de France Louis XIII réitère sa confiance au cardinal de Richelieu, aux dépens des grands du royaume, dont la mère et le frère du roi. Véritable pièce de théâtre aux accents mélodramatiques, cette journée, appelée la Journée des Dupes par Guillaume de Bautru, comte de Serrant, fut mémorable dans l’Histoire de France. La reine mère Marie de Médicis y perdit tout son pouvoir, le roi Louis XIII, perturbé, réussit à s’affirmer, dupant ses adversaires. Le cardinal Richelieu sorti vainqueur de cette crise politique et la voie était désormais ouverte à l'absolutisme royal.
 Abel François Poisson, marquis de Marigny était le surintendant des Bâtiments durant le règne de Louis XV, en charge de l'entretien et de la rénovation des palais et demeures royales. A chaque siècle, son Premier Architecte et son Directeur des Bâtiments du roi. Ces deux personnages, au service du monarque, habités par la même passion de bâtir, doivent cohabiter tant bien que mal. C’est le cas de Marigny, frère de la marquise de Pompadour, ayant reçu la survivance de la charge de Directeur des Bâtiments, provenant de son oncle en 1745, alors qu’il n’avait que dix huit ans.
Abel François Poisson, marquis de Marigny était le surintendant des Bâtiments durant le règne de Louis XV, en charge de l'entretien et de la rénovation des palais et demeures royales. A chaque siècle, son Premier Architecte et son Directeur des Bâtiments du roi. Ces deux personnages, au service du monarque, habités par la même passion de bâtir, doivent cohabiter tant bien que mal. C’est le cas de Marigny, frère de la marquise de Pompadour, ayant reçu la survivance de la charge de Directeur des Bâtiments, provenant de son oncle en 1745, alors qu’il n’avait que dix huit ans.
 La Régence (1715-1723) désigne la période de minorité de Louis XV pendant laquelle le pouvoir a été exercé par le prince de sang Philippe d’Orléans. A la mort de Louis XIV, le Grand Siècle est terminé. La France, abattue par douze années de guerre, a pour nouveau roi Louis XV, un enfant de cinq ans. Le nouveau Régent va mener une politique de réaction vis-à-vis de l’absolutisme instauré par Louis XIV. Après la fin de règne crépusculaire et austère du Roi-Soleil s'ouvre une nouvelle période faite de bals et de fêtes. Le nouveau Régent tente en vain de restaurer les finances plombées par les guerres précédentes, mais ne peut éviter la banqueroute de Law et recherche l’alliance avec l’Angleterre.
La Régence (1715-1723) désigne la période de minorité de Louis XV pendant laquelle le pouvoir a été exercé par le prince de sang Philippe d’Orléans. A la mort de Louis XIV, le Grand Siècle est terminé. La France, abattue par douze années de guerre, a pour nouveau roi Louis XV, un enfant de cinq ans. Le nouveau Régent va mener une politique de réaction vis-à-vis de l’absolutisme instauré par Louis XIV. Après la fin de règne crépusculaire et austère du Roi-Soleil s'ouvre une nouvelle période faite de bals et de fêtes. Le nouveau Régent tente en vain de restaurer les finances plombées par les guerres précédentes, mais ne peut éviter la banqueroute de Law et recherche l’alliance avec l’Angleterre.
 L’office est une « dignité avec fonction publique » selon la définition qu’en fait Charles Loyseau en 1610. C’est une part de la fonction publique déléguée par le roi, qui crée et distribue les offices. Le propriétaire d’un office n’en est que l’usufruitier. Un officier, à l’époque moderne, est donc le détenteur d’un office, c’est-à-dire une charge de fonction publique définie par un édit (qui crée l’office) et une lettre de provision délivrée par le roi permettant d’exercer la fonction. La question de l’office et des officiers est centrale sous l'Ancien Régime. Elle est liée aux progrès de l’Etat monarchique, mais engendre de profonds bouleversements dans la société française dès le XVIIème siècle en favorisant l’émergence d’un groupe très divers : celui des officiers, que l’on retrouve à tous les niveaux de la société, de la noblesse aux échelons inférieurs.
L’office est une « dignité avec fonction publique » selon la définition qu’en fait Charles Loyseau en 1610. C’est une part de la fonction publique déléguée par le roi, qui crée et distribue les offices. Le propriétaire d’un office n’en est que l’usufruitier. Un officier, à l’époque moderne, est donc le détenteur d’un office, c’est-à-dire une charge de fonction publique définie par un édit (qui crée l’office) et une lettre de provision délivrée par le roi permettant d’exercer la fonction. La question de l’office et des officiers est centrale sous l'Ancien Régime. Elle est liée aux progrès de l’Etat monarchique, mais engendre de profonds bouleversements dans la société française dès le XVIIème siècle en favorisant l’émergence d’un groupe très divers : celui des officiers, que l’on retrouve à tous les niveaux de la société, de la noblesse aux échelons inférieurs.
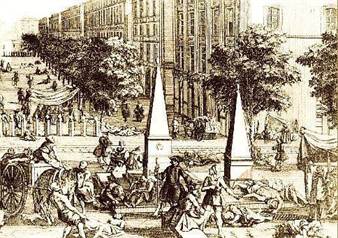 La dernière grande manifestation en Europe de la Peste date de 1720 et reste connue sous le nom de « peste de Marseille ». Elle fera 40 000 victimes sur les 75 000 habitants que compte la cité phocéenne, qui connait alors sa vingtième épidémie de cette maladie depuis l'antiquité. Au XVe siècle, la ville fut atteinte neuf fois. Au XVIIe siècle, grâce aux efforts du cardinal Richelieu puis de Louis XIV, les navires suspects ne pouvaient accoster, la police des ports était vigilante. Des certificats sanitaires signés et contresignés étaient requis avant l’amarrage et au vu de ces documents, la quarantaine était décrétée ou non. Mais sous la Régence et la liberté des mœurs, la situation est toute autre….
La dernière grande manifestation en Europe de la Peste date de 1720 et reste connue sous le nom de « peste de Marseille ». Elle fera 40 000 victimes sur les 75 000 habitants que compte la cité phocéenne, qui connait alors sa vingtième épidémie de cette maladie depuis l'antiquité. Au XVe siècle, la ville fut atteinte neuf fois. Au XVIIe siècle, grâce aux efforts du cardinal Richelieu puis de Louis XIV, les navires suspects ne pouvaient accoster, la police des ports était vigilante. Des certificats sanitaires signés et contresignés étaient requis avant l’amarrage et au vu de ces documents, la quarantaine était décrétée ou non. Mais sous la Régence et la liberté des mœurs, la situation est toute autre….
 Chevalier d'Eon, Charles de Beaumont (1728-1810) est un agent secret français célèbre pour s'être longtemps travesti en femme. Chargé par Louis XV, en 1755, d’une mission secrète en Russie auprès de la cour de l’impératrice Élisabeth Petrovna, il détourne les soupçons de l’entourage de la tsarine en se travestissant pour devenir sa lectrice attitrée et permet ainsi un rapprochement entre la France et la Russie. Pendant la guerre de Sept Ans, il combat en tant que capitaine des dragons, puis il est envoyé à Londres où il est nommé secrétaire d’ambassade. Rentré en France en 1777, Louis XVI lui ordonne de ne plus quitter ses habits féminins. Le chevalier, laissant planer le doute sur sa véritable identité, se présente désormais comme « la chevalière d’Éon ». En 1783, il retourne vivre en Angleterre, où il mourra.
Chevalier d'Eon, Charles de Beaumont (1728-1810) est un agent secret français célèbre pour s'être longtemps travesti en femme. Chargé par Louis XV, en 1755, d’une mission secrète en Russie auprès de la cour de l’impératrice Élisabeth Petrovna, il détourne les soupçons de l’entourage de la tsarine en se travestissant pour devenir sa lectrice attitrée et permet ainsi un rapprochement entre la France et la Russie. Pendant la guerre de Sept Ans, il combat en tant que capitaine des dragons, puis il est envoyé à Londres où il est nommé secrétaire d’ambassade. Rentré en France en 1777, Louis XVI lui ordonne de ne plus quitter ses habits féminins. Le chevalier, laissant planer le doute sur sa véritable identité, se présente désormais comme « la chevalière d’Éon ». En 1783, il retourne vivre en Angleterre, où il mourra.
 La Bête du Gévaudan aurait fait plus d'une centaine de victimes entre 1764 et 1767, dans la province du Gévaudan, dans le sud de l’Auvergne. Les blessures, extrêmement inhabituelles, telles que la taille des morsures et la décapitation, ne pouvaient être faites par un loup mais seulement par une «bête». Devant l'ampleur du massacre et l'inefficacité des seigneurs locaux, les paysans finirent par solliciter Louis XV. Battues officielles ou expéditions villageoises auront le plus grand mal à mettre fin aux meurtres et à la véritable psychose qui s'est alors emparée du pays de Gévaudan.
La Bête du Gévaudan aurait fait plus d'une centaine de victimes entre 1764 et 1767, dans la province du Gévaudan, dans le sud de l’Auvergne. Les blessures, extrêmement inhabituelles, telles que la taille des morsures et la décapitation, ne pouvaient être faites par un loup mais seulement par une «bête». Devant l'ampleur du massacre et l'inefficacité des seigneurs locaux, les paysans finirent par solliciter Louis XV. Battues officielles ou expéditions villageoises auront le plus grand mal à mettre fin aux meurtres et à la véritable psychose qui s'est alors emparée du pays de Gévaudan.
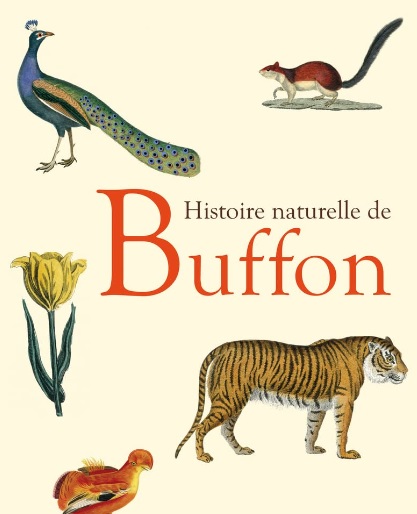 L’Histoire naturelle, générale et particulière est un ouvrage encyclopédique dirigé par Georges Buffon, constitué de 36 volumes parus entre 1749 et 1788. Il est considéré comme l’une des œuvres les plus marquantes du siècle des Lumières, au même titre que l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. L'Histoire naturelle de Buffon connaît un grand succès partout en Europe. Les thèses de ce scientifique sur l’homme et la Terre lui valent la condamnation de la Sorbonne car elles contredisent la Genèse. Buffon trouve toutefois des protecteurs influents et accède à l’Académie française.
L’Histoire naturelle, générale et particulière est un ouvrage encyclopédique dirigé par Georges Buffon, constitué de 36 volumes parus entre 1749 et 1788. Il est considéré comme l’une des œuvres les plus marquantes du siècle des Lumières, au même titre que l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. L'Histoire naturelle de Buffon connaît un grand succès partout en Europe. Les thèses de ce scientifique sur l’homme et la Terre lui valent la condamnation de la Sorbonne car elles contredisent la Genèse. Buffon trouve toutefois des protecteurs influents et accède à l’Académie française.
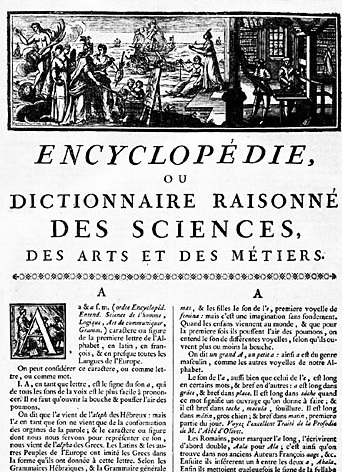 L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot et de Jean Le Rond d’Alembert a été publiée entre 1751 et 1772. Ce vaste projet empreint de l'esprit des Lumières comprend au total 28 volumes, dont 11 tomes d’illustrations. Le but de l’Encyclopédie est originellement de rassembler les connaissances acquises par l’humanité et de favoriser l’accession du peuple au savoir. Le matérialisme et la lutte contre le christianisme de Diderot participent des fondements de l’Encyclopédie, ce qui vaudra l'hostilité de la Cour et de l'Eglise. De nombreux scientifiques et hommes de lettres du XVIIIe siècle, tels Montesquieu, Voltaire ou Rousseau, ont apporté leur contribution à cet ouvrage, qui connaîtra un immense succès en France et en Europe, contribuant à la propagation de l'esprit des lumières.
L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot et de Jean Le Rond d’Alembert a été publiée entre 1751 et 1772. Ce vaste projet empreint de l'esprit des Lumières comprend au total 28 volumes, dont 11 tomes d’illustrations. Le but de l’Encyclopédie est originellement de rassembler les connaissances acquises par l’humanité et de favoriser l’accession du peuple au savoir. Le matérialisme et la lutte contre le christianisme de Diderot participent des fondements de l’Encyclopédie, ce qui vaudra l'hostilité de la Cour et de l'Eglise. De nombreux scientifiques et hommes de lettres du XVIIIe siècle, tels Montesquieu, Voltaire ou Rousseau, ont apporté leur contribution à cet ouvrage, qui connaîtra un immense succès en France et en Europe, contribuant à la propagation de l'esprit des lumières.
 Le Masque de fer, mort à la Bastille en 1703, est le plus célèbre et mystérieux des prisonniers français, sa véritable identité ayant fait l'objet de nombreuses spéculations. Dans le Siècle de Louis XIV, ouvrage paru en 1754, Voltaire est le premier à évoquer l'affaire du Masque de fer. Portant un masque de velours aux articulations de métal, il fut d'abord enfermé sur ordre du roi Louis XIV en 1679 à Pignerol, dans le Piémont, puis au château d'If, dans l'île Sainte-Marguerite. En 1698, le Masque de fer fut amené à la Bastille, où il mourut en 1703. On sait peu de chose de cet inconnu. Sa véritable identité fait l'objet, dès l'origine, de nombreuses hypothèses, dont bon nombre ont été abandonnées.
Le Masque de fer, mort à la Bastille en 1703, est le plus célèbre et mystérieux des prisonniers français, sa véritable identité ayant fait l'objet de nombreuses spéculations. Dans le Siècle de Louis XIV, ouvrage paru en 1754, Voltaire est le premier à évoquer l'affaire du Masque de fer. Portant un masque de velours aux articulations de métal, il fut d'abord enfermé sur ordre du roi Louis XIV en 1679 à Pignerol, dans le Piémont, puis au château d'If, dans l'île Sainte-Marguerite. En 1698, le Masque de fer fut amené à la Bastille, où il mourut en 1703. On sait peu de chose de cet inconnu. Sa véritable identité fait l'objet, dès l'origine, de nombreuses hypothèses, dont bon nombre ont été abandonnées.
 Après un « triste XVIIème siècle » marqué par de nombreuses difficultés économiques et tensions sociales, le XVIIIème siècle est placé sous le signe de mutations et d'évolutions significatives. Le Siècle des Lumières va voir la foi dans le progrès de la raison et des techniques l'emporter et devenir le cheval de bataille de certains pour un mieux être général. Alors que la société est marquée depuis plusieurs siècles par trois contraintes très fortes (biologique, alimentaire et matérielle), assurément le XVIIIème siècle illustre une conjoncture plus favorable qui va faire sauter petit à petit ces 3 verrous. Ce phénomène est nettement observable au niveau de la population qui augmente, et de l'agriculture qui connaît des évolutions décisives sur le plan technique, structurel et cultural.
Après un « triste XVIIème siècle » marqué par de nombreuses difficultés économiques et tensions sociales, le XVIIIème siècle est placé sous le signe de mutations et d'évolutions significatives. Le Siècle des Lumières va voir la foi dans le progrès de la raison et des techniques l'emporter et devenir le cheval de bataille de certains pour un mieux être général. Alors que la société est marquée depuis plusieurs siècles par trois contraintes très fortes (biologique, alimentaire et matérielle), assurément le XVIIIème siècle illustre une conjoncture plus favorable qui va faire sauter petit à petit ces 3 verrous. Ce phénomène est nettement observable au niveau de la population qui augmente, et de l'agriculture qui connaît des évolutions décisives sur le plan technique, structurel et cultural.
 Commencée avec l’ouverture des états généraux (mai 1789), la Révolution française a provoqué le renversement de la monarchie et de l’ordre social de l’Ancien Régime reposant sur trois classes distinctes dont les droits devant la loi et devant l’impôt étaient inégaux. Après une période modérée, marquée par l’abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (août 1789), la Révolution se radicalise à partir de la fuite du roi à Varennes (juin 1791) et l’entrée en guerre contre les puissances européennes (avril 1792). Au lendemain de la chute de la monarchie (août 1792) et de l’instauration de la République (septembre 1792), la Terreur est à l’ordre du jour, mais les modérés renversent Robespierre (juillet 1794), puis instaurent le Directoire (octobre 1795). Lui succèdera enfin le Consulat en 1799, prélude de l'épopée napoléonienne.
Commencée avec l’ouverture des états généraux (mai 1789), la Révolution française a provoqué le renversement de la monarchie et de l’ordre social de l’Ancien Régime reposant sur trois classes distinctes dont les droits devant la loi et devant l’impôt étaient inégaux. Après une période modérée, marquée par l’abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (août 1789), la Révolution se radicalise à partir de la fuite du roi à Varennes (juin 1791) et l’entrée en guerre contre les puissances européennes (avril 1792). Au lendemain de la chute de la monarchie (août 1792) et de l’instauration de la République (septembre 1792), la Terreur est à l’ordre du jour, mais les modérés renversent Robespierre (juillet 1794), puis instaurent le Directoire (octobre 1795). Lui succèdera enfin le Consulat en 1799, prélude de l'épopée napoléonienne.
 Joachim Murat (1767-1815), maréchal de France et roi de Naples de 1808 à 1815, est considéré comme l’un des plus braves et sans conteste le plus extravagant des Maréchaux de Napoléon. Né fils d’aubergiste il devient roi et beau-frère d’empereur après s’être illustré parmi les plus grands sabreurs et charmeurs de l’épopée napoléonienne. Défenseur de l’idéal des Lumières, il devient en Italie un héros du mouvement nationaliste pour l’unification de la péninsule. Son destin incroyable, son panache, sa témérité et sa fin tragique en font un personnage que même les romanciers n’auraient osé inventer pour un comte du XIXème siècle…
Joachim Murat (1767-1815), maréchal de France et roi de Naples de 1808 à 1815, est considéré comme l’un des plus braves et sans conteste le plus extravagant des Maréchaux de Napoléon. Né fils d’aubergiste il devient roi et beau-frère d’empereur après s’être illustré parmi les plus grands sabreurs et charmeurs de l’épopée napoléonienne. Défenseur de l’idéal des Lumières, il devient en Italie un héros du mouvement nationaliste pour l’unification de la péninsule. Son destin incroyable, son panache, sa témérité et sa fin tragique en font un personnage que même les romanciers n’auraient osé inventer pour un comte du XIXème siècle…
 La campagne allemande de 1813 a été menée par Napoléon Bonaparte d'avril à octobre 1813 contre les armées de la sixième coalition. Tel le Phoenix renaissant de ses cendres, la Grande Armée, disparue dans les neiges russes en 1812, semble tout à coup renaitre dans les plaines de Saxe. Les Russes voient soudainement leur marche sur Paris interrompue par le sursaut de l'Empire français : des milliers de jeunes conscrits viennent leur barrer la route avec à leur tête le plus grand général de l'époque. Mais les victoires ne suffisent pas face au retournement des alliances qui voit la Prusse, l'Autriche et de nombreux états allemands se retourner contre Napoléon.
La campagne allemande de 1813 a été menée par Napoléon Bonaparte d'avril à octobre 1813 contre les armées de la sixième coalition. Tel le Phoenix renaissant de ses cendres, la Grande Armée, disparue dans les neiges russes en 1812, semble tout à coup renaitre dans les plaines de Saxe. Les Russes voient soudainement leur marche sur Paris interrompue par le sursaut de l'Empire français : des milliers de jeunes conscrits viennent leur barrer la route avec à leur tête le plus grand général de l'époque. Mais les victoires ne suffisent pas face au retournement des alliances qui voit la Prusse, l'Autriche et de nombreux états allemands se retourner contre Napoléon.
 Entre les Etats Généraux de mai 1789 et la proclamation du Consulat avec Napoléon Bonaparte en 1799, la France a connu l'une de ses plus longue crise financière. Plusieurs gouvernements différents, composés parfois d'extrémistes et/ou de spéculateurs aspirant toujours à plus d'argent, se sont succédés durant cette période sans parvenir à endiguer ce fléau. Ils procédèrent alors à des émissions successives de monnaie papier, ce qui relançait l'économie pour un temps. Ces émissions entrainèrent de plus en plus de spéculation et de plus en plus de dépréciation, jusqu'à ce que la monnaie papier ne valut plus rien et que la France fut ruinée.
Entre les Etats Généraux de mai 1789 et la proclamation du Consulat avec Napoléon Bonaparte en 1799, la France a connu l'une de ses plus longue crise financière. Plusieurs gouvernements différents, composés parfois d'extrémistes et/ou de spéculateurs aspirant toujours à plus d'argent, se sont succédés durant cette période sans parvenir à endiguer ce fléau. Ils procédèrent alors à des émissions successives de monnaie papier, ce qui relançait l'économie pour un temps. Ces émissions entrainèrent de plus en plus de spéculation et de plus en plus de dépréciation, jusqu'à ce que la monnaie papier ne valut plus rien et que la France fut ruinée.
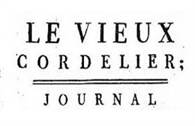 En 1789, dans le sillage de la Révolution française, naît une presse d’opinion qui profite de la liberté d’expression nouvellement acquise. Bien que sa diffusion soit limitée par les contraintes techniques de l’époque, cette presse exerce une forte influence sur le débat politique, chaque famille de pensée et chaque figure de la révolution disposant de sa feuille de chou : Hébert et son "Père Duchesne", Desmoulins et son "Vieux Cordeliers", Marat et "l'Ami du peuple". Voivi la génèse de la presse sous la révolution.
En 1789, dans le sillage de la Révolution française, naît une presse d’opinion qui profite de la liberté d’expression nouvellement acquise. Bien que sa diffusion soit limitée par les contraintes techniques de l’époque, cette presse exerce une forte influence sur le débat politique, chaque famille de pensée et chaque figure de la révolution disposant de sa feuille de chou : Hébert et son "Père Duchesne", Desmoulins et son "Vieux Cordeliers", Marat et "l'Ami du peuple". Voivi la génèse de la presse sous la révolution.
 Les Cent Jours constituent le dernier épisode du Premier Empire, de l’entrée de Napoléon Ier dans Paris (20 mars 1815) à sa seconde abdication (22 juin 1815). Après s'être échappé de l'île d'Elbe et avoir débarqué à Golfe-Juan le 1er mars, Napoléon Bonaparte traverse les Alpes par une route qui porte depuis le nom de « route Napoléon ». L'ultime vol de l'aigle se poursuit jusqu'à l'entrée dans la capitale, suscitant au passage de l'empereur l’enthousiasme grandissant de la population. Il retrouve le pouvoir, laissé vacant par la fuite de Louis XVIII, durant cent jours. La défaite de Waterloo le contraint à abdiquer une seconde fois le 22 juin. Il est exilé à Sainte-Hélène.
Les Cent Jours constituent le dernier épisode du Premier Empire, de l’entrée de Napoléon Ier dans Paris (20 mars 1815) à sa seconde abdication (22 juin 1815). Après s'être échappé de l'île d'Elbe et avoir débarqué à Golfe-Juan le 1er mars, Napoléon Bonaparte traverse les Alpes par une route qui porte depuis le nom de « route Napoléon ». L'ultime vol de l'aigle se poursuit jusqu'à l'entrée dans la capitale, suscitant au passage de l'empereur l’enthousiasme grandissant de la population. Il retrouve le pouvoir, laissé vacant par la fuite de Louis XVIII, durant cent jours. La défaite de Waterloo le contraint à abdiquer une seconde fois le 22 juin. Il est exilé à Sainte-Hélène.
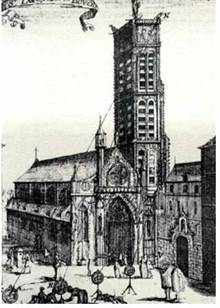 La période de la Révolution française est souvent vue avant tout comme un affrontement violent entre deux ordres, le Tiers-Etat et la noblesse, avec comme point d’orgue l’exécution de Louis XVI en 1793. Le facteur religieux est en partie relégué au second plan. Pourtant, le clergé est un ordre également, au moins aussi puissant que la noblesse, et surtout la religion tient une place centrale dans une France très croyante et au sein d’une monarchie de droit divin. Nous aborderons donc les rapports entre Révolution et religion, en commençant par la situation avant 1789.
La période de la Révolution française est souvent vue avant tout comme un affrontement violent entre deux ordres, le Tiers-Etat et la noblesse, avec comme point d’orgue l’exécution de Louis XVI en 1793. Le facteur religieux est en partie relégué au second plan. Pourtant, le clergé est un ordre également, au moins aussi puissant que la noblesse, et surtout la religion tient une place centrale dans une France très croyante et au sein d’une monarchie de droit divin. Nous aborderons donc les rapports entre Révolution et religion, en commençant par la situation avant 1789.
 Après avoir mis fin à l'Ancien régime et à la monarchie absolue, la Révolution française met en place d'un nouveau régime politique : la monarchie constitutionnelle. Elle constitue « une avancée démocratique » de par la nature de ses institutions même. S'inspirant du modèle anglais, la constitution émane de la nation et pose les règles du gouvernement. L'Assemblée nationale, qui représente la nation, incarne désormais le droit face au monarque détenteur du pouvoir excécutif. Les divisions au sein du camp révolutionnaire et la résistance de Louis XVI feront tourner court cette première expérience politique.
Après avoir mis fin à l'Ancien régime et à la monarchie absolue, la Révolution française met en place d'un nouveau régime politique : la monarchie constitutionnelle. Elle constitue « une avancée démocratique » de par la nature de ses institutions même. S'inspirant du modèle anglais, la constitution émane de la nation et pose les règles du gouvernement. L'Assemblée nationale, qui représente la nation, incarne désormais le droit face au monarque détenteur du pouvoir excécutif. Les divisions au sein du camp révolutionnaire et la résistance de Louis XVI feront tourner court cette première expérience politique.
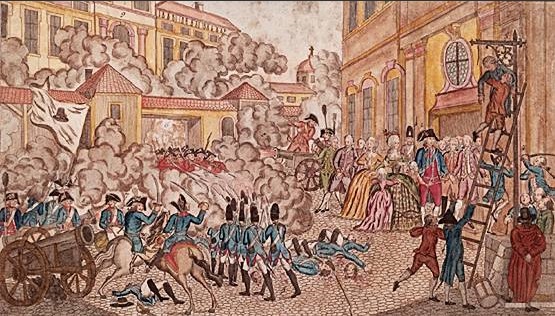 Le 10 août 1792 est une grande journée insurrectionnelle de la Révolution française au cours de laquelle les parisiens ont pris d’assaut le palais des Tuileries et mis fin à la monarchie constitutionnelle. Elle a pour origine un manifeste du duc de Brunswick, chef de l'armée prussienne, qui promet aux révolutionnaires de terribles représailles si la famille royale est menacée. Les parisiens répondent par une insurrection qui conduit à la prise du palais des Tuileries où réside Louis XVI, à l'issue d'une violente bataille qui fait plus de 1000 morts parmi les défenseurs. Le roi, qui s'est réfugié à l'Assemblée législative avec sa famille, est suspendu et enfermé dans la tour du Temple avec les siens.
Le 10 août 1792 est une grande journée insurrectionnelle de la Révolution française au cours de laquelle les parisiens ont pris d’assaut le palais des Tuileries et mis fin à la monarchie constitutionnelle. Elle a pour origine un manifeste du duc de Brunswick, chef de l'armée prussienne, qui promet aux révolutionnaires de terribles représailles si la famille royale est menacée. Les parisiens répondent par une insurrection qui conduit à la prise du palais des Tuileries où réside Louis XVI, à l'issue d'une violente bataille qui fait plus de 1000 morts parmi les défenseurs. Le roi, qui s'est réfugié à l'Assemblée législative avec sa famille, est suspendu et enfermé dans la tour du Temple avec les siens.
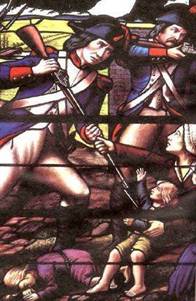 Entre 1793 et 1796, la guerre de Vendée a opposé des révoltés catholiques et royalistes de l'ouest de la France aux troupes républicaines du gouvernement révolutionnaire. Durant cette période, ce sont environ 200.000 Vendéens qui seront massacrés. La Vendée, dépeuplée et ruinée, mettra près d'un siècle à se rétablir. Certains historiens ont été jusqu'à parler d'un génocide vendéen. Ainsi Reynald Sécher n’hésite alors pas à faire le parallèle et à parler de génocide vendéen, un terme totalement rejeté par une partie des historiens comme Jean-Clément Martin. L’historiographie semble alors se scinder en deux groupes : les « blancs » partisans du terme de génocide, et les « bleus » qui refusent que ce terme entache la République. Qu’en est-il vraiment ?
Entre 1793 et 1796, la guerre de Vendée a opposé des révoltés catholiques et royalistes de l'ouest de la France aux troupes républicaines du gouvernement révolutionnaire. Durant cette période, ce sont environ 200.000 Vendéens qui seront massacrés. La Vendée, dépeuplée et ruinée, mettra près d'un siècle à se rétablir. Certains historiens ont été jusqu'à parler d'un génocide vendéen. Ainsi Reynald Sécher n’hésite alors pas à faire le parallèle et à parler de génocide vendéen, un terme totalement rejeté par une partie des historiens comme Jean-Clément Martin. L’historiographie semble alors se scinder en deux groupes : les « blancs » partisans du terme de génocide, et les « bleus » qui refusent que ce terme entache la République. Qu’en est-il vraiment ?
 Les années folles en France désignent la période entre les années 1920 et 1929, une décennie marquée par un spectaculaire redressement économique et une grande effervescence culturelle et intellectuelle. A la faveur de la détente internationale, l’industrie française s’impose sur les marchés européens et les niveaux de vie s’améliorent. Paris devient un centre actif de création littéraire et artistique. Traumatisée par la douloureuse expérience de la Première Guerre mondiale, la société française change parallèlement de visage tandis qu'une minorité donne naissance aux « Années Folles », période représentative du désir de celle-ci d'oublier la guerre et de se divertir.
Les années folles en France désignent la période entre les années 1920 et 1929, une décennie marquée par un spectaculaire redressement économique et une grande effervescence culturelle et intellectuelle. A la faveur de la détente internationale, l’industrie française s’impose sur les marchés européens et les niveaux de vie s’améliorent. Paris devient un centre actif de création littéraire et artistique. Traumatisée par la douloureuse expérience de la Première Guerre mondiale, la société française change parallèlement de visage tandis qu'une minorité donne naissance aux « Années Folles », période représentative du désir de celle-ci d'oublier la guerre et de se divertir.
 La libération de Paris (19-25 août 1944) est un mouvement insurrectionnel qui a chassé les occupants allemands de la capitale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle est actée le 25 août 1944 à la gare Montparnasse par le général Dietrich Von Choltitz qui signe l’acte de reddition des troupes allemandes, en présence du général Leclerc et du colonel Rol-Tanguy. C’est la fin d’une occupation débutée le 14 juin 1940. Réalisée dans une atmosphère électrique, marquée par la confusion tant du côté allié que du côté allemand, la libération de Paris constitue à bien des égards un condensé des enjeux politiques et militaires de la seconde campagne de France. Aventure magnifiée par le fameux « Paris brûle t-il ? » de Collins et Lapierre, cet événement tient une place toute particulière dans la mythologie contemporaine de l'histoire de France.
La libération de Paris (19-25 août 1944) est un mouvement insurrectionnel qui a chassé les occupants allemands de la capitale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle est actée le 25 août 1944 à la gare Montparnasse par le général Dietrich Von Choltitz qui signe l’acte de reddition des troupes allemandes, en présence du général Leclerc et du colonel Rol-Tanguy. C’est la fin d’une occupation débutée le 14 juin 1940. Réalisée dans une atmosphère électrique, marquée par la confusion tant du côté allié que du côté allemand, la libération de Paris constitue à bien des égards un condensé des enjeux politiques et militaires de la seconde campagne de France. Aventure magnifiée par le fameux « Paris brûle t-il ? » de Collins et Lapierre, cet événement tient une place toute particulière dans la mythologie contemporaine de l'histoire de France.
 Entre 1940 et 1945, durant la Seconde Guerre mondiale, les « résistants » sont les hommes et les femmes qui luttaient clandestinement contre l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler, alors que leur pays lui est soumis. En France, la résistance est née avec l’appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle, et a pris fin avec la libération de Paris et de la France en août 1944. Entrer en résistance est alors une décision lourde de conséquences, que beaucoup ont payée de leur vie.
Entre 1940 et 1945, durant la Seconde Guerre mondiale, les « résistants » sont les hommes et les femmes qui luttaient clandestinement contre l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler, alors que leur pays lui est soumis. En France, la résistance est née avec l’appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle, et a pris fin avec la libération de Paris et de la France en août 1944. Entrer en résistance est alors une décision lourde de conséquences, que beaucoup ont payée de leur vie.
 Les civils dans la première guerre mondiale, comme les « poilus », ont vécu les conflits à la fois en tant que spectateurs et acteurs, mais bien plus souvent comme protagonistes, situés au cœur du premier conflit mondial. L'étude des civils fut relayée au second plan durant des décennies, masquée par les actes héroïques des « poilus » et les batailles aux noms retentissants encore aujourd'hui. Pourtant, certains chercheurs ne portèrent leurs investigations sur cette catégorie de Français ayant vécu la « Grande Guerre » que depuis quelques années.
Les civils dans la première guerre mondiale, comme les « poilus », ont vécu les conflits à la fois en tant que spectateurs et acteurs, mais bien plus souvent comme protagonistes, situés au cœur du premier conflit mondial. L'étude des civils fut relayée au second plan durant des décennies, masquée par les actes héroïques des « poilus » et les batailles aux noms retentissants encore aujourd'hui. Pourtant, certains chercheurs ne portèrent leurs investigations sur cette catégorie de Français ayant vécu la « Grande Guerre » que depuis quelques années.
 Le Front populaire était une coalition de différents partis de gauche qui a gouverné la France de juin 1936 à avril 1938. Événement majeur dans la mémoire de la gauche française, l'arrivée du Front populaire au gouvernement sous la direction de Léon Blum a été motivée en partie par les violences du 6 février 1934. La gauche, jusque-là désunie entre radicaux, socialistes et communistes, s'allie pour faire front, face à la montée de l’extrême droite. Une vague de grèves sans précédent vient renforcer le gouvernement dans ses négociations avec les patrons. Le bilan est important, avec les congés payés, les conventions collectives, la hausse des salaires...
Le Front populaire était une coalition de différents partis de gauche qui a gouverné la France de juin 1936 à avril 1938. Événement majeur dans la mémoire de la gauche française, l'arrivée du Front populaire au gouvernement sous la direction de Léon Blum a été motivée en partie par les violences du 6 février 1934. La gauche, jusque-là désunie entre radicaux, socialistes et communistes, s'allie pour faire front, face à la montée de l’extrême droite. Une vague de grèves sans précédent vient renforcer le gouvernement dans ses négociations avec les patrons. Le bilan est important, avec les congés payés, les conventions collectives, la hausse des salaires...
 Après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la quasi totalité des communes de France érigent des monuments aux morts pour commémorer le souvenir des hommes tombés au combat. Il existe un malentendu, ancien, quant à la véritable signification de ces monuments. Intégrés à la mémoire républicaine. Ces lieux de mémoire qui accueillent des hommes bardés de décorations, de drapeaux tricolores, entonnant La Marseillaise, laisse planer le doute sur la véritable interprétation qui doit être donnée à ces monuments. S'agit-il dès lors de monuments républicains ou de monuments nationalistes ?
Après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la quasi totalité des communes de France érigent des monuments aux morts pour commémorer le souvenir des hommes tombés au combat. Il existe un malentendu, ancien, quant à la véritable signification de ces monuments. Intégrés à la mémoire républicaine. Ces lieux de mémoire qui accueillent des hommes bardés de décorations, de drapeaux tricolores, entonnant La Marseillaise, laisse planer le doute sur la véritable interprétation qui doit être donnée à ces monuments. S'agit-il dès lors de monuments républicains ou de monuments nationalistes ?
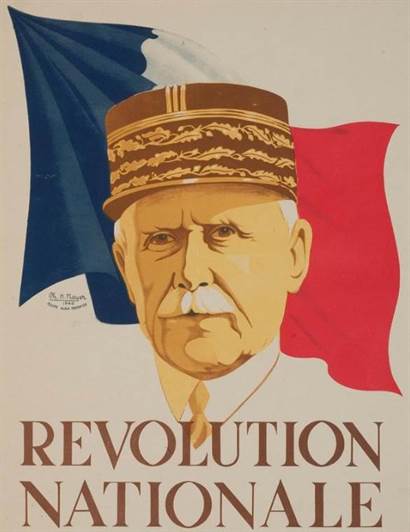 Le régime de Vichy est le surnom donné à l’État français qui a succédé à la IIIe république au lendemain de la défaite de mai-juin 1940. Du 10 juillet 1940 au mois d’août 1944, la France, vaincue et occupée, est soumise à un régime autoritaire sous la direction du maréchal Pétain qui accepte de collaborer avec les nazis. Installé dans la ville thermale de Vichy, le nouveau régime réduit les libertés, mène une politique antisémite et développe une propagande d'extrême droite sur le thème de la « Révolution nationale ». La nouvelle devise « Travail, famille, patrie » se substitue à la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». Bénéficiant un temps du soutien d'une majorité de la population française, le régime de Vichy ne survivra pas à la libération de la France en 1944 et ses principaux dirigeants, dont Pétain, seront jugés et condamnés entre 1945 et 1946.
Le régime de Vichy est le surnom donné à l’État français qui a succédé à la IIIe république au lendemain de la défaite de mai-juin 1940. Du 10 juillet 1940 au mois d’août 1944, la France, vaincue et occupée, est soumise à un régime autoritaire sous la direction du maréchal Pétain qui accepte de collaborer avec les nazis. Installé dans la ville thermale de Vichy, le nouveau régime réduit les libertés, mène une politique antisémite et développe une propagande d'extrême droite sur le thème de la « Révolution nationale ». La nouvelle devise « Travail, famille, patrie » se substitue à la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». Bénéficiant un temps du soutien d'une majorité de la population française, le régime de Vichy ne survivra pas à la libération de la France en 1944 et ses principaux dirigeants, dont Pétain, seront jugés et condamnés entre 1945 et 1946.
 Après la défaite de juin 1940, la radio va devenir l'instrument d'une guerre des ondes opposant la Résistance avec Radio Londres d'une part, et les forces d'occupations allemandes et de collaboration avec Radio Paris et Radio Vichy d'autre part. C'est le général de Gaulle qui ouvre les hostilités dès le 18 juin en incitant les Français à la résistance dans son célèbre discours radiodiffusé par la BBC. Rapidement, les français seront de plus en plus nombreux à tenter de capter les émissions françaises de la BBC, où se côtoient messages confidentiels et émissions d’information, animées notamment par Maurice Schumann et Pierre Dac, qui figurent parmi les plus connues des « voix de la France ».
Après la défaite de juin 1940, la radio va devenir l'instrument d'une guerre des ondes opposant la Résistance avec Radio Londres d'une part, et les forces d'occupations allemandes et de collaboration avec Radio Paris et Radio Vichy d'autre part. C'est le général de Gaulle qui ouvre les hostilités dès le 18 juin en incitant les Français à la résistance dans son célèbre discours radiodiffusé par la BBC. Rapidement, les français seront de plus en plus nombreux à tenter de capter les émissions françaises de la BBC, où se côtoient messages confidentiels et émissions d’information, animées notamment par Maurice Schumann et Pierre Dac, qui figurent parmi les plus connues des « voix de la France ».
 Les 16 et 17 juillet 1942, lors de la rafle du Vel d'Hiv, la police française procéda à l'arrestation massive de milliers de Juifs, sur ordre du gouvernement de Vichy. Hommes femmes et enfants furent bientôt ramenés au sein de l'enceinte du Vélodrome d'Hiver, à Paris, lieu du commencement. Non le commencement d'une vie, mais plutôt le début d'une mort. Il faudra attendre 1995 et un discours du président Jacques Chirac pour que soit reconnu la souillure que représente ces heures noires de l'histoire de France.
Les 16 et 17 juillet 1942, lors de la rafle du Vel d'Hiv, la police française procéda à l'arrestation massive de milliers de Juifs, sur ordre du gouvernement de Vichy. Hommes femmes et enfants furent bientôt ramenés au sein de l'enceinte du Vélodrome d'Hiver, à Paris, lieu du commencement. Non le commencement d'une vie, mais plutôt le début d'une mort. Il faudra attendre 1995 et un discours du président Jacques Chirac pour que soit reconnu la souillure que représente ces heures noires de l'histoire de France.
 C'est un épisode méconnu de l'histoire de France. Durant la seconde guerre mondiale, 19.000 jeunes Français (hommes et femmes), ont franchi les Pyrénées au risque de leur vie. Ils se sont engagés volontairement dans les Forces Françaises Combattantes après plusieurs mois d’ internement en Espagne dans des geôles sordides. 4 à 5.000 d’entre eux s’engagèrent dans la 2ème DB, les autres entrèrent dans tous les corps de l’Armée française en formation en Afrique du Nord. Voici l'histoire oubliée des évadés de France.
C'est un épisode méconnu de l'histoire de France. Durant la seconde guerre mondiale, 19.000 jeunes Français (hommes et femmes), ont franchi les Pyrénées au risque de leur vie. Ils se sont engagés volontairement dans les Forces Françaises Combattantes après plusieurs mois d’ internement en Espagne dans des geôles sordides. 4 à 5.000 d’entre eux s’engagèrent dans la 2ème DB, les autres entrèrent dans tous les corps de l’Armée française en formation en Afrique du Nord. Voici l'histoire oubliée des évadés de France.
 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le château de Versailles nécessite des travaux de restauration considérables. Après la disparition tragique du conservateur Charles Mauricheau-Beaupré et parmi la foule de postulants à ce poste recherché, Gérald Van Der Kemp sort du lot. Pendant vingt-sept ans, il sera le Conservateur en Chef de Versailles. Il va lancer de vastes chantiers de restauration et remeubler les anciens appartements grâce aux donations de nombreux bienfaiteurs, posant les bases du mécénat moderne.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le château de Versailles nécessite des travaux de restauration considérables. Après la disparition tragique du conservateur Charles Mauricheau-Beaupré et parmi la foule de postulants à ce poste recherché, Gérald Van Der Kemp sort du lot. Pendant vingt-sept ans, il sera le Conservateur en Chef de Versailles. Il va lancer de vastes chantiers de restauration et remeubler les anciens appartements grâce aux donations de nombreux bienfaiteurs, posant les bases du mécénat moderne.
 Le 18 mars 1962 sont signés, à Evian, les accords qui vont mettre fin à cette guerre qui ne dit pas son nom, la guerre d'Algérie. Les représentants du GPRA et du gouvernement français s'entendent pour mettre en place un cessez-le-feu immédiat (prenant effet le 19 mars). Les accords d’Evian comportent également des clauses politiques et militaires, qui ouvrent la possibilité à une autodétermination de l’Algérie. Cependant, on peut se poser la question : ces accords finalement mal connus mais très contestés ont-ils été appliqués ?
Le 18 mars 1962 sont signés, à Evian, les accords qui vont mettre fin à cette guerre qui ne dit pas son nom, la guerre d'Algérie. Les représentants du GPRA et du gouvernement français s'entendent pour mettre en place un cessez-le-feu immédiat (prenant effet le 19 mars). Les accords d’Evian comportent également des clauses politiques et militaires, qui ouvrent la possibilité à une autodétermination de l’Algérie. Cependant, on peut se poser la question : ces accords finalement mal connus mais très contestés ont-ils été appliqués ?
 Mai 68 est un mouvement de contestation politique, sociale et culturelle qui a éclaté en France en mai-juin 1968. Elle a pris naissance dans les universités où les étudiants s’inquiètent de leur avenir et rejettent le système de sélection. Ils expriment en même temps leur aspiration à d’autres formes de rapports humains, à une évolution libérales des moeurs et à une abolition des hiérarchies. Ce mouvement de contestation étudiante devient un mouvement social lorsque les syndicats appellent à leur tour à la grève. Après avoir vacillé, le pouvoir gaulliste et les institutions sortiront renforcés de l’épreuve de la crise de mai 68. Cette dernière initiera néanmoins de profonds changements dans la société française.
Mai 68 est un mouvement de contestation politique, sociale et culturelle qui a éclaté en France en mai-juin 1968. Elle a pris naissance dans les universités où les étudiants s’inquiètent de leur avenir et rejettent le système de sélection. Ils expriment en même temps leur aspiration à d’autres formes de rapports humains, à une évolution libérales des moeurs et à une abolition des hiérarchies. Ce mouvement de contestation étudiante devient un mouvement social lorsque les syndicats appellent à leur tour à la grève. Après avoir vacillé, le pouvoir gaulliste et les institutions sortiront renforcés de l’épreuve de la crise de mai 68. Cette dernière initiera néanmoins de profonds changements dans la société française.
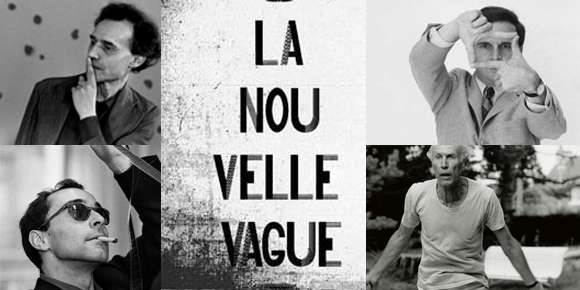 La Nouvelle Vague est un mouvement cinématographique apparu à la fin des années 1950 en France, mais également en Europe et sur le continent américain, visant à renouveler une expression artistique jugée en déclin. Au tournant des années 1960, de jeunes réalisateurs dénoncent la léthargie dans laquelle le cinéma français est plongé. À travers leurs œuvres, ils décrivent les mœurs d'une jeunesse révoltée en quête de liberté. Ils imposent finalement leur conception du 7e art en France et dans de nombreux pays étrangers.
La Nouvelle Vague est un mouvement cinématographique apparu à la fin des années 1950 en France, mais également en Europe et sur le continent américain, visant à renouveler une expression artistique jugée en déclin. Au tournant des années 1960, de jeunes réalisateurs dénoncent la léthargie dans laquelle le cinéma français est plongé. À travers leurs œuvres, ils décrivent les mœurs d'une jeunesse révoltée en quête de liberté. Ils imposent finalement leur conception du 7e art en France et dans de nombreux pays étrangers.
 La période qui s'étend de la Libération aux années 70 est une période de prospérité que l'économiste Jean Fourastié appelle les «Trente Glorieuses». A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est dévastée. Des villes complètement détruites doivent être reconstruites. Afin de relancer l'économie moribonde, des réformes profondes sont entreprises avec une intervention massive de l’État dans le secteur productif, financée par l’assistance américaine accordée dans le cadre du plan Marshall. On parle alors de miracle économique durant lequel la France connaît une croissance importante et une élévation du niveau de vie.
La période qui s'étend de la Libération aux années 70 est une période de prospérité que l'économiste Jean Fourastié appelle les «Trente Glorieuses». A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est dévastée. Des villes complètement détruites doivent être reconstruites. Afin de relancer l'économie moribonde, des réformes profondes sont entreprises avec une intervention massive de l’État dans le secteur productif, financée par l’assistance américaine accordée dans le cadre du plan Marshall. On parle alors de miracle économique durant lequel la France connaît une croissance importante et une élévation du niveau de vie.
 Klaus Barbie est un officier SS du SD (Services de contre-espionnage allemand) arrivé en France en juin 1942. Celui qui s’est déjà fait remarquer en Russie, pour ses qualités dans la lutte contre-insurrectionnelle, devient rapidement le chef de la Gestapo Lyonnaise (février 1943). Surnommé « le bourreau de Lyon », il est responsable de la torture et de l’assassinat de Jean Moulin et de nombreux autres membres de la Résistance, ainsi que de la rafle des enfants d’Izieu. Réfugié en Amérique du sud après la fin de la guerre, il sera identifié par Serge et Beate Klarsfeld, extradé vers la France puis condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité le 4 juillet 1987.
Klaus Barbie est un officier SS du SD (Services de contre-espionnage allemand) arrivé en France en juin 1942. Celui qui s’est déjà fait remarquer en Russie, pour ses qualités dans la lutte contre-insurrectionnelle, devient rapidement le chef de la Gestapo Lyonnaise (février 1943). Surnommé « le bourreau de Lyon », il est responsable de la torture et de l’assassinat de Jean Moulin et de nombreux autres membres de la Résistance, ainsi que de la rafle des enfants d’Izieu. Réfugié en Amérique du sud après la fin de la guerre, il sera identifié par Serge et Beate Klarsfeld, extradé vers la France puis condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité le 4 juillet 1987.
 L'abolition de la peine de mort en France le 18 septembre 1981 est l'aboutissement d'un long processus commencé au début du XXe siècle. Jusque dans les années 1980, le débat sur la peine capitale avait été périodiquement relancé en France, dernière nation européenne à la maintenir. L'abolition faisant partie du programme de la gauche, un projet de loi en ce sens est présenté à l’Assemblée nationale aussitôt après l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Porté par le ministre de la justice Robert Badinter, ce projet de loi finira par être adopté malgré la profonde division de l'opinion publique et de la classe politique sur le sujet;
L'abolition de la peine de mort en France le 18 septembre 1981 est l'aboutissement d'un long processus commencé au début du XXe siècle. Jusque dans les années 1980, le débat sur la peine capitale avait été périodiquement relancé en France, dernière nation européenne à la maintenir. L'abolition faisant partie du programme de la gauche, un projet de loi en ce sens est présenté à l’Assemblée nationale aussitôt après l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Porté par le ministre de la justice Robert Badinter, ce projet de loi finira par être adopté malgré la profonde division de l'opinion publique et de la classe politique sur le sujet;
 Le 17 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie et à l'appel du FLN, des milliers de manifestants défilent sans violence dans un Paris sous tension. La réaction de la police, dirigée par un certain Maurice Papon, est très violente : les manifestants sont poursuivis et roués de coups, balancés dans la Seine ou arrêtés. Le bilan -grand sujet de controverses- est très lourd. Pourtant, l’événement, à l’image de Sétif (8 mai 1945), malgré son ampleur et sa violence, demeure cinquante ans après encore peu connu du public. En 2012, le président François Hollande a reconnu la responsabilité de l'Etat dans ce massacre.
Le 17 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie et à l'appel du FLN, des milliers de manifestants défilent sans violence dans un Paris sous tension. La réaction de la police, dirigée par un certain Maurice Papon, est très violente : les manifestants sont poursuivis et roués de coups, balancés dans la Seine ou arrêtés. Le bilan -grand sujet de controverses- est très lourd. Pourtant, l’événement, à l’image de Sétif (8 mai 1945), malgré son ampleur et sa violence, demeure cinquante ans après encore peu connu du public. En 2012, le président François Hollande a reconnu la responsabilité de l'Etat dans ce massacre.
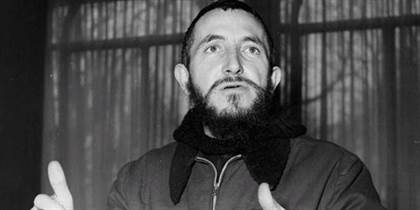 Durant l'hiver 1954, de terribles vagues de froid s'abattent sur la France, causant de nombreuses victimes parmi les sans-logis. L'occasion pour l'abbé Pierre, fondateur cinq ans auparavant du mouvement Emmaüs, de lancer un vibrant appel pour sensibiliser population et pouvoirs publics au sort des plus démunis. Symbole vivant d'une fin de siècle caritative, son action sera immortalisée au cinéma par le film Hiver 54 de Denis Amar avec Lambert Wilson.
Durant l'hiver 1954, de terribles vagues de froid s'abattent sur la France, causant de nombreuses victimes parmi les sans-logis. L'occasion pour l'abbé Pierre, fondateur cinq ans auparavant du mouvement Emmaüs, de lancer un vibrant appel pour sensibiliser population et pouvoirs publics au sort des plus démunis. Symbole vivant d'une fin de siècle caritative, son action sera immortalisée au cinéma par le film Hiver 54 de Denis Amar avec Lambert Wilson.
 Dès 1944, la France Libre et De Gaulle réfléchissent aux réformes sociales et sociétales qu'il faudra mettre en place une fois la paix revenue: le droit de vote des femmes en france est une mesure hautement symbolique et attendue depuis longtemps. Depuis près d'un siècle, les Françaises sont en effet exclues du suffrage universel, et la France sera l'un des derniers pays européens à remédier à cette anomalie. C'est aux élections municipales du 29 avril 1945 que les femmes votent pour la première fois.
Dès 1944, la France Libre et De Gaulle réfléchissent aux réformes sociales et sociétales qu'il faudra mettre en place une fois la paix revenue: le droit de vote des femmes en france est une mesure hautement symbolique et attendue depuis longtemps. Depuis près d'un siècle, les Françaises sont en effet exclues du suffrage universel, et la France sera l'un des derniers pays européens à remédier à cette anomalie. C'est aux élections municipales du 29 avril 1945 que les femmes votent pour la première fois.
 Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) a été le premier président de la République de 1849 à 1852, puis le dernier empereur des Français de 1852 à 1870, sous le nom de Napoléon III. Après avoir renforcé son pouvoir lors du coup d’État de 1851, il mène une politique autoritaire, réprimant les oppositions et contrôlant la presse. Son règne est cependant marqué par le développement économique de la France : le pays entre avec succès dans l’ère industrielle ; le chemin de fer se développe et pénètre dans les campagnes ; Paris se modernise grâce aux grands travaux du baron Haussmann. Son oeuvre, oscillant entre grandeur et décadence, fut longtemps occultée par sa défaite et sa chute lors de la guerre de 1870. Pourtant, le neveu de Napoléon Bonaparte peut être considéré comme l'un des bâtisseurs de la France moderne, et la Ve République est l'héritière directe de son « césarisme », tant critiqué à l'époque.
Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) a été le premier président de la République de 1849 à 1852, puis le dernier empereur des Français de 1852 à 1870, sous le nom de Napoléon III. Après avoir renforcé son pouvoir lors du coup d’État de 1851, il mène une politique autoritaire, réprimant les oppositions et contrôlant la presse. Son règne est cependant marqué par le développement économique de la France : le pays entre avec succès dans l’ère industrielle ; le chemin de fer se développe et pénètre dans les campagnes ; Paris se modernise grâce aux grands travaux du baron Haussmann. Son oeuvre, oscillant entre grandeur et décadence, fut longtemps occultée par sa défaite et sa chute lors de la guerre de 1870. Pourtant, le neveu de Napoléon Bonaparte peut être considéré comme l'un des bâtisseurs de la France moderne, et la Ve République est l'héritière directe de son « césarisme », tant critiqué à l'époque.
 Charles X (1757-1836) est le dernier roi de France de la maison des Bourbons (1824-1830). Opposé à toute tentative de réforme durant les États-Généraux de 1789, il fuit la France dès la prise de la Bastille, puis vit en Italie, en Prusse et en Autriche. Chef du parti ultraroyaliste durant le règne de Louis XVIII, il devint roi à la mort de ce dernier. Le ministère autoritaire et réactionnaire de Villèle lui valut une impopularité que ne diminuèrent ni la victoire de Navarin ni l'avènement du ministère Martignac (1828), plus libéral. Les ordonnances du 25 juillet 1830, dissolvant la Chambre, non encore réunie, modifiant la Charte et supprimant la liberté de la presse, provoquèrent la révolution de juillet 1830 et l'abdication de Charles X (2 août), qui mourut en exil.
Charles X (1757-1836) est le dernier roi de France de la maison des Bourbons (1824-1830). Opposé à toute tentative de réforme durant les États-Généraux de 1789, il fuit la France dès la prise de la Bastille, puis vit en Italie, en Prusse et en Autriche. Chef du parti ultraroyaliste durant le règne de Louis XVIII, il devint roi à la mort de ce dernier. Le ministère autoritaire et réactionnaire de Villèle lui valut une impopularité que ne diminuèrent ni la victoire de Navarin ni l'avènement du ministère Martignac (1828), plus libéral. Les ordonnances du 25 juillet 1830, dissolvant la Chambre, non encore réunie, modifiant la Charte et supprimant la liberté de la presse, provoquèrent la révolution de juillet 1830 et l'abdication de Charles X (2 août), qui mourut en exil.
 Louis XIV, surnommé « le Grand » ou « le Roi Soleil », a été roi de France de 1643 à 1715. Au cours de son long règne d'une durée de 54 ans, le plus célèbre des bourbons mène de nombreuses et coûteuses guerres à travers l’Europe, tout en modernisant l'administration et en intervenant dans le développement économique du royaume. Ayant choisi le soleil comme emblème, Louis XIV a porté à son apogée l’absolutisme royal dans une France qui rayonne sur l'Europe, y compris dans les domaines des arts et des lettres, et son palais de Versailles devient le symbole de sa gloire et de la grandeur de la France. Lorsque le roi décède à l’âge de 77 ans, c’est son arrière-petit-fils, Louis XV, qui lui succède.
Louis XIV, surnommé « le Grand » ou « le Roi Soleil », a été roi de France de 1643 à 1715. Au cours de son long règne d'une durée de 54 ans, le plus célèbre des bourbons mène de nombreuses et coûteuses guerres à travers l’Europe, tout en modernisant l'administration et en intervenant dans le développement économique du royaume. Ayant choisi le soleil comme emblème, Louis XIV a porté à son apogée l’absolutisme royal dans une France qui rayonne sur l'Europe, y compris dans les domaines des arts et des lettres, et son palais de Versailles devient le symbole de sa gloire et de la grandeur de la France. Lorsque le roi décède à l’âge de 77 ans, c’est son arrière-petit-fils, Louis XV, qui lui succède.
 Henri III, roi de France de 1574 à 1589, a été le dernier souverain de la dynastie des Valois. Quatrième fils d'Henri II et Catherine de Médicis, il n'était pas destiné à régner. Habile législateur, il a manifesté une vive volonté d'unité nationale dans une France alors minée par les Guerres de religion. Intelligent et cultivé, ce monarque a laissé de lui une image contrastée, parfois otage d’une légende noire, où se mêlent homophobie et accusations d’inconstance voire de tyrannie. Au-delà de cette perception, son action politique a permit à son successeur Henri de Navarre de mettre fin à la guerre civile. Henri III est assassiné le 1er août 1589 par le moine dominicain fanatisé Jacques Clément
Henri III, roi de France de 1574 à 1589, a été le dernier souverain de la dynastie des Valois. Quatrième fils d'Henri II et Catherine de Médicis, il n'était pas destiné à régner. Habile législateur, il a manifesté une vive volonté d'unité nationale dans une France alors minée par les Guerres de religion. Intelligent et cultivé, ce monarque a laissé de lui une image contrastée, parfois otage d’une légende noire, où se mêlent homophobie et accusations d’inconstance voire de tyrannie. Au-delà de cette perception, son action politique a permit à son successeur Henri de Navarre de mettre fin à la guerre civile. Henri III est assassiné le 1er août 1589 par le moine dominicain fanatisé Jacques Clément
 Napoléon Bonaparte (1769-1821) a été un général français durant la Révolution, puis s’est proclamé Premier consul de 1800 à 1804, avant de devenir empereur des Français de 1804 à 1815, sous le nom de Napoléon Ier. Devenu très populaire après ses campagnes en Italie et en Égypte, il met un terme à la Révolution par le coup d'Etat du 18 brumaire. L’empereur s’attache à réorganiser l’administration de la France, rétablit les finances, développe l’enseignement public et promulgue le Code civil. Parallèlement, il consacre la plupart de son temps à la guerre : enchainant de nombreuses victoires militaires (dont Austerlitz), il règne un temps sur l'Europe continentale. Après l'échec de la campagne de Russie, il doit abdiquer une première fois en 1814 puis en 1815 après la défaite de Waterloo. Exilé à Sainte-Hélène, une petite île située au large de l’Afrique, il y meurt en 1821.
Napoléon Bonaparte (1769-1821) a été un général français durant la Révolution, puis s’est proclamé Premier consul de 1800 à 1804, avant de devenir empereur des Français de 1804 à 1815, sous le nom de Napoléon Ier. Devenu très populaire après ses campagnes en Italie et en Égypte, il met un terme à la Révolution par le coup d'Etat du 18 brumaire. L’empereur s’attache à réorganiser l’administration de la France, rétablit les finances, développe l’enseignement public et promulgue le Code civil. Parallèlement, il consacre la plupart de son temps à la guerre : enchainant de nombreuses victoires militaires (dont Austerlitz), il règne un temps sur l'Europe continentale. Après l'échec de la campagne de Russie, il doit abdiquer une première fois en 1814 puis en 1815 après la défaite de Waterloo. Exilé à Sainte-Hélène, une petite île située au large de l’Afrique, il y meurt en 1821.
 Charles II le Chauve (823-877), a été roi des Francs (843-877) puis empereur d’Occident (875-877). Il est le fils de Louis Ier le Pieux et le petit-fils de l’empereur Charlemagne. Avec l’aide de son frère Louis le Germanique, il défait son frère aîné Lothaire à Fontenoy en Puisaye (841) et signe avec eux le traité de Verdun (843), devenant roi de la Francia Occidentalis. Le règne de Charles le Chauve fut marqué par les invasions normandes, les guerres franco-germaniques et les progrès de la féodalité. A la mort de l’empereur Louis II (875), il reçoit la couronne impériale et acquiert la Provence. Lors de la cérémonie en 877, il se serait fait raser le crâne en signe de soumission à l’Eglise, gagnant son surnom de “le Chauve”.
Charles II le Chauve (823-877), a été roi des Francs (843-877) puis empereur d’Occident (875-877). Il est le fils de Louis Ier le Pieux et le petit-fils de l’empereur Charlemagne. Avec l’aide de son frère Louis le Germanique, il défait son frère aîné Lothaire à Fontenoy en Puisaye (841) et signe avec eux le traité de Verdun (843), devenant roi de la Francia Occidentalis. Le règne de Charles le Chauve fut marqué par les invasions normandes, les guerres franco-germaniques et les progrès de la féodalité. A la mort de l’empereur Louis II (875), il reçoit la couronne impériale et acquiert la Provence. Lors de la cérémonie en 877, il se serait fait raser le crâne en signe de soumission à l’Eglise, gagnant son surnom de “le Chauve”.
 Charles V, dit le Sage, a été roi de France de 1364 à 1380 durant les heures sombres de la guerre de Cent ans. Fils de Jean II le Bon, il devient régent du royaume pendant la détention de son père en Angleterre. Il doit alors faire face à des révoltes paysannes (les jacqueries), à un soulèvement parisien conduit par le prévôt des marchands Etienne Marcel et doit lutter contre les prétentions de Charles le Mauvais, roi de Navarre. Devant ces multiples périls, il doit négocier avec l'Angleterre le traité de Brétigny (1360) au prix de grosses pertes territoriales. Devenu roi, bien secondé par le connétable Du Guesclin, il impose le retour à la paix, restaure l'autorité royale et parvient à reprendre aux anglais la quasi-totalité de leurs possessions continentales. Charles V est considéré comme l'un des "grands" rois de France.
Charles V, dit le Sage, a été roi de France de 1364 à 1380 durant les heures sombres de la guerre de Cent ans. Fils de Jean II le Bon, il devient régent du royaume pendant la détention de son père en Angleterre. Il doit alors faire face à des révoltes paysannes (les jacqueries), à un soulèvement parisien conduit par le prévôt des marchands Etienne Marcel et doit lutter contre les prétentions de Charles le Mauvais, roi de Navarre. Devant ces multiples périls, il doit négocier avec l'Angleterre le traité de Brétigny (1360) au prix de grosses pertes territoriales. Devenu roi, bien secondé par le connétable Du Guesclin, il impose le retour à la paix, restaure l'autorité royale et parvient à reprendre aux anglais la quasi-totalité de leurs possessions continentales. Charles V est considéré comme l'un des "grands" rois de France.
 Louis XIII (1601-1643) est un roi de France de la dynastie des Bourbons ; surnommé « le Juste », il a régné de 1610 à 1643. Fils aîné d’Henri IV, Louis XIII succède à son père alors qu’il n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. En 1624, il fait du cardinal de Richelieu son principal ministre. Dès lors, la politique du royaume suit une nouvelle direction : ensemble, le roi et le cardinal luttent contre l’influence des Habsbourg en Europe et limitent le pouvoir de la noblesse dans le royaume. Ils réduisent les privilèges dont jouissent les protestants depuis la promulgation de l’édit de Nantes, ce qui relance la guerre entre catholiques et protestants. Le règne de Louis XIII est marqué par l’affirmation d’un État fort et centralisé, inaugurant le « Grand Siècle » en France.
Louis XIII (1601-1643) est un roi de France de la dynastie des Bourbons ; surnommé « le Juste », il a régné de 1610 à 1643. Fils aîné d’Henri IV, Louis XIII succède à son père alors qu’il n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. En 1624, il fait du cardinal de Richelieu son principal ministre. Dès lors, la politique du royaume suit une nouvelle direction : ensemble, le roi et le cardinal luttent contre l’influence des Habsbourg en Europe et limitent le pouvoir de la noblesse dans le royaume. Ils réduisent les privilèges dont jouissent les protestants depuis la promulgation de l’édit de Nantes, ce qui relance la guerre entre catholiques et protestants. Le règne de Louis XIII est marqué par l’affirmation d’un État fort et centralisé, inaugurant le « Grand Siècle » en France.
 Roi de France de 1461 à 1483, Louis XI, surnommé « l’universelle aragne », a eu pour lourde tâche de rendre à la France sa prospérité perdue lors de la guerre de Cent Ans. Fils turbulent de Charles VII, il a la réputation d’un souverain dur, parfois considéré comme un tyran. Son règne est pourtant fondamental, tant par la lutte à mort qu’il livre au duc de Bourgogne Charles le Téméraire, que dans l’affirmation d’une monarchie de plus en plus centralisée sur la personne du roi. Alors que la France connaît à nouveau un essor économique, le règne de Louis XI, si autoritaire soit-il, va permettre l’avènement des rois de la Renaissance et avec lui le rayonnement de la France, qui devient la première puissance européenne.
Roi de France de 1461 à 1483, Louis XI, surnommé « l’universelle aragne », a eu pour lourde tâche de rendre à la France sa prospérité perdue lors de la guerre de Cent Ans. Fils turbulent de Charles VII, il a la réputation d’un souverain dur, parfois considéré comme un tyran. Son règne est pourtant fondamental, tant par la lutte à mort qu’il livre au duc de Bourgogne Charles le Téméraire, que dans l’affirmation d’une monarchie de plus en plus centralisée sur la personne du roi. Alors que la France connaît à nouveau un essor économique, le règne de Louis XI, si autoritaire soit-il, va permettre l’avènement des rois de la Renaissance et avec lui le rayonnement de la France, qui devient la première puissance européenne.
 Biographie courte - Général et homme d’État français, Charles de Gaulle a été le chef de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale et le fondateur et premier président de la Ve République. Pénétré du sens de l’histoire et animé par une volonté farouche de défendre et d’incarner son pays, il aura eu à diriger la France au cours des deux crises majeures que furent la seconde guerre mondiale et la guerre d’Algérie. Son œuvre et son action ont fait depuis sa mort en 1970 l’objet de récupérations diverses qui tendant à prouver la profonde originalité du personnage, mais aussi une certaine difficulté à cerner les ressorts profonds de ses décisions les plus controversées. Il reste cependant considéré comme l'un des très grands hommes du XXe siècle.
Biographie courte - Général et homme d’État français, Charles de Gaulle a été le chef de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale et le fondateur et premier président de la Ve République. Pénétré du sens de l’histoire et animé par une volonté farouche de défendre et d’incarner son pays, il aura eu à diriger la France au cours des deux crises majeures que furent la seconde guerre mondiale et la guerre d’Algérie. Son œuvre et son action ont fait depuis sa mort en 1970 l’objet de récupérations diverses qui tendant à prouver la profonde originalité du personnage, mais aussi une certaine difficulté à cerner les ressorts profonds de ses décisions les plus controversées. Il reste cependant considéré comme l'un des très grands hommes du XXe siècle.
 Le Second Empire, dirigé par Napoléon III du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870, a succédé à l'éphémère IIe République. C'est une période de grand essor économique, notamment industriel, financier et bancaire, qui provoque des changements sociaux, tel le développement de la classe ouvrière. Après une phase autoritaire, marquée par la répression de l’opposition, se fait jour une certaine libéralisation du régime. Malgré plusieurs succès militaires et diplomatiques (guerre de Crimée, campagne d’Italie), l’échec de l’expédition mexicaine et surtout la défaite militaire face à la Prusse en 1870 entraînent la chute du second Empire.
Le Second Empire, dirigé par Napoléon III du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870, a succédé à l'éphémère IIe République. C'est une période de grand essor économique, notamment industriel, financier et bancaire, qui provoque des changements sociaux, tel le développement de la classe ouvrière. Après une phase autoritaire, marquée par la répression de l’opposition, se fait jour une certaine libéralisation du régime. Malgré plusieurs succès militaires et diplomatiques (guerre de Crimée, campagne d’Italie), l’échec de l’expédition mexicaine et surtout la défaite militaire face à la Prusse en 1870 entraînent la chute du second Empire.
 La Commune de Paris désigne le mouvement et le gouvernement insurrectionnel mis en place par les Parisiens du 18 mars au 28 mai 1871, à l’issue de la guerre franco-prusienne de 1870. Après le siège de Paris et la signature de l’armistice franco-allemand, les Parisiens, qu’Adolphe Thiers veut désarmer, se soulèvent et instaurent un gouvernement révolutionnaire dominé par les blanquistes et les anarchistes. Durant trois mois, de mars à fin mai 1871, la Commune de Paris résiste aux attaques des troupes versaillaises, avant d’être réprimée lors de la Semaine sanglante.
La Commune de Paris désigne le mouvement et le gouvernement insurrectionnel mis en place par les Parisiens du 18 mars au 28 mai 1871, à l’issue de la guerre franco-prusienne de 1870. Après le siège de Paris et la signature de l’armistice franco-allemand, les Parisiens, qu’Adolphe Thiers veut désarmer, se soulèvent et instaurent un gouvernement révolutionnaire dominé par les blanquistes et les anarchistes. Durant trois mois, de mars à fin mai 1871, la Commune de Paris résiste aux attaques des troupes versaillaises, avant d’être réprimée lors de la Semaine sanglante.
 Entre la Révolution et l'arrivée au pouvoir du Roi-citoyen Louis-Philippe, le château de Versailles n'a pas été vraiment habité. L'Empereur avait réalisé des travaux de sauvegarde, Louis XVIII avait rénové les salles de prestige et les pièces privées. Les versaillais comptaient sur le nouveau roi pour redonner toute sa splendeur au château. Ils savaient que Louis-Philippe ne s'y installerait pas, mais ils espéraient qu'il l'utiliserait pour loger des souverains étrangers, y donner de grandes fêtes et transformer une partie en un espace culturel qui ferait de Versailles « une ville de science et des beaux-arts, qui attireraient des plus en plus les étrangers et les étudiants ».
Entre la Révolution et l'arrivée au pouvoir du Roi-citoyen Louis-Philippe, le château de Versailles n'a pas été vraiment habité. L'Empereur avait réalisé des travaux de sauvegarde, Louis XVIII avait rénové les salles de prestige et les pièces privées. Les versaillais comptaient sur le nouveau roi pour redonner toute sa splendeur au château. Ils savaient que Louis-Philippe ne s'y installerait pas, mais ils espéraient qu'il l'utiliserait pour loger des souverains étrangers, y donner de grandes fêtes et transformer une partie en un espace culturel qui ferait de Versailles « une ville de science et des beaux-arts, qui attireraient des plus en plus les étrangers et les étudiants ».
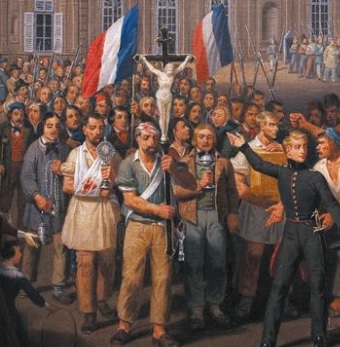 Régime politique éphémère en France, la IIe République a duré du 25 février 1848 au 2 décembre 1852. Souvent comparée à la Révolution française, dont elle serait en quelque sorte un condensé, elle a fait, en effet, chuter une monarchie (la monarchie de Juillet) et préparé un empire (le Second Empire). La Seconde République comprend trois principales phases. La première enveloppe la période révolutionnaire, de l’insurrection de février à la crise de juin 1848. La deuxième correspond au temps de la République bourgeoise et modérée, dont l’histoire est interrompue par le coup d’État napoléonien de 1851. Enfin, les derniers mois de la IIe République ouvrent la voie au Second Empire, institué fin 1852.
Régime politique éphémère en France, la IIe République a duré du 25 février 1848 au 2 décembre 1852. Souvent comparée à la Révolution française, dont elle serait en quelque sorte un condensé, elle a fait, en effet, chuter une monarchie (la monarchie de Juillet) et préparé un empire (le Second Empire). La Seconde République comprend trois principales phases. La première enveloppe la période révolutionnaire, de l’insurrection de février à la crise de juin 1848. La deuxième correspond au temps de la République bourgeoise et modérée, dont l’histoire est interrompue par le coup d’État napoléonien de 1851. Enfin, les derniers mois de la IIe République ouvrent la voie au Second Empire, institué fin 1852.
 Le rattachement de la Savoie et de Nice à la France est le résultat d’un long processus entamé dès la Révolution et qui se concrétisa sous le Second Empire. En échange de l’aide française contre l’occupation autrichienne, le royaume de Piémont-Sardaigne propose, par le traité de Turin du 24 mars 1860, de céder la Savoie et Nice à Napoléon III. Ce rattachement à la France devient effectif après un plébiscite organisé auprès des Niçois et des Savoyards. Occupé ou annexé temporairement sous François Ier, Louis XIV, la Révolution et l'Empire,le Duché de Savoie, tout comme le Comté de Nice, sont définitivement incorporés à la France.
Le rattachement de la Savoie et de Nice à la France est le résultat d’un long processus entamé dès la Révolution et qui se concrétisa sous le Second Empire. En échange de l’aide française contre l’occupation autrichienne, le royaume de Piémont-Sardaigne propose, par le traité de Turin du 24 mars 1860, de céder la Savoie et Nice à Napoléon III. Ce rattachement à la France devient effectif après un plébiscite organisé auprès des Niçois et des Savoyards. Occupé ou annexé temporairement sous François Ier, Louis XIV, la Révolution et l'Empire,le Duché de Savoie, tout comme le Comté de Nice, sont définitivement incorporés à la France.
 Suite à l’interdiction de la campagne des Banquets républicains par Guizot, la révolution éclate du 22 au 25 février 1848, entraînant l'abdication du roi Louis-Philippe et la chute de la monarchie de Juillet. Un gouvernement provisoire républicain est mis en place, c'est la naissance de la IIe République. Cette révolution éclair, qui a pris de court de nombreux hommes politiques, voit s'unir dans l'opposition aux Orléans, des républicains de conviction à des ralliés parfois venus du mouvement légitimiste. La Révolution de 1848 deviendra une référence pour la famille républicaine, une mémoire active qui rejaillit sporadiquement dans l’histoire de la conquête républicaine et dans celle des gauches françaises.
Suite à l’interdiction de la campagne des Banquets républicains par Guizot, la révolution éclate du 22 au 25 février 1848, entraînant l'abdication du roi Louis-Philippe et la chute de la monarchie de Juillet. Un gouvernement provisoire républicain est mis en place, c'est la naissance de la IIe République. Cette révolution éclair, qui a pris de court de nombreux hommes politiques, voit s'unir dans l'opposition aux Orléans, des républicains de conviction à des ralliés parfois venus du mouvement légitimiste. La Révolution de 1848 deviendra une référence pour la famille républicaine, une mémoire active qui rejaillit sporadiquement dans l’histoire de la conquête républicaine et dans celle des gauches françaises.
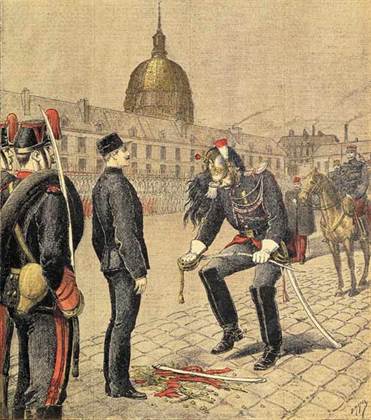 Révélatrice des profonds clivages idéologiques et politiques de la France d’avant 1914, l’affaire Dreyfus est à l'origine d'une grave crise politique qui, de 1896 à 1899, a provoqué une profonde division de l'opinion publique. Tout a commencé le 15 Octobre 1894, lorsque le capitaine d’artillerie Alfred Dreyfus, d’origine Alsacienne et juive, est arrêté au ministère de la Guerre. Les autorités militaires lui reprochent d’avoir transmis à l’ambassade allemande des secrets militaires. Elles se basent sur des écrits (le fameux bordereau) dont l’étude graphologique aurait conclu qu’ils étaient de la main de Dreyfus. Retour sur une erreur judiciaire qui fit trembler la jeune IIIe République.
Révélatrice des profonds clivages idéologiques et politiques de la France d’avant 1914, l’affaire Dreyfus est à l'origine d'une grave crise politique qui, de 1896 à 1899, a provoqué une profonde division de l'opinion publique. Tout a commencé le 15 Octobre 1894, lorsque le capitaine d’artillerie Alfred Dreyfus, d’origine Alsacienne et juive, est arrêté au ministère de la Guerre. Les autorités militaires lui reprochent d’avoir transmis à l’ambassade allemande des secrets militaires. Elles se basent sur des écrits (le fameux bordereau) dont l’étude graphologique aurait conclu qu’ils étaient de la main de Dreyfus. Retour sur une erreur judiciaire qui fit trembler la jeune IIIe République.
 Le « romantisme » est un mouvement littéraire et artistique européen né à la fin du XVIIIe, et qui a connu son apogée au cours du XIXe siècle. Cette nouvelle forme de sensibilité exprime le déchirement des passions amoureuses et l’angoisse de la solitude humaine. Aux alentours de 1800, l'Europe entière est touchée par le mouvement romantique, en réaction au rationalisme du siècle des Lumières. En France, la tradition classique dominant les lettres et les arts depuis près de deux siècles, elle étouffe toute subjectivité jusqu'à la Révolution. Dès lors, le romantisme y est à la fois plus tardif et plus violent, et les auteurs romantiques français auront fort à faire pour s’imposer.
Le « romantisme » est un mouvement littéraire et artistique européen né à la fin du XVIIIe, et qui a connu son apogée au cours du XIXe siècle. Cette nouvelle forme de sensibilité exprime le déchirement des passions amoureuses et l’angoisse de la solitude humaine. Aux alentours de 1800, l'Europe entière est touchée par le mouvement romantique, en réaction au rationalisme du siècle des Lumières. En France, la tradition classique dominant les lettres et les arts depuis près de deux siècles, elle étouffe toute subjectivité jusqu'à la Révolution. Dès lors, le romantisme y est à la fois plus tardif et plus violent, et les auteurs romantiques français auront fort à faire pour s’imposer.
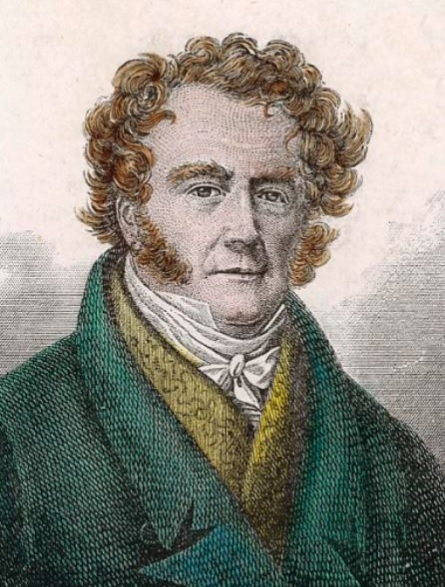 Eugène-François Vidocq (1775-1857) est célèbre pour avoir été tour à tour voleur, bagnard, détective privé, agent secret… puis policier. Parfois surnommé le « Napoléon de la police » ou « L'empereur de Paris », il est l'auteur de ses propres mémoires et de plusieurs ouvrages (les Voleurs en 1836, les Vrais Mystères de Paris en 1844). Son prestige ne cessa de grandir auprès des grands écrivains de son temps. Il a inspiré à Honoré de Balzac et à Victor Hugo les personnages de Vautrin (Splendeurs et Misère des courtisanes) et de Valjean (les Misérables). Films et séries TV qu’il inspira ont achevé de créer le personnage Vidocq, donnant de beaux rôles à Gérard Depardieu ou Claude Brasseur. Artisan de sa propre légende, cet aventurier du XIXe siècle reste une figure à la fois très populaire et pourtant profondément méconnue.
Eugène-François Vidocq (1775-1857) est célèbre pour avoir été tour à tour voleur, bagnard, détective privé, agent secret… puis policier. Parfois surnommé le « Napoléon de la police » ou « L'empereur de Paris », il est l'auteur de ses propres mémoires et de plusieurs ouvrages (les Voleurs en 1836, les Vrais Mystères de Paris en 1844). Son prestige ne cessa de grandir auprès des grands écrivains de son temps. Il a inspiré à Honoré de Balzac et à Victor Hugo les personnages de Vautrin (Splendeurs et Misère des courtisanes) et de Valjean (les Misérables). Films et séries TV qu’il inspira ont achevé de créer le personnage Vidocq, donnant de beaux rôles à Gérard Depardieu ou Claude Brasseur. Artisan de sa propre légende, cet aventurier du XIXe siècle reste une figure à la fois très populaire et pourtant profondément méconnue.
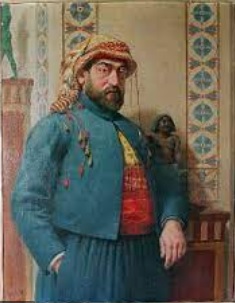 L’égyptologie, étude scientifique de la civilisation égyptienne, naît au XIXe siècle, grâce à la campagne de Bonaparte en Egypte et au décodage des hiéroglyphes par Champollion. Malgré l’engouement général pour l’Orient antique, la connaissance de cette culture est restreinte à un petit comité d’érudits. Auguste Mariette, l'un d’entre eux, va s'efforcer avec succès de la faire connaître auprès du grand public. On lui doit aussi la découverte de nombreuses pièces de l’art de l’Égypte ancienne, exposées au Caire ou au musée du Louvre à Paris.
L’égyptologie, étude scientifique de la civilisation égyptienne, naît au XIXe siècle, grâce à la campagne de Bonaparte en Egypte et au décodage des hiéroglyphes par Champollion. Malgré l’engouement général pour l’Orient antique, la connaissance de cette culture est restreinte à un petit comité d’érudits. Auguste Mariette, l'un d’entre eux, va s'efforcer avec succès de la faire connaître auprès du grand public. On lui doit aussi la découverte de nombreuses pièces de l’art de l’Égypte ancienne, exposées au Caire ou au musée du Louvre à Paris.
 Marguerite de Valois (1553-1615), dite la reine Margot, reine de France et de Navarre, était la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis et la sœur de Charles IX et Henri III. Le 18 août 1572, elle épouse le chef des huguenots, Henri de Navarre (futur Henri IV), symbolisant une tentative de réconciliation entre les protestants et les catholiques. Immortalisée au cinéma par l'actrice Isabelle Adjani, la reine Margot n’était pas la « fille délurée » que les romanciers nous ont décrit. Utilisée trop souvent comme un « pion » par sa mère en pleine guerres de religion du XVIe siècle, elle reçut de nombreux hommages funèbres à sa mort en 1615 : « la Reine des grandeurs, la grandeur des esprits, la noble des fleurs, la Marguerite de France ».
Marguerite de Valois (1553-1615), dite la reine Margot, reine de France et de Navarre, était la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis et la sœur de Charles IX et Henri III. Le 18 août 1572, elle épouse le chef des huguenots, Henri de Navarre (futur Henri IV), symbolisant une tentative de réconciliation entre les protestants et les catholiques. Immortalisée au cinéma par l'actrice Isabelle Adjani, la reine Margot n’était pas la « fille délurée » que les romanciers nous ont décrit. Utilisée trop souvent comme un « pion » par sa mère en pleine guerres de religion du XVIe siècle, elle reçut de nombreux hommages funèbres à sa mort en 1615 : « la Reine des grandeurs, la grandeur des esprits, la noble des fleurs, la Marguerite de France ».
 De son vrai nom Jeanne Antoinette Poisson, Madame de Pompadour (1721-1764) a été la maîtresse du roi Louis XV, qui lui attribuera le titre de marquise. Elle participa à la vie politique du royaume, en favorisant par exemple l’ascension de certains ministres comme Choiseul et en contribuant au renversement des alliances de 1756. La marquise de Pompadour joua également un rôle important dans le domaine des arts et des lettres, soutenant Voltaire et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Les envieux, les rancuniers lui ont fait un mauvais portrait ; pour les uns : belle, raffinée, d’une intelligence supérieure, habile, avec une classe différente par rapport aux grandes dames, marquant le style d’une époque ; pour les autres : avide, perverse, assoiffée de pouvoir, responsable des désastres militaires de la guerre de Sept ans et de la disgrâce des meilleurs ministres.
De son vrai nom Jeanne Antoinette Poisson, Madame de Pompadour (1721-1764) a été la maîtresse du roi Louis XV, qui lui attribuera le titre de marquise. Elle participa à la vie politique du royaume, en favorisant par exemple l’ascension de certains ministres comme Choiseul et en contribuant au renversement des alliances de 1756. La marquise de Pompadour joua également un rôle important dans le domaine des arts et des lettres, soutenant Voltaire et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Les envieux, les rancuniers lui ont fait un mauvais portrait ; pour les uns : belle, raffinée, d’une intelligence supérieure, habile, avec une classe différente par rapport aux grandes dames, marquant le style d’une époque ; pour les autres : avide, perverse, assoiffée de pouvoir, responsable des désastres militaires de la guerre de Sept ans et de la disgrâce des meilleurs ministres.
 Marie Marvingt, lorraine de cœur, est la française la plus émancipée de la première moitié du XIXe siècle. Curieuse de tout, sportive accomplie, elle s'est illustrée pendant les deux Guerres mondiales et fut à l'origine du service aérien sanitaire. Surnommée « la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc », Marie avait pour devise « savoir vouloir, c'est pouvoir ». N'ayant pas eu de descendance, elle est un peu trop oubliée de nos jours. Rendons-lui hommage.
Marie Marvingt, lorraine de cœur, est la française la plus émancipée de la première moitié du XIXe siècle. Curieuse de tout, sportive accomplie, elle s'est illustrée pendant les deux Guerres mondiales et fut à l'origine du service aérien sanitaire. Surnommée « la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc », Marie avait pour devise « savoir vouloir, c'est pouvoir ». N'ayant pas eu de descendance, elle est un peu trop oubliée de nos jours. Rendons-lui hommage.
 Diane de Poitiers (1499-1566), favorite du roi Henri II de France, s'imposa à la cour royale aux dépens de la reine Catherine de Médicis, et s’entoura d’une cour brillante. Femme indépendante, elle a su préserver la jeunesse de son corps et de son esprit. Elle n’oublia jamais ses principes « soyez toujours en port honorable, en manière froide et assurée, humble regard, basse parole, constante et ferme, toujours en un propos, sans fléchir, modération en toute chose ». Elle a également réussi à transformer Henri, en faisant de ce jeune homme gauche et maladroit un troubadour, un poète, un cavalier et un monarque. Après la mort dramatique du roi, elle se retire à Anet, où elle meurt le 22 avril 1566.
Diane de Poitiers (1499-1566), favorite du roi Henri II de France, s'imposa à la cour royale aux dépens de la reine Catherine de Médicis, et s’entoura d’une cour brillante. Femme indépendante, elle a su préserver la jeunesse de son corps et de son esprit. Elle n’oublia jamais ses principes « soyez toujours en port honorable, en manière froide et assurée, humble regard, basse parole, constante et ferme, toujours en un propos, sans fléchir, modération en toute chose ». Elle a également réussi à transformer Henri, en faisant de ce jeune homme gauche et maladroit un troubadour, un poète, un cavalier et un monarque. Après la mort dramatique du roi, elle se retire à Anet, où elle meurt le 22 avril 1566.
 Anne de Bretagne (1477-1514), duchesse de Bretagne puis reine de France à deux reprises est la fille et héritière de François II, dernier duc de Bretagne. Elle fut d'abord mariée par procuration en 1490 à l’empereur germanique Maximilien Ier, afin de préserver l’indépendance du duché face à l'apétit des rois de France. Assiégée dans Rennes par les Beaujeu, elle fut contrainte d’épouser Charles VIII (1491), ce qui prépara le rattachement de la Bretagne à la France. Veuve, elle dut se remarier avec Louis XII, auquel elle donna deux filles, dont Claude de France, la future épouse de François Ier. Néanmoins elle continua jusqu’à sa mort à défendre farouchement l’indépendance bretonne.
Anne de Bretagne (1477-1514), duchesse de Bretagne puis reine de France à deux reprises est la fille et héritière de François II, dernier duc de Bretagne. Elle fut d'abord mariée par procuration en 1490 à l’empereur germanique Maximilien Ier, afin de préserver l’indépendance du duché face à l'apétit des rois de France. Assiégée dans Rennes par les Beaujeu, elle fut contrainte d’épouser Charles VIII (1491), ce qui prépara le rattachement de la Bretagne à la France. Veuve, elle dut se remarier avec Louis XII, auquel elle donna deux filles, dont Claude de France, la future épouse de François Ier. Néanmoins elle continua jusqu’à sa mort à défendre farouchement l’indépendance bretonne.
 Anne d'Autriche (1601-1666) a été reine de France puis régente pendant la minorité de Louis XIV, période pendant laquelle elle gouverna avec Mazarin, son principal ministre. « Mon prix n’est pas dans ma couronne », telle était la devise d’Anne d’Autriche. En l’épousant, Louis XIII offrait à son peuple une reine de très grand lignage, la paix, mais aussi et surtout sans le savoir une régente à l’intelligence et à l’énergie surprenante. Perpétuelle « Espagnole » durant le règne de son époux, délaissée et méprisée, cette Habsbourg, pourtant madrilène jusqu’au bout des ongles, surprendra tout son monde lors de son arrivée au pouvoir en tenant courageusement tête à la Fronde des parlements puis des princes.
Anne d'Autriche (1601-1666) a été reine de France puis régente pendant la minorité de Louis XIV, période pendant laquelle elle gouverna avec Mazarin, son principal ministre. « Mon prix n’est pas dans ma couronne », telle était la devise d’Anne d’Autriche. En l’épousant, Louis XIII offrait à son peuple une reine de très grand lignage, la paix, mais aussi et surtout sans le savoir une régente à l’intelligence et à l’énergie surprenante. Perpétuelle « Espagnole » durant le règne de son époux, délaissée et méprisée, cette Habsbourg, pourtant madrilène jusqu’au bout des ongles, surprendra tout son monde lors de son arrivée au pouvoir en tenant courageusement tête à la Fronde des parlements puis des princes.
 Surnommée Jeanne la Pucelle ou la Pucelle d’Orléans, Jeanne d’Arc (1412-1431) est une figure incontournable de l’histoire de France. Paysanne originaire de Domrémy, en Lorraine, elle y aurait entendu des voix venues du ciel lui demandant d’aller au secours du roi, menacé par les anglais et les bourguignons. En 1429, elle se rend à Chinon et persuade Charles VII de lui confier une armée. Avec une troupe de soldats royaux, elle contribue à la levée du siège Orléans, puis conduit Charles VII à Reims où il est sacré. Mais l’année suivante, elle est capturée par les Bourguignons qui la livrent aux Anglais. Jugée pour sorcellerie, elle meurt brûlée vive sur la place du marché à Rouen, le 30 mai 1431. Son procès est révisé en 1456 puis, en 1920, Jeanne d’Arc est déclarée sainte par l’Église catholique. Figure héroïque et mythique de l'histoire de France, elle a fait l'objet de nombreuses récupérations politiques et a été une source inépuisable d'inspiration pour la littérature et les arts.
Surnommée Jeanne la Pucelle ou la Pucelle d’Orléans, Jeanne d’Arc (1412-1431) est une figure incontournable de l’histoire de France. Paysanne originaire de Domrémy, en Lorraine, elle y aurait entendu des voix venues du ciel lui demandant d’aller au secours du roi, menacé par les anglais et les bourguignons. En 1429, elle se rend à Chinon et persuade Charles VII de lui confier une armée. Avec une troupe de soldats royaux, elle contribue à la levée du siège Orléans, puis conduit Charles VII à Reims où il est sacré. Mais l’année suivante, elle est capturée par les Bourguignons qui la livrent aux Anglais. Jugée pour sorcellerie, elle meurt brûlée vive sur la place du marché à Rouen, le 30 mai 1431. Son procès est révisé en 1456 puis, en 1920, Jeanne d’Arc est déclarée sainte par l’Église catholique. Figure héroïque et mythique de l'histoire de France, elle a fait l'objet de nombreuses récupérations politiques et a été une source inépuisable d'inspiration pour la littérature et les arts.
 Fille de Roi et première épouse de François Ier, Claude de France (1499-1524) fut une reine très charitable, très bonne, « fort douce à tout le monde ». Sa devise est symbole de pureté et d’innocence « Candida candidis » pure parmi les pures, accompagné d’un cygne « navré », transpercé d’une flèche. Duchesse de Bretagne en 1514, reine de France en 1515, elle porte les titres de Comtesse de Soissons, de Blois, de Coucy, d’Etampes, de Montfort et duchesse de Milan. Claude de France meurt prématurément à l’âge de 24 ans, non sans avoir donné sept enfants à François Ier dont le futur Henri II.
Fille de Roi et première épouse de François Ier, Claude de France (1499-1524) fut une reine très charitable, très bonne, « fort douce à tout le monde ». Sa devise est symbole de pureté et d’innocence « Candida candidis » pure parmi les pures, accompagné d’un cygne « navré », transpercé d’une flèche. Duchesse de Bretagne en 1514, reine de France en 1515, elle porte les titres de Comtesse de Soissons, de Blois, de Coucy, d’Etampes, de Montfort et duchesse de Milan. Claude de France meurt prématurément à l’âge de 24 ans, non sans avoir donné sept enfants à François Ier dont le futur Henri II.
 Éléonore de Habsbourg (1498-1558), veuve du roi du Portugal, est devenue en 1530 la seconde épouse de François Ier. Instrument de négociation pour son frère Charles Quint et de revanche pour le Roi de France, elle aura bien du mal à trouver sa place à la cour de son tempétueux mari. Pendant les dix sept années de sa vie d’épouse et de reine française, cette sœur de l’ennemi ressentira l’animosité du roi et de ses fils. Rejetée, car étrangère, Éléonore de Habsbourg s’en retournera dans son pays à la mort de son époux et sera comme « gommée » de la mémoire des Français, n’étant même pas admise à la basilique de Saint Denis !
Éléonore de Habsbourg (1498-1558), veuve du roi du Portugal, est devenue en 1530 la seconde épouse de François Ier. Instrument de négociation pour son frère Charles Quint et de revanche pour le Roi de France, elle aura bien du mal à trouver sa place à la cour de son tempétueux mari. Pendant les dix sept années de sa vie d’épouse et de reine française, cette sœur de l’ennemi ressentira l’animosité du roi et de ses fils. Rejetée, car étrangère, Éléonore de Habsbourg s’en retournera dans son pays à la mort de son époux et sera comme « gommée » de la mémoire des Français, n’étant même pas admise à la basilique de Saint Denis !
 Il est des personnages de l’Histoire de France, sur lesquels s’acharne le sort et la reconnaissance n’est que bien tardive. Tel est le destin de Jeanne de France (1464-1505), fille de roi mais fillette difforme, femme rejetée, Reine de France désavouée, surnommée la Boiteuse, qui a fait preuve d’un dévouement, d’un courage et d’une abnégation exemplaires tout au long de sa vie. Béatifiée puis récemment canonisée, elle devient Sainte Jeanne de France…
Il est des personnages de l’Histoire de France, sur lesquels s’acharne le sort et la reconnaissance n’est que bien tardive. Tel est le destin de Jeanne de France (1464-1505), fille de roi mais fillette difforme, femme rejetée, Reine de France désavouée, surnommée la Boiteuse, qui a fait preuve d’un dévouement, d’un courage et d’une abnégation exemplaires tout au long de sa vie. Béatifiée puis récemment canonisée, elle devient Sainte Jeanne de France…
 L'aspect futile que l'on accorde (parfois avec raison) au jeu et sa frivolité supposée font que cet aspect de la vie de cour d'Ancien Régime a souvent été relégué au rang inférieur de « petite histoire » : les plus grands historiens ont généralement éludé ce domaine ou l'ont cantonné à quelques anecdotes légères, comme si le jeu ne méritait pas d'étude particulière. Or, même des individus peu informés sur l'Histoire de France savent que la Cour et le Roi s'adonnaient régulièrement - voire compulsivement - au jeu. Ce simple élément suffit à reconsidérer l'importance que l'on doit attribuer aux divertissements : toute activité pratiquée par la Reine ou le Roi mérite d'être étudiée avec la plus grande attention.
L'aspect futile que l'on accorde (parfois avec raison) au jeu et sa frivolité supposée font que cet aspect de la vie de cour d'Ancien Régime a souvent été relégué au rang inférieur de « petite histoire » : les plus grands historiens ont généralement éludé ce domaine ou l'ont cantonné à quelques anecdotes légères, comme si le jeu ne méritait pas d'étude particulière. Or, même des individus peu informés sur l'Histoire de France savent que la Cour et le Roi s'adonnaient régulièrement - voire compulsivement - au jeu. Ce simple élément suffit à reconsidérer l'importance que l'on doit attribuer aux divertissements : toute activité pratiquée par la Reine ou le Roi mérite d'être étudiée avec la plus grande attention.
 Etre admis sur la liste et recevoir l'insigne de la Légion d'honneur est la plus grande et estimable distinction honorifique française, récompensant les mérites militaires ou civils rendus à la Nation. Sous l'Ancien régime, les ordres de chevalerie étaient réservés presque uniquement à des personnes de haute naissance ; Louis XIV décide en 1693 de récompenser des officiers roturiers, annonçant ainsi la création de la Légion d'honneur. Près d'un million de personnes ont reçu cette distinction depuis sa création, du militaire à l'homme de lettres, de l'artiste au sportif, en passant par d'autres heureux élus. Revenons sur les différents ordres de chevalerie précédant la Légion d'honneur.
Etre admis sur la liste et recevoir l'insigne de la Légion d'honneur est la plus grande et estimable distinction honorifique française, récompensant les mérites militaires ou civils rendus à la Nation. Sous l'Ancien régime, les ordres de chevalerie étaient réservés presque uniquement à des personnes de haute naissance ; Louis XIV décide en 1693 de récompenser des officiers roturiers, annonçant ainsi la création de la Légion d'honneur. Près d'un million de personnes ont reçu cette distinction depuis sa création, du militaire à l'homme de lettres, de l'artiste au sportif, en passant par d'autres heureux élus. Revenons sur les différents ordres de chevalerie précédant la Légion d'honneur.
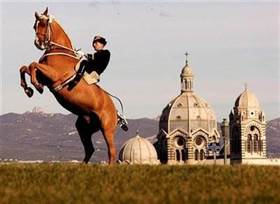 Fondée en 1764, le prestigieux Cadre Noir de saumur perpétue une tradition française de l'art équestre. A l'origine académie militaire équestre, l'école perdra sa vocation première à l'issue des deux guerres mondiales. Devenue civile, elle intègre l'Institut français du cheval et de l'équitation. En 2011, l'Unesco consacre l'art équestre du Cadre Noir de Saumur en l'inscrivant au patrimoine culturel de l'humanité.
Fondée en 1764, le prestigieux Cadre Noir de saumur perpétue une tradition française de l'art équestre. A l'origine académie militaire équestre, l'école perdra sa vocation première à l'issue des deux guerres mondiales. Devenue civile, elle intègre l'Institut français du cheval et de l'équitation. En 2011, l'Unesco consacre l'art équestre du Cadre Noir de Saumur en l'inscrivant au patrimoine culturel de l'humanité.
 Figure récurente de la vie politique française depuis la Révolution, « l'Homme providentiel » est une personnalité publique à laquelle on a recourt pour dénouer une situation de crise. S'investissant d'une mission historique, ce personnage se place en sauveur, au dessus des "partis". Ces derniers ont vu le jour dans les débats qui ont jalonnés la période révolutionnaire de 1789 et qui accouchèrent d'une division politique, devenue traditionnelle, la séparation entre la gauche et la droite. Au fil de l'évolution de la société française à travers le XIXe et le XXe siècle, des caractéristiques nouvelles vont se greffer à cette vie politique française, et l'une de ces particularités résident dans la figure de l'Homme providentiel.
Figure récurente de la vie politique française depuis la Révolution, « l'Homme providentiel » est une personnalité publique à laquelle on a recourt pour dénouer une situation de crise. S'investissant d'une mission historique, ce personnage se place en sauveur, au dessus des "partis". Ces derniers ont vu le jour dans les débats qui ont jalonnés la période révolutionnaire de 1789 et qui accouchèrent d'une division politique, devenue traditionnelle, la séparation entre la gauche et la droite. Au fil de l'évolution de la société française à travers le XIXe et le XXe siècle, des caractéristiques nouvelles vont se greffer à cette vie politique française, et l'une de ces particularités résident dans la figure de l'Homme providentiel.
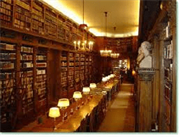 Lieu de dépôt et de classification des livres, des périodiques et des autres documents écrits, les bibliothèques se développent en Europe dès le XIe siècle, stimulées par la création des universités. Réservées au début aux érudits et aux personnes lettrées, les bibliothèques vont évoluer, se diversifier et s'ouvrir à un public plus nombreux et plus varié. De la bibliothèque de l'Eglise en passant par la bibliothèque du Roi jusqu'à la bibliothèque municipale, suivons son évolution.
Lieu de dépôt et de classification des livres, des périodiques et des autres documents écrits, les bibliothèques se développent en Europe dès le XIe siècle, stimulées par la création des universités. Réservées au début aux érudits et aux personnes lettrées, les bibliothèques vont évoluer, se diversifier et s'ouvrir à un public plus nombreux et plus varié. De la bibliothèque de l'Eglise en passant par la bibliothèque du Roi jusqu'à la bibliothèque municipale, suivons son évolution.
 « A boire pour le Roi » crié par l'échanson signifie que le cérémonial du vin et de l'eau peut débuter à la table du Grand Couvert. Il est d'usage de couper le vin avec de l'eau et le Roi apprécie ce breuvage. Mais quel est ce cérémonial ? Comment se procurait-on le vin ? Où l'entreposait-on ? Quel vin se trouvait à la table du Roi ?
« A boire pour le Roi » crié par l'échanson signifie que le cérémonial du vin et de l'eau peut débuter à la table du Grand Couvert. Il est d'usage de couper le vin avec de l'eau et le Roi apprécie ce breuvage. Mais quel est ce cérémonial ? Comment se procurait-on le vin ? Où l'entreposait-on ? Quel vin se trouvait à la table du Roi ?
 Située sur la Meurthe, en bordure du massif ancien des Vosges gréseuses, Baccarat doit sa renommée, qui dépasse les frontières régionales, à sa prestigieuse cristallerie fondée en 1764, qui produit un cristal réputé, le baccarat. La manufacture de Baccarat est aujourd’hui spécialisée dans la fabrication d’objets en cristal de très haut de gamme. Son emblème est le Rouge Baccarat, qui vit le jour il y a 250 ans dans la Lorraine de l'Ancien Régime. Son service « Harcourt » créé pour Louis-Philippe, a fait sa réputation etse retrouve sur la table des plus Grands, de Napoléon III au Vatican.
Située sur la Meurthe, en bordure du massif ancien des Vosges gréseuses, Baccarat doit sa renommée, qui dépasse les frontières régionales, à sa prestigieuse cristallerie fondée en 1764, qui produit un cristal réputé, le baccarat. La manufacture de Baccarat est aujourd’hui spécialisée dans la fabrication d’objets en cristal de très haut de gamme. Son emblème est le Rouge Baccarat, qui vit le jour il y a 250 ans dans la Lorraine de l'Ancien Régime. Son service « Harcourt » créé pour Louis-Philippe, a fait sa réputation etse retrouve sur la table des plus Grands, de Napoléon III au Vatican.
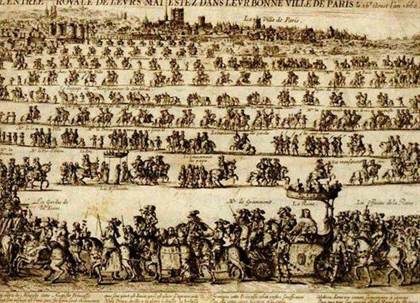 Depuis Charlemagne, la cour du roi voyage, parfois de longs mois, de villes en villages, de résidences en palais, pour cause économique ou politique ou par plaisir, n'ayant pas de lieu fixe. Et ce jusqu'à ce que Louis XIV et sa cour s'installent définitivement au château de Versailles en 1682, le palais prenant le statut de « château d'Etat », accueillant la famille royale, les courtisans et de nombreux services du gouvernement. Se met en place à Versailles un système de dépenses de prestige essentiel pour montrer son intégration à la société de cour, rythmée par l'étiquette, un code rigide de relations sociales fondées sur une hiérarchie stricte.
Depuis Charlemagne, la cour du roi voyage, parfois de longs mois, de villes en villages, de résidences en palais, pour cause économique ou politique ou par plaisir, n'ayant pas de lieu fixe. Et ce jusqu'à ce que Louis XIV et sa cour s'installent définitivement au château de Versailles en 1682, le palais prenant le statut de « château d'Etat », accueillant la famille royale, les courtisans et de nombreux services du gouvernement. Se met en place à Versailles un système de dépenses de prestige essentiel pour montrer son intégration à la société de cour, rythmée par l'étiquette, un code rigide de relations sociales fondées sur une hiérarchie stricte.
 Le palais de l'Élysée est un hôtel particulier du XVIIIe siècle situé en bas de l’avenue des Champs-Élysées, à Paris, devenu la résidence des présidents de la République française en 1873. Plusieurs fois transformé, agrandi et embelli au cours des siècles, le palais de l’Élysée a cependant conservé son bâtiment principal originel. Chaque propriétaire y a apporté des embellissements : boiseries, cheminées, lustres, peintures, etc. L’installation de la présidence de la République dans le palais a entraîné des modifications supplémentaires, telles que l’aménagement de la salle des fêtes sous Sadi Carnot, les décors de Lanel et Leleu sous Vincent Auriol, les embellissements de Paulin et Agam sous Georges Pompidou et enfin l’agencement des appartements par Wilmotte et l’achat de peintures de Garouste sous François Mitterrand...
Le palais de l'Élysée est un hôtel particulier du XVIIIe siècle situé en bas de l’avenue des Champs-Élysées, à Paris, devenu la résidence des présidents de la République française en 1873. Plusieurs fois transformé, agrandi et embelli au cours des siècles, le palais de l’Élysée a cependant conservé son bâtiment principal originel. Chaque propriétaire y a apporté des embellissements : boiseries, cheminées, lustres, peintures, etc. L’installation de la présidence de la République dans le palais a entraîné des modifications supplémentaires, telles que l’aménagement de la salle des fêtes sous Sadi Carnot, les décors de Lanel et Leleu sous Vincent Auriol, les embellissements de Paulin et Agam sous Georges Pompidou et enfin l’agencement des appartements par Wilmotte et l’achat de peintures de Garouste sous François Mitterrand...
 De nos jours, il est simple de se rendre à une adresse définie. Nous disposons du nom de la rue ainsi que du numéro de l’habitation. Tout ceci fut rendu obligatoire par un arrêté de 1805. Remercions l’instigateur de ce décret, car il fut un temps, le parcours était des plus épique pour se rendre chez un individu. Au XVIIe siècle, pour chercher la demoiselle Louison à Paris, amie du poète Berthaud, on pouvait lire son adresse ainsi « demeurante chez Alizon, justement au cinquième étage, près du cabaret de la Cage, dans une chambre à deux chassis, proche Saint-Pierre des Assis » ! Pas vraiment pratique vous me direz…
De nos jours, il est simple de se rendre à une adresse définie. Nous disposons du nom de la rue ainsi que du numéro de l’habitation. Tout ceci fut rendu obligatoire par un arrêté de 1805. Remercions l’instigateur de ce décret, car il fut un temps, le parcours était des plus épique pour se rendre chez un individu. Au XVIIe siècle, pour chercher la demoiselle Louison à Paris, amie du poète Berthaud, on pouvait lire son adresse ainsi « demeurante chez Alizon, justement au cinquième étage, près du cabaret de la Cage, dans une chambre à deux chassis, proche Saint-Pierre des Assis » ! Pas vraiment pratique vous me direz…

