
Patrick Boucheron est maître de conférences en histoire du Moyen Âge à Paris I Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut universitaire de France et du comité de rédaction de la revue L’Histoire. Histoire pour tous a le plaisir de rencontrer l’historien Patrick Boucheron, qui nous parle de son métier d’enseignant chercheur, de quelques-uns de ses ouvrages, de son rapport à l’écriture de l’histoire, et qui nous donne son avis sur la vulgarisation et sur le rôle d’internet dans les usages de l’histoire aujourd’hui.
« Une vocation tardive »
Histoire pour tous : quel a été votre parcours d’étudiant et les raisons de votre choix pour l’histoire ?
Patrick Boucheron : C’est l’histoire d’une vocation tardive, qui fait que j’ai beaucoup de respect et d’admiration, et je le dis sincèrement, pour les étudiants qui ont toujours aimé l’histoire, car ce n’est pas mon cas. Je n’ai pas toujours été un bon élève, et c’est aussi très important à considérer. Ce qui m’a intéressé d‘abord étaient surtout la philosophie et la littérature, l’histoire comme on l’enseignait au lycée ne m’a jamais vraiment passionné. Faire de l’histoire est donc une idée qui m’est apparue plutôt en khâgne ou hypokhâgne, mais je ne sais plus trop bien pourquoi, en tout cas pas parce que je lisais des livres d’histoire qui m’enthousiasmaient — cela est venu plus tard.
Dans votre livre Faire profession d’historien, vous évoquez plusieurs professeurs qui vous ont inspirés. Peut-être est-ce justement grâce à ces rencontres que vous êtes venu à l’histoire ?
Oui, je pense que c’est ça, une histoire d’enseignement en fait. Je me suis rendu compte qu’enseigner l’histoire, cela avait l’air de « lever quelque chose ». Je n’ai pas eu de professeur de philosophie, par exemple, qui m’a soulevé d’enthousiasme. Je lisais des ouvrages de philosophie, qui eux m’enthousiasmaient. A l’époque, c’était Michel Foucault, Gilles Deleuze,…Je n’avais alors pour ma part rien trouvé d’équivalent en histoire, mais au niveau de la parole vive, du point de vue de ce qui s’enseignait, c’était l’inverse. Quand j’écoutais de l’histoire, ce qui bougeait en moi, c’était comme de l’émancipation : l’histoire libérait. C’est donc ça qui m’a donné envie, d’abord, de l’enseigner, de voir cet éclair (tous les professeurs me comprendront) dans l’œil d’un seul qui comprend quelque chose au moment précis où on le dit. C’est une petite chose, mais définitive : ce qu’on comprend dans ces situations, on le comprend une fois pour toute. Et ça, c’est pour l’enseignant une récompense formidable.
Parmi vos influences, vous citez entre autres Duby.
Oui, Duby c’est une autre histoire qui d’ailleurs m’intéresse toujours. Actuellement, je travaille avec un groupe de recherche, aux côtés de Jacques Dalarun, sur les archives de Georges Duby conservées à l’IMEC. Il est mort en 1996 et à ce moment là je l’écoutais, j’allais à ses cours au Collège de France depuis 1985, mais je l’écoutais comme étudiant, j’étais trop jeune pour participer à ce cercle des élèves de Duby. Pour moi, c’est donc une voix un peu lointaine, impérieuse, impressionnante, qu’on entendait à la télé, à la radio, ou donc au Collège de France, et qu’on retrouve d’ailleurs dans ses livres qui portent l’empreinte de ce grain de la voix. C’est une parole que je tente de retrouver au travers de l’archive, précisément parce que je suis né trop tard pour l’avoir eu comme professeur.
« Etre médiéviste : une autre façon d’être contemporanéiste »
Vous n’avez pas toujours été médiéviste. Votre parcours est d’abord passé par l’histoire contemporaine.
C’est vrai que j’aime bien cette période de ma vie, mais je ne suis pas sûr que cela soit encore possible aujourd’hui. En tout cas, je dis toujours à mes étudiants que je suis passé par une maîtrise en histoire contemporaine, tout comme mon maître en histoire médiévale, Jean-Louis Biget, qui avait fait une maîtrise sur la Commune de Paris et adorait le dire. Je suis venu tardivement à l’histoire médiévale, à l’époque de l’agrégation, en écoutant justement Jean-Louis Biget, l’une des voix très fortes qui m’a soulevé d’enthousiasme. Je crois de toute façon, fondamentalement, pour l’avoir expérimenté par une approche philosophique (en lisant par exemple Giorgio Agamben), qu’on est toujours historien du contemporain, qu’il n’y a d’histoire que contemporaine, et qu’être médiéviste c’est une autre façon d’être contemporanéiste. C’est accueillir ce qu’il y a de très profondément enfoui, presque disparu, dans notre contemporanéité.
Je veux croire qu’être historien, c’est un seul et même métier, et j’essaye de l’enseigner comme tel à mes étudiants. Je leur dis de faire ce dont ils ont envie, sans avoir peur que cela engage leur vie entière. Mais je sais que c’est à contre-courant d’une évolution que je trouve fâcheuse, qui oblige les gens à se décider trop tôt et trop vite, à faire des choix par défaut. Pourtant, c’est vrai, j’ai aussi fait certains choix par défaut, je n’ai par exemple pas fait d’histoire antique parce que je ne connaissais pas assez le latin et très mal le grec, et ce malgré l’influence d’un autre de mes maîtres, Yvon Thébert, qui m’a donné le goût de l’enseignement par le voyage et les choses concrètes. Ce fut un choix par défaut, et c’est toujours dommage de faire des choix par défaut, même si parfois on ne peut pas faire autrement.
L’histoire urbaine elle n’a pas été un choix par défaut, puisque vous parlez de « roche-mère de [votre] formation ».
Oui, c’est une sorte de « formule idéale » inspirée par l’archéologie. L’influence est encore ici celle d’Yvon Thébert, avec qui j’ai fait des fouilles sur le Palatin, à Rome. Le choix de l’histoire urbaine a été le choix du concret, de la vie. A part lire un livre, qui demeure un plaisir simple et toujours renouvelé, je ne vois pas autre chose de plus enrichissant que de se promener dans une ville inconnue.
Votre thèse est centrée sur une ville célèbre, Milan. Comment avez-vous abordé ce travail, qui semble titanesque pour nombre d’étudiants ?
Là encore assez simplement, mais je ne voudrais pas généraliser mon cas. En fait, il me faut insister sur un point très important : je suis de la génération des enfants gâtés du recrutement universitaire. Il y avait beaucoup de postes à l’agrégation, dans l’enseignement supérieur, et –je le dis avec provocation, mais d’autant plus que ceux de ma génération qui aujourd’hui accèdent aux responsabilités ont tendance à l’oublier- il suffisait d’être là pour être pris, y compris pour les postes de maîtres de conférences. Je ne me fais pas toujours des amis, mais je n’hésite pas à dire à certains que s’ils se présentaient aujourd’hui avec la thèse qu’ils ont soutenue, on leur rirait au nez. Le niveau a augmenté, par nécessité, pas parce que les gens sont devenus plus intelligents ou plus vertueux. La concurrence est plus rude. Je tente de tenir sur ces sujets un discours d’autonomie, de liberté, d’émancipation…
« L’enfermement scolastique des universitaires »
Vous parlez d’autonomie. Justement, dans votre ouvrage Faire profession d’historien, vous évoquez le mouvement universitaire et les désaccords, de forme surtout, que vous avez pu avoir avec vos collègues universitaires.
Oui, évidemment, sur le fond, et en particulier contre l’autonomie version LRU, j’étais en phase avec ce mouvement. C’est une autonomie qui est en fait exactement l’inverse, une situation qui aujourd’hui cumule le pire de tous les systèmes possibles, une « autonomie » à la fois bureaucratique et dérégulée, qui n’a même pas les vertus du système entièrement libéré comme le système anglo-saxon. Si c’était donc pour lutter contre la LRU, contre la dégradation du métier d’enseignant-chercheur, évidemment j’étais en accord avec ce mouvement. Mais je ne me suis pas senti en phase avec les formes d’action et de mobilisation collective de ce mouvement. Je prends l’exemple de la ronde des obstinés, dont on ne peut ignorer la connotation à la fois enfantine et bûtée, à double-tranchant.
Ma référence en matière d’émancipation est la lecture de Pierre Bourdieu, qui fait clignoter en moi un voyant d’alerte dès lors que je crois reconnaître, dans nos pratiques ou nos jugements, l’expression de l’enfermement scolastique. Nous [les universitaires] vivons dans un tout petit monde qui se caractérise par le fait que nous avons du temps libre (au sens que lui donne Bourdieu), et nous confondons ce tout petit monde avec le monde. Beaucoup d’entre nous ont cru, sincèrement, que le fait d’arrêter de faire cours était un moyen de pression intolérable pour les pouvoirs ; mais, par enfermement scolastique, nous n’avons pas compris que ça provoquait l’indifférence. Cela a été un mouvement pour rien, mais si ce n’est pas grave de perdre politiquement, le pire est de se rendre compte qu’on était, dès le départ, quantité négligeable: l’Université peut s’arrêter pendant six mois, ça n’a aucune importance…Les intellectuels peuvent admettre qu’ils sont méprisés, persécutés (ce qui est plutôt flatteur), mais l’idée qu’ils peuvent être poliment ignorés ne les effleure pas. Or, c’est la réalité.
Là encore je ne veux pas en faire une règle car j’ai habilité assez tard, et sans enjeu immédiat. J’ai donc joué un peu avec l’institution en subvertissant l’exercice. L’HDR consiste à se « re-présenter », puisqu’on s’est déjà présenté au moment de la thèse de doctorat, à se représenter donc devant un jury dont une partie est le plus souvent des collègues, et à se mettre dans une situation d’humble soumission ; il y a donc un côté « cirque rituel ». Il faut alors rédiger entre autres choses, et c’est ce qui m’intéressait le plus, un petit mémoire d’ego-histoire, que les gens prennent le plus souvent peu au sérieux et avec un certain détachement. Je me suis dit qu’il fallait que je profite de l’occasion pour faire sérieusement cet exercice, alors qu’il est d’habitude peu considéré, en produisant un réel essai d’auto-reflexivité.
J’ai décidé d’aller jusqu’au bout de ce qui était aussi une provocation, en publiant cet essai [NDLR : Faire profession d’historien]. J’y raconte mon parcours en entier, depuis le temps où j’étais collégien et pas seulement depuis la thèse comme il est de coutume, ce qui n’a pas grand intérêt. L’idée est simple : on est en gros ce qu’on a décidé d’être entre vingt et vingt-cinq ans ; c’est là que les choix essentiels sont faits, même si on peut passer une vie entière à essayer de les comprendre. Si on veut expliquer quel enseignant on est, il faut être capable d’expliquer quel enseigné on a été — quelle idée on se faisait de la réussite scolaire et de quel prix intime on a pu la payer.
« Une vocation d’historien se fonde aussi sur un deuil littéraire »
Intéressons-nous à présent à un autre de vos ouvrages, Léonard et Machiavel.
C’est un petit livre, et le fait qu’il soit petit faisait aussi partie du projet. Il est écrit comme un récit, sans les signes extérieurs de scientificité qu’un livre d’histoire exhibe, telles les notes, etc. Le but était de raconter de manière incertaine la rencontre elle-même incertaine entre deux hommes, Léonard de Vinci et Machiavel, entre 1502 et 1504. Une rencontre documentée indirectement, mais jamais directement, et dans laquelle je vois une sorte de configuration de ce que j’appelle la contemporanéité : qu’est-ce que c’est d’être ensemble au même moment au même endroit, mais également y vivre en même temps une même expérience du temps ? Ils étaient contemporains, pourtant l’un ne parle pas de l’autre, et si on évoque conjointement leurs noms au grand public, celui-ci doit faire un effort pour les mettre dans le même temps ; on ne les met pas dans le même registre comme si c’était deux époques différentes, et c’est cela qui est intéressant. Machiavel est le précurseur d’une pensée politique qu’on mène jusqu’à Marx, et donc dans la représentation commune c’est quelqu’un qui discute avec Locke, Hobbes, Rousseau ou Montesquieu, alors que Léonard est immergé dans ce monde des bricoleurs de génie qu’est celui des ingénieurs italiens de la Renaissance…
On a l’impression que Machiavel est plus notre contemporain que Léonard…
Voilà. Or, ce qu’on appelle la Renaissance, c’est le moment où un homme comme Machiavel pouvait se dire le disciple de quelqu’un comme Léonard. J’ai donc pensé qu’en racontant cette histoire un peu incertaine et contre-intuitive, je pourrais raconter, de manière libre et en jouant des contraintes du récit académique, ce qu’est pour moi la Renaissance. C’était aussi un principe de plaisir, d’écrire librement, comme j’en avais envie.
Justement, au niveau du style, Léonard et Machiavel est très différent de, par exemple, votre introduction d’une Histoire du monde au XVe siècle…
Oui. Parce que je suis enseignant-chercheur, je suis naturellement amené à publier mes résultats sous forme académique ; mais parce que je suis partisan de la vulgarisation, j’écris aussi régulièrement pour des revues comme L’Histoire ; de plus, j’ai le goût de la synthèse et j’ai donc rédigé quelques manuels et livres de synthèse — bref, je suis amené à écrire souvent. Toutefois, je n’écris pas facilement, et même de plus en plus difficilement au fur et à mesure que j’y place davantage d’enjeux, mais j’écris tout le temps et ne peux m’en passer.
Quand on écrit beaucoup et souvent, le risque est alors d’aboutir à une sorte d’écriture moyenne, où on va rédiger de la même manière un article pour Le Monde et pour L’Histoire, pour les Annales ou pour une revue érudite, pour un manuel ou pour un livre savant. C’est un danger qui guette les historiens qui ont beaucoup de sollicitations : se mettre à livrer la même eau tiède. Je me suis donc dit qu’il fallait « écarter les ciseaux », avoir différentes manières, pour conserver ce plaisir indispensable à l’écriture académique, mais aussi parfois « lâcher les rênes » comme disait Julien Gracq. Il s’agissait de jouer sur différents tableaux, en particulier le tableau littéraire mais pas fictionnel.
Vous insistez sur le fait que vous ne voulez pas « fabuler ».
En effet. Paradoxalement, je ne me suis jamais senti autant historien qu’en écrivant ce livre ; d’une certaine manière, c’est mon livre le plus implacable et le plus rigoureux, il a une forme littéraire mais non romancée et demeure au plus près des sources, sans aucune concession. Les rapports entre littérature et histoire m’ont toujours intéressé, et c’est une question qui a encore plus d’acuité intellectuelle depuis la polémique autour des Bienveillantes, de Littell : on s’interroge sur la frontière entre littérature et histoire. C’est un débat qui a rebondi avec la controverse de l’année dernière autour du livre Jan Karski, de Yannick Haenel. L’histoire ne peut pas être la science auxiliaire de la littérature, qui mieux que les historiens dirait la vérité sur les événements historiques.
Quand on s’émerveille devant Les Bienveillantes en disant que c’est le livre sur la Shoah, ou quand on s’indigne du roman de Haenel en l’accusant de ne pas dire le vrai sur Karski, on fait deux erreurs symétriques. On demande à la littérature d’avoir un discours sur le réel historique ; or si elle est porteuse d’une vérité, ce n’est pas sur le réel mais sur ce que Georges-Didi Huberman appelle « le temps décanté de son exactitude », c’est-à-dire la mémoire. Le livre de Yannick Haenel, par exemple, témoigne d’un certain état de la mémoire sur la Shoah. Les historiens doivent ainsi considérer la littérature comme une ressource d’intelligibilité historique. Les romanciers décrivent l’expérience du temps, et si on veut parler du temps comme j’ai voulu le faire dans Léonard et Machiavel avec la contemporanéité, il faut s’en donner les moyens littéraires. Ce qui ne veut pas dire fabuler.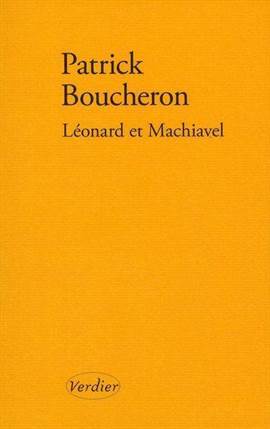
Je suis historien, ce qui n’est pas une condition ni nécessaire ni suffisante pour écrire des livres d’histoire. Je crois avoir voulu écrire un livre d’histoire, mais j’en ai brouillé les cartes, ne lui donnant pas l’allure d’un livre d’histoire, et j’ai fait un geste symbolique en l’envoyant dans une maison d’édition littéraire (Verdier), et il est sorti sous une couverture de fiction.
On le trouve d’ailleurs en librairie au rayon « littérature », pas « histoire ».
Voilà, et évidemment ça me flatte énormément car je pense fondamentalement qu’une vocation d’historien se fonde aussi sur un deuil littéraire. Quand on met un livre d’histoire sous une couverture littéraire, on organise une équivoque de lecture ; et quand elle a lieu, que les gens vous lisent comme un roman, on est content parce que c’est ce qu’on cherchait. Des articles de presse ont déclaré : « l’historien imagine la rencontre entre Léonard et Machiavel ». Or, je n’imagine rien, il n’y a pas par exemple de dialogue reconstitué. Ce livre est finalement un essai sur ce qui fait et peut défaire un livre d’histoire.
« Un acte de foi dans l’objet livre »
Vous avez dirigé la monumentale Histoire du monde au XVe siècle. Comment est né ce projet ?
Comme Léonard et Machiavel, ce n’est pas une commande. C’est une initiative personnelle car si j’aime travailler seul, j’aime aussi — et tout autant — travailler en groupe. C’est un cercle concentrique qui part d’un groupe d’amis (Yann Potin, Julien Loiseau et Pierre Monnet), avec lesquels on a travaillé pendant un an à l’architecture d’un livre qu’on a ensuite proposé à un éditeur (Fayard). C’est donc d’abord un objet éditorial et l’envie de faire un livre à un moment où on nous demande, comme enseignants chercheurs, de travailler dans des cadres rigides et avec des objectifs programmés.
Nous voulions travailler pour nous, librement, et tenter de convaincre à la fois un éditeur et près de soixante-dix chercheurs de nous suivre dans ce projet : c’était un acte de foi dans « l’objet livre », qui plus est en marge de l’institution. Il y avait aussi l’importance du temps. J’en avais moi-même car j’étais en partie déchargé de cours grâce à l’Institut universitaire de France, et cela m’a permis cette respiration. Cette question du temps est importante car, dans le contexte politique actuel, les universitaires sont amené à dépenser de plus en plus de temps pour demander de l’argent. Or, sauf exception, les sciences humaines, ont besoin de temps davantage que d’argent .
Comment est venue l’idée du sujet, le monde au XVe siècle ?
Lors de la soutenance de mon HDR, Elisabeth Crouzet-Pavan m’a dit quelque chose de très juste sur laquelle je réfléchis beaucoup depuis : « au fond, tu es quinziémiste, et lorsque tu parles de la période précédente, c’est toujours comme d’un passé médiéval ». Un historien a toujours un aujourd’hui, et pour moi c’est effectivement le XVe siècle. Mon aujourd’hui est habité par Machiavel, je vois les choses guidé par son regard. Nous nous sommes donc réunis en tant que quinziémistes, en voulant faire une histoire du XVe siècle, plutôt que celle de la fin d’un Moyen Âge qui s’éteint un peu en biseau. C’est ensuite une démarche géo-historique où après le temps on définit le lieu de ce temps ; et le lieu du XVe siècle, c’est le monde. On voulait faire une histoire du XVe siècle qui nous a amenés au monde, et à nous déterminer par rapport à un courant historiographique : la world history.
C’est une histoire connectée, pas comparative.
Cette expression a été popularisée en France par Serge Gruzinski et Sanjay Subrahmanyam. L’histoire connectée est peut-être la seule forme de world history acceptable en France, où l’historiographie a souvent été rétive à cette forme d’histoire, jugée trop anglo-saxonne et à contre-courant de ce qui intéressait les Français dans les années 1980-1990, comme la microhistoire. Situation paradoxale puisqu’on peut voir la world history comme le prolongement du travail de Braudel sur la Méditerranée. L’histoire connectée est en fait la manière avec laquelle les sociétés se métissent, se connaissent et s’inter-connaissent, les rencontres des temps et des espaces. Quand on parle de « temps de l’invention du monde », il y a évidemment l’idée d’une première mondialisation…
Une mondialisation qui aurait pu être autre, turque ou chinoise par exemple…
Exactement. Si on devait faire le pitch du livre, on dirait simplement : « d’autres mondialisations étaient possibles ».
D’où la volonté de « décentrer le regard ».
Oui, se situer à un moment donné ou dans des lieux où on comprend que l’histoire n’est pas fatale, qu’elle n’est pas écrite d’avance, et ne conduit pas inéluctablement vers ce que l’on sait qu’elle est devenue : en l’occurrence ici l’occidentalisation du monde. C’est pourquoi le livre commence avec la mort de Tamerlan. Le but n’est pas non plus de ne faire qu’une histoire glorieuse des métissages, des rencontres et des grandes découvertes, mais également l’histoire de l’invention des identités nationales, de la crispation des traditions. C’est cela aussi le XV siècle.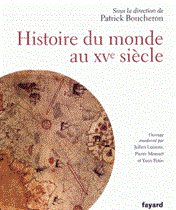
Il fallait essayer de faire un livre collectif, mais pas par défaut. On avait envie de faire aussi un livre qui nous ressemble, et qui raconte de mille manières tout un monde d’histoire, qui ne soit pas un récit vague sur le monde au XVe siècle. Cela nécessitait différentes voix, et ainsi de s’accrocher aux différentes écritures du monde. Evidemment, l’importance de l’imprimerie s’est imposée : grâce à elle, on peut dire que le XVe siècle est le temps du foisonnement des écritures du monde. Il fallait ne pas aborder uniquement l’imprimerie occidentale mais également coréenne, chinoise, et c’est cela qui nous a conduit à faire cette partie qui a été sans doute, pour moi aussi, la plus agréable à lire. Ce n’est pas une bibliothèque idéale, mais plutôt une librairie du XVe siècle où sont réunis les textes matriciels, incontournables.
« Investir intellectuellement le sujet »
Cette année, vous êtes préparateur au CAPES d’Histoire-Géographie, pour la question « Le Prince et les Arts en France et en Italie, XIVe-XVIIIe siècles », et vous avez participé au manuel Atlande sur le sujet. Quels conseils auriez-vous à donner à un candidat, en particulier dans ces temps troubles de mastérisation ?
La réforme des concours, personne ne la souhaitait, on l’a combattue, on a échoué et elle est donc là, il faut faire avec. « Le Prince et les Arts » est un sujet intéressant, mais il s’inscrit dans une réforme dont la philosophie et la mise en œuvre sont détestables. Mais on ne va pas laisser les étudiants seuls et il faut prendre ses responsabilités, et une manière pour moi de le faire était de s’engager aussitôt, comme participer à ce manuel. S’engager consiste ici à faire la seule chose que nous savons faire : faire de l’histoire, je dirais même faire de l’histoire malgré tout, c’est-à-dire investir intellectuellement le sujet. Le conseil essentiel que je peux donner c’est donc d’être soi-même, investir dans ces questions sa formation et ses convictions d’historien. Bien sûr, c’est très désagréable d’avoir à passer des écrits en novembre, cela pousse au bachotage et à baisser nos exigences intellectuelles, mais justement on peut résister par une bonne préparation. Le concours sera aussi ce qu’en font les préparateurs et les candidats, il faut ainsi s’intéresser malgré le peu de temps, et surtout ne pas baisser les bras.
« Un élargissement des usages sociaux de l’histoire »
Vous avez déjà évoqué la vulgarisation, est-ce dans cette optique que vous situez votre travail à la revue L’Histoire ?
Cela fait un peu plus de dix ans que je suis membre du comité de rédaction, et qu’ainsi je participe activement à la réalisation de cette revue. Je pense que l’histoire, comme discipline, intéresse un public bien plus large que celui des professionnels, professeurs ou étudiants. On s’en rend compte par le courrier des lecteurs, quand on fait une conférence, ou par des sites internet comme le vôtre. Le grand public de l’histoire est moins important qu’il ne l’a été mais il existe encore. Ma participation à L’Histoire est pour défendre cette idée, qu’il est toujours plus intéressant de ne pas être qu’entre soi. La revue souffre aujourd’hui, comme tout le secteur, d’un tassement des ventes, même si elle demeure forte économiquement — ce qui est, comme on le sait, le meilleur garant de l’indépendance éditoriale.
Reste que celle-ci est fondée sur un projet pensé il y a trente ans. A l’époque, l’idée était que, parce que les professionnels dédaignaient la vulgarisation et la laissaient à d’autres, il fallait proposer aux universitaires parmi les plus prestigieux de se charger eux-mêmes de cette vulgarisation. Mais aujourd’hui, comme le montre l’exemple de votre site et d’autres, cette idée qu’il n’y a que les professionnels de l’histoire qui écrivent de l’histoire est un peu dépassée ; il existe des usagers, des amateurs éclairés, des passionnés qui le font. Je ne suis pas contre, bien au contraire, je suis pour l’élargissement des usages sociaux de l’histoire, c’est ce qui me différencie de mouvements comme Liberté pour l’histoire par exemple. Il faut prendre acte qu’il y a aujourd’hui une diffusion sociale des usages de l’histoire, bien au-delà de l’histoire universitaire. Soit on s’en chagrine, soit on l’accompagne, et je pense que les coordonnateurs de l’ouvrage Historiographies (Concepts et débats) ont bien dit les choses dans leur introduction. Et internet participe évidemment à cet élargissement des usages de l’histoire.
Vous allez vous-même sur ces sites ?
Oui ça m’arrive. Je sais bien sûr qu’il y a tout et son contraire sur internet, mais il est intéressant de voir, en histoire médiévale par exemple, que les questions qui vont déchaîner tous les délires sont toujours les mêmes : Jeanne d’Arc, les Templiers, les Cathares. Ce sont celles-ci qui provoquent des débats et des réactions passionnées. Mais il peut y avoir aussi parfois, sur ces sites, des articles pointus de passionnés qui peuvent être déterminants. La responsabilité d’un enseignant serait tout de même d’organiser sérieusement une formation qui permettrait aux étudiants de trier dans cette masse d’informations disponibles. On le dit, mais on ne le fait jamais. C’est un travail qui est très compliqué à mettre en place, on donne quelques conseils, mais il faudrait un enseignement systématique.
Ouvrages de Patrick Boucheron
- Le Pouvoir de bâtir. Politique édilitaire et pouvoir princier à Milan aux XIVe et XVe siècles, École française de Rome, 1998.
- Léonard et Machiavel, éditions Verdier, 2008.
- Faire profession d’historien, Publications de la Sorbonne, 2010.
Patrick Boucheron a également dirigé Histoire du monde au XVe siècle (Fayard, 2009) et participé aux ouvrages collectifs A quoi sert l’Histoire aujourd’hui ? (Bayard, 2010) et Historiographies. Concepts et débats (Folio histoire, 2010) ainsi qu’au manuel Le Prince et les Arts en France et en Italie, XIVe-XVIIIe siècles (Atlande, 2010) avec Pascal Brioist, Delphine Carangeot et Mélanie Traversier.

